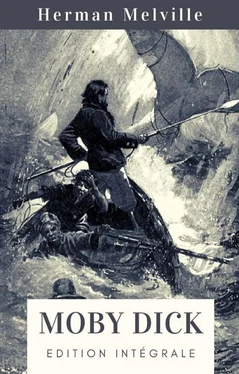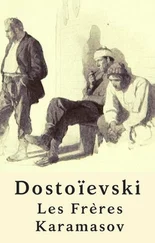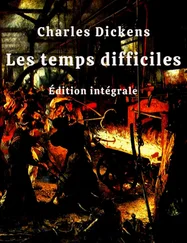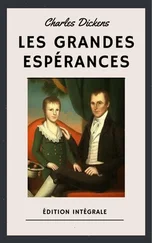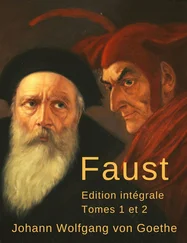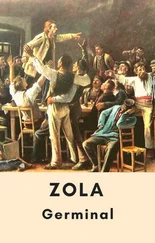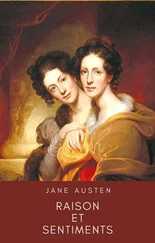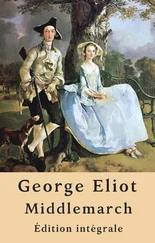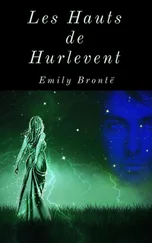Le navire et la chaloupe s’écartèrent et entre eux s’engouffra le vent humide et froid de la nuit, un goéland les survola en criant ; les deux coques roulèrent sauvagement. Le cœur lourd, nous poussâmes trois hourras et, pareils au destin, nous plongeâmes aveuglément dans la solitude océane.
CHAPITRE XXIII Terre sous le vent
Dans un chapitre précédent, il a été question d’un dénommé Bulkington, un marin de haute stature, fraîchement débarqué et rencontré à l’auberge de New Bedford.
Tandis que, par cette nuit d’hiver, cassante de gel, le Péquod pourfendait d’une étrave vindicative la vague maligne et froide, qui vis-je à sa barre sinon Bulkington ! Je regardai avec une sympathie et une crainte respectueuse l’homme qui, en plein hiver, à peine rentré d’un dangereux voyage de quatre ans pouvait, sans répit, repartir aussitôt vers la tempête et de nouveaux dangers. La terre semblait lui brûler les pieds. Les plus étonnantes merveilles sont à jamais ineffables ; les souvenirs profonds ne demandent point d’épitaphes, ce chapitre, long de six pouces, est la tombe sans marbre de Bulkington. Laissez-moi dire seulement qu’il en alla pour lui comme pour le navire secoué par l’ouragan qui longe misérablement la terre sous le vent. Le port ne serait que trop heureux d’accorder son secours, le port est compatissant ; le port assure la sécurité, le confort, la pierre du foyer, le souper, la chaude couverture, des amis, tout ce qui dispense la douceur à notre faiblesse. Mais dans ce vent de tempête le port et la terre sont les pires dangers qui guettent ce navire, il lui faut fuir toute hospitalité ; sa quille viendrait-elle à effleurer la terre, qu’un grand frisson le secouerait de part en part. De toute sa puissance il doit forcer de voiles pour s’éloigner des rivages, et ce faisant lutter contre les vents mêmes qui voudraient le ramener vers eux, chercher la mer cinglante, vide de toute terre, et pour survivre se précipiter avec désolation dans le péril son seul ami, son plus implacable ennemi !
Le sais-tu, Bulkington ? Tu semblais avoir entrevu cette vérité, mortellement intolérable, qu’une pensée profonde et sincère n’est que l’intrépide effort de l’âme pour sauver l’indépendance sans limites de son propre océan cependant que les vents les plus furieux, soufflant de terre et de mer, conspirent pour la rejeter à la côte traîtresse et servile ?
Mais, comme loin de toute terre seulement, demeure la vérité la plus haute, sans rivages, et comme Dieu illimitée, mieux vaut périr dans cet infini hanté de clameurs, que d’échouer honteusement à la sécurité de la terre sous le vent ! Tout ver de terre que nous sommes, lequel d’entre nous se sentirait l’ardent désir de ramper ! Épouvante de l’épouvante ! tant d’agonie serait-elle vaine ? Courage, courage, ô Bulkington ! Bats-toi avec acharnement, demi-dieu ! Ton apothéose jaillit tout droit de l’écume soulevée par ta mort océane.
CHAPITRE XXIV
Le plaideur
Étant donné que Queequeg et moi nous sommes désormais embarqués pour la pêche à la baleine et parce que celle-ci est aujourd’hui considérée par les terriens comme une occupation honteuse et dépourvue de poésie, je désire vous convaincre, vous terriens, de l’injustice qui nous est ainsi faite à nous autres, chasseurs de baleines.
Bien qu’il paraisse presque superflu d’insister sur ce fait, il convient de relever tout d’abord que, parmi le grand public, la chasse à la baleine n’a pas place dans les professions libérales. Si un étranger se présentait dans une société mélangée de la métropole, il ne rehausserait guère l’opinion générale sur ses mérites, s’il se présentait en tant que harponneur, par exemple. Et si, à l’instar des officiers de marine, il faisait figurer sur sa carte de visite les initiales P. A. C. (pêche au cachalot), un tel procédé paraîtrait présomptueux et ridicule à l’extrême.
Sans doute la raison majeure pour laquelle le monde refuse de nous rendre hommage à nous baleiniers est-elle celle-ci : les gens pensent, en mettant les choses au mieux, que notre profession n’est qu’une sorte de tuerie, et qu’une fois engagés activement dans cette affaire, tout n’est plus que souillures autour de nous. Nous sommes des bouchers il est vrai. Mais furent aussi des bouchers, des bouchers portant les plus sanglantes médailles, tous les chefs militaires que le monde, invariablement, se délecte à honorer. Quant à la charge de saleté que l’on fait peser sur notre travail, vous serez bientôt éclairés sur certains faits, jusqu’ici à peu près généralement inconnus, et qui, tout compte fait, situeront, de façon éclatante, le navire baleinier parmi les choses les plus propres de cette proprette terre. Mais, même en acceptant comme véridique cette allégation, quel pont visqueux et en désordre d’un baleinier est comparable au charnier répugnant de ces champs de bataille dont tant de soldats reviennent pour boire aux applaudissements de toutes ces dames ? Et si la notion de danger ajoute un prestige populaire tel au métier de soldat, permettez-moi de vous affirmer que plus d’un vétéran qui s’était pourtant lancé d’un cœur léger à l’assaut d’une batterie, fuirait rapidement à l’apparition de la queue géante du cachalot battant l’air en tourbillons au-dessus de sa tête. Car, quel rapport peut-on établir entre les terreurs engendrées par l’homme et accessibles à son entendement et ces prodiges d’épouvante réalisés par Dieu !
Au reste, bien que le monde nous repousse avec mépris nous autres baleiniers, il nous rend, inconsciemment, le plus profond hommage et même une adoration généreuse ! En effet, comme sur autant d’autels, et d’un bout à l’autre de la terre, presque tous les cierges, les lampes et les bougies brûlent à notre gloire !
Mais considérez cette question sous d’autres angles, pesez-la dans les plus diverses balances et voyez ce que nous sommes et ce que nous avons été, nous autres baleiniers.
Pourquoi la Hollande, sous l’administration des Witt, eut-elle des amiraux pour ses flottilles de baleiniers ? Pourquoi Louis XVI de France arma-t-il à ses propres frais des navires baleiniers à Dunkerque, invitant courtoisement dans cette ville quelque vingt ou quarante familles de notre propre île de Nantucket ? Pourquoi, entre 1750 et 1788, la Grande-Bretagne versa-t-elle à ses baleiniers des primes se montant à 1 000 000 de livres ? Et finalement comment se fait-il que nous, baleiniers d’Amérique, nous surpassions à présent en nombre la totalité des autres baleiniers du monde ; que nous ayons une flotte de plus de 700 navires menés par 18 000 hommes, dépensant annuellement 4 000 000 de dollars, des navires valant à l’appareillage 20 000 000 de dollars et ramenant chaque année dans nos ports une moisson bien gagnée de 7 000 000 de dollars. Que signifie tout cela sinon la puissance inhérente à la pêche à la baleine ?
Et ce n’est pas même la moitié des arguments. Voyez encore.
Je soutiens qu’un philosophe universel ne peut pas, quand bien même il y irait de sa vie, relever une seule influence pacificatrice ayant eu, au cours des soixante dernières années, un pouvoir aussi étendu sur le monde entier, pris en bloc, que cette noble et grandiose chasse à la baleine. D’une façon ou d’une autre, elle a entraîné des événements si remarquables en eux-mêmes, si importants dans leurs conséquences permanentes, qu’on peut bien la comparer à cette mère égyptienne qui mettait au monde des filles déjà gravides à leur naissance. Ce serait une besogne sans fin et sans espoir que d’établir un répertoire de ses mérites. Contentons-nous d’une poignée : pendant bien des années le navire baleinier a été le pionnier de la découverte des terres les plus lointaines et les moins connues. Il a exploré des mers et des mers et des archipels ne se trouvant sur aucune carte et où aucun Vancouver, aucun Cook n’étaient allés. Si les navires de guerre américains et européens entrent paisiblement dans des ports autrefois barbares, qu’ils tirent des salves en l’honneur et à la gloire du baleinier qui le premier leur a ouvert la route et leur a servi d’interprète auprès des sauvages. Qu’on célèbre tant qu’on voudra les héros des expéditions d’explorations, vos Cook, vos Krusenstern, moi je vous dis que bien des capitaines anonymes qui sont partis de Nantucket étaient aussi grands, et plus grands, que votre Cook et votre Krusenstern car, avec leurs mains vides et démunies, dans des eaux païennes infestées de requins, et sur les rivages d’îles inconnues où les attendaient des javelots, ils combattaient de neuves merveilles et des terreurs que Cook n’eût pas volontiers défiées avec tous ses marins et tous ses mousquets. Tout ce que montent en épingle les vieux récits de voyage dans les mers du Sud n’était que les banalités de la vie quotidienne de nos héroïques Nantuckais. Souvent des aventures auxquelles Vancouver consacre trois chapitres n’auraient pas paru à ces hommes dignes d’être mentionnées dans leur journal de bord. Ah ! le monde ! Oh ! le monde !
Читать дальше