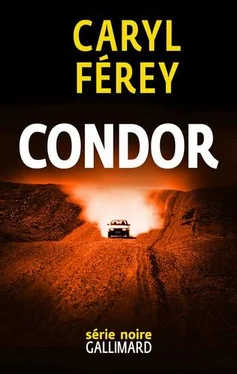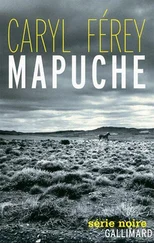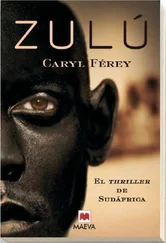Marcher. Droit devant. Le plus vite possible, autant que ses jambes pouvaient le porter, sans penser à la douleur de son doigt. Six kilomètres. Ses pensées se fragmentaient. Le froid tétanisait ses muscles. La fatigue. Le contrecoup du stress. La fusillade. Schober resté sur le carreau. Marcher encore. Cinq kilomètres. Il s’encouragea : plus que cinq kilomètres. Une fois passée la frontière, tout était possible… Porfillo jeta un énième regard dans son dos. Le bleu du ciel avait fondu avec la lune. Avec son cerveau en manque d’oxygène. Il marcha encore, la gorge comme un rasoir. La soif. La frontière bolivienne. Il n’y connaissait personne mais il trouverait. Le vent des hauts plateaux le faisait tituber, ses jambes se vidaient de leur sang, de leur sève, il pestait en glissant sur les plaques de sel. Il n’avait pas le temps de se reposer, la nuit guettait, l’engloutirait… Plus que quatre kilomètres.
Des oiseaux noirs planaient dans le ciel. Un couple de rapaces, des caranchos qui habitaient la montagne. Porfillo se retourna de manière mécanique et resta quelques secondes immobile, le regard fixé sur un point au loin… Un point qui, lentement, semblait grossir… Un mirage. Un délire dû à l’altitude, à ce vent qui rendait fou. Il attendit encore, le souffle rauque dans sa poitrine, écarquillant les yeux comme s’il pouvait mieux voir… Non, pas de doute : la forme sur la mer de sel semblait même se mouvoir… Il saisit son arme, vérifia son chargeur. Trois balles. Le reste des munitions était dans le Land Rover. La forme approchait toujours. Porfillo parcourut une centaine de mètres, le Glock à la main gauche pour soulager son doigt blessé, se retourna encore et comprit qu’il était inutile de fuir : la silhouette gagnait sur lui, inexorable.
Il s’arrêta, éreinté. La silhouette était maintenant distincte, celle d’un type perché sur un âne… Un putain d’âne : Porfillo distinguait ses oreilles pendantes, le trot et le mouvement qu’il formait avec le cavalier… Il avançait, méthodique, au milieu des bourrasques, les pieds touchant presque le sol tandis que l’animal s’échinait. Le tueur de la villa. L’homme aux cheveux blancs.
Cinquante mètres : Porfillo brandit son arme, visa au-dessus de l’âne et rata sa cible.
— La concha de tu madre !
Le vent faisait dévier son bras. Ou la douleur de son doigt l’empêchait de se concentrer. Il se campa plus fermement sur ses jambes, fixa sa main gauche sur son poignet, mit le cavalier en joue et pressa la détente. L’écho de la détonation hurla dans le vent. L’autre avançait toujours. Porfillo laissa passer une rafale, visa de nouveau, plus nerveux, comprit trop tard que c’était lui la cible. Le fusil cracha le feu au moment où sa dernière balle se perdait dans la tourmente : Porfillo se plia en deux, la tête propulsée en avant sous le choc, et lâcha le Glock dans un râle.
Le cavalier avait tiré à hauteur des jambes, trois projectiles dont deux avaient trouvé la chair. Porfillo s’agenouilla et posa la main gauche à terre. Une balle avait traversé le gras de sa cuisse, il y avait du sang partout sur son pantalon et une douleur aiguë se répandait dans le bas du ventre. Le fils de pute lui avait tiré dans les couilles. Il déglutit, vit la blessure et ce fut pire. Un carnage. Porfillo trouva la force de se redresser.
Le cavalier s’était arrêté à une dizaine de mètres. Le même tireur qu’à Valparaiso armé d’une carabine et un âne pelé qui le regardaient, tous les deux impassibles. La main gauche de Porfillo se crispa sur le cran d’arrêt dissimulé dans sa veste de laine. L’enfoiré pouvait le descendre à tout moment mais qu’il approche… encore un peu.
L’impression d’impassibilité perçue par le tueur était trompeuse. Car Stefano venait de reconnaître l’ancien agent de la DINA : ces traits grossiers, ce regard convergent, comment les oublier… Stefano maudit la salive qui lui manquait. Il avait à peine vu son visage dans la maison de Schober, mais Porfillo était l’interrogateur de la Villa Grimaldi, El Negro, la brute qui lui avait démoli le genou à coup de revolver. Alias Jorge Salvi, subordonné de Sanz/Schober… Stefano n’avait jamais cherché à retrouver son tortionnaire auprès des associations des Droits de l’Homme à son retour d’exil, El Negro n’était qu’une crapule fasciste parmi d’autres. Il se trompait. Le passé et le présent étaient liés, comme le fil invisible qui l’avait relié pendant quarante ans à Manuela. Tout était en place dans le théâtre d’ombres que constituait sa vie. Un ultime règlement de comptes avec l’Histoire.
Vacillant dans le vent glacé, Porfillo ne reconnut pas l’homme qui lui faisait face. Celui-ci ne bougeait pas, perché sur son âne, la carabine à la main.
— Qui tu es ? lâcha-t-il, grimaçant de douleur. Hein ?
Stefano observait le bourreau, arc-bouté dans le soleil couchant. Du sang coulait sous son gilet pare-balles, de petites gouttes régulières qui dessinaient des figures obscures sur la mer de sel. Une méchante blessure. Sans eau, avec ce froid, il n’irait pas loin… Gabriela voulait qu’il le tue mais la mort pour lui serait trop douce. Stefano leva la tête vers le couple de caranchos qui le suivait depuis tout à l’heure. Il ferait bientôt nuit sur le salar de Tara. Dans quelques minutes, le pistolet tombé aux pieds de Porfillo ne lui serait d’aucun secours contre les assauts des rapaces. Au mieux cette charogne mourrait de froid. Au pire ils le dépèceraient vivant…
Stefano le laissa aux caranchos .
* * *
Le buste de Busquet roula contre la roue du 4 × 4, le visage pulvérisé par la balle de gros calibre. Schober râlait un peu plus loin, inaudible dans le tourbillon du vent.
Gabriela n’avait d’yeux que pour Esteban, paupières papillotantes sous le ciel éteint des Andes. Elle ne savait plus par quel bout le prendre dans cette bouillie d’amour et de sang : elle murmurait son prénom, sa joue posée contre la sienne, et d’étranges visions lui remontaient des entrailles. Gabriela avait déjà vécu cette scène chez la machi , quand les anamorphoses s’étaient substituées aux rouleaux : la chaleur de son corps contre elle, l’âne ricanant, la mer de sel… Tout ça n’avait pas de sens.
Le vent glacé les figea un peu plus. De la lave.
Le monde d’Esteban était trouble, depuis longtemps sans doute. Il distinguait encore les contours de Gabriela sous le ciel cobalt… Quel spectacle. Quel spectacle magnifique. La douleur irradiait son corps mais son esprit flottait librement : ô Gabriela, pourquoi ce regard si sombre et si triste ? Elle murmurait son prénom, caressait ses cheveux comme s’il allait partir, la quitter, alors qu’il n’avait jamais été aussi bien, détaché de lui-même… Il visita le salar au crépuscule, ses reflets phosphorescents, trouva sur le chemin quelques amours littéraires, Catalina et les autres, tous ses vieux fantômes qui ce soir se donnaient rendez-vous dans ses bras. C’était la fin de l’histoire. Une vie imaginée, rêvée. Pour une fois il ne s’était pas trompé. Gabriela était son amour en activité, sa femme magnétique.
— Je ne te laisserai plus tomber, Gab… Si tu sens… une présence… un jour… machi ou pas… ce sera moi.
Il respirait avec peine, les poumons noyés. Un voile se dessina sur ses yeux bleu pétrole.
— Reste avec moi, Esteban… Reste.
Elle le serrait fort pour le retenir, elle sentait qu’il se dérobait, qu’il fuyait comme l’eau entre ses doigts. Esteban voulut la rassurer mais son sourire était plein de sang.
— Tué à quarante ans, dit-il dans un souffle, comme Víctor Jara…
Читать дальше