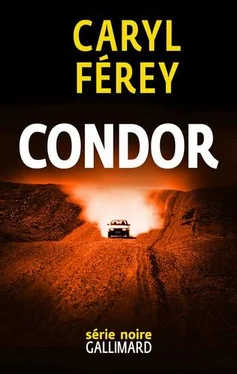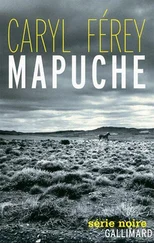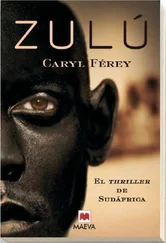Esteban pensait à son enfance, à sa famille, à son père et son grand-père, son arrière-grand-père et ceux qui avaient précédé dans la céleste lignée, ces gens cultivés et respectables qui lui avaient menti toute sa vie, jusque dans sa généalogie intime, sa famille, ses amis, ses professeurs — mensonges ! mensonges ! Il repensait à son enfance à Las Condes, La Reina, avec ses espaces verts, ses universités high-tech et ses clubs de sport, une vie parallèle où les gens comme lui bénéficiaient du tout-à-l’égout quand, les eaux torrentielles de l’hiver dévalant les Andes en charriant tout sur leur passage, les canalisations des plus déshérités débordaient de merde faute de raccordements dignes de ce nom — la cuvette de Santiago, la bien nommée, où fermentait le peuple, la populace qui n’aurait jamais aucune part du gâteau.
L’esthète avait brillé à l’université sans se soucier de qui pouvait y accéder, on avait tracé son chemin sans dire qu’on avait effacé celui des autres, et lui avait tout gobé. La menace communiste ? L’URSS et les pays de l’Est avaient fermé leurs ambassades pendant que les « camarades » se faisaient massacrer par la clique de Pinochet. La probité du vieux Général ? Possédant une simple voiture le jour du coup d’État, il avait vécu dans un bunker doré, détournant des millions de dollars sans jamais répondre d’aucun de ses crimes, du sang jusque sur les dents.
Esteban en vomissait des vipères.
Son père, l’irrésistible Adriano Roz-Tagle, n’avait pas collaboré avec la dictature, il s’était contenté de s’enrichir en récupérant les services publics bradés au privé, il avait accaparé les moyens de communication en attendant l’heure où il faudrait faire avaler la pilule d’une transition en douceur à la population et sauver la face d’un État de délinquants. Dans ce grand écran de fumée, Esteban avait eu une star pour mère, ce miroir aux alouettes où la pauvre croyait voler, rien que du piteux, du rêve cosmétique dont la nostalgie, c’était peut-être le pire, la faisait boire, boire pour oublier qu’elle n’était plus qu’une alcoolique accrochée au strapontin d’une dernière séance commencée sans elle. Dans sa chair, ses cellules, son sang, Esteban s’était senti infiniment trahi : ses parents, sa famille, les livres d’école, la société entière et les gens qui la constituaient lui avaient menti en Cinémascope, comme quelqu’un apprenant adulte qu’on l’a adopté, un séisme silencieux. Son propre passé était devenu illégitime, l’argent qui lui revenait illégitime, les femmes qui lui tombaient crues dans les bras illégitimes, ses amours même avaient été illégitimes, de simples accointances de classe, tout était faux, gâché, pourri, comme s’il avait vécu jusque-là l’existence d’un autre, d’un imposteur. En partageant le cabinet d’avocats avec Edwards, en culbutant les petites princesses de son rang sans en aimer aucune, en respirant l’air de l’appartement payé avec l’argent de ses parents, Esteban n’avait jamais vécu qu’en imposteur. Même écrivain, il serait un imposteur. Un Roz-Tagle. La distance qui le séparait des gens ordinaires avait été intégrée dans le corps social du pays, celui d’un malade : lui s’était désintégré du corps social.
Il avait explosé en vol.
Tout était à vendre au Chili. Même la Villa Grimaldi avait été bradée à un militaire à la fin de la dictature, avant de devenir un lieu de mémoire sous la pression des associations de victimes. C’est là qu’Esteban avait reçu le coup de grâce.
La Villa Grimaldi se situait dans le quartier de La Reina, où ses parents avaient acheté leur manoir. Esteban visitait ce parc enfin paisible où, au gré des témoignages, on pouvait croiser les visages des torturés, des disparus, ces photos noir et blanc aux silences douloureux — infiniment douloureux…
Dans le jardin de la Villa Grimaldi, chaque rose portait le nom d’une femme assassinée. Un tendre hommage pour celles qui avaient connu l’enfer. Esteban était tombé devant l’une de ces victimes, Catalina Ester Gallardo Moreno… Pourquoi ce jour-là ? Pourquoi elle ? Son sourire d’une modernité folle, ses cheveux à la garçonne, son air pétillant et gai, sa jeunesse jurée à la face du monde, toute cette beauté qu’on avait mordue au visage pour lui apprendre à vivre, aujourd’hui réduite à une étiquette dans un parterre de fleurs ensoleillé : cette vision l’avait foudroyé.
Esteban était tombé amoureux d’une fleur, une rose rouge du nom de Catalina, par aversion pour les siens : un choc dont il ne s’était pas relevé.
Les lits électrifiés où on attachait les gens comme elle, les électrodes dans le vagin et le rectum qui les convulsaient de douleur, leurs hurlements de terreur sous les yeux de leurs frères ou maris qu’on forçait à regarder, les baignoires où on les étouffait, les viols, les viols collectifs, les viols par des bergers allemands, ceux qu’on jetait des hélicoptères attachés à des rails de chemin de fer pour éviter qu’ils ne remontent à la surface, le cadavre d’un enfant retrouvé trente ans plus tard avec douze balles dans le corps, les sévices qu’il fallait « interpréter dans le contexte », tous ces mensonges avalés maelstrom, tourbillon, pourriture, Allende autopsiant les enfants le cœur brisé, le même acculé au suicide dans la Moneda en flammes, Víctor Jara supplicié, quarante ans et autant d’impacts de balles dans la peau, un massacre riant pour des bourreaux qui savaient à peine lire, Catalina la petite pute rouge qui avant de devenir une rose en avait pris pour son grade : les larmes qui avaient coulé ce jour-là à la Villa Grimaldi coulaient toujours.
Víctor Jara aux mains cassées, Catalina, les héros de ses livres étaient des morts.
Gabriela sur le siège oublia les rares nuages dans le ciel tombant : Esteban lui tendait une feuille de papier pliée qu’il venait de sortir de sa poche.
— J’ai écrit ça pour toi, dit-il.
— C’est quoi ?
Sa main tremblait un peu.
— La fin de l’histoire.
Gabriela déplia la feuille, suspicieuse. Elle découvrit un texte manuscrit, une sorte de poème en prose, reconnut la petite chanson de Catalina à son Colosse qui manquait encore à son Infini cassé … Elle acheva la lecture et redressa la tête.
— Ça veut dire quoi ?
— Que l’histoire finit mal, Gab.
Elle s’ébroua sur le siège de la Mercedes — c’était bien le moment d’avoir cette discussion.
— Celle de ton livre, dit-elle, pas la nôtre.
— C’est pareil, non ?
Esteban la regardait comme s’il pouvait trouver dans l’éclat de ses yeux noirs la réponse qui le sauverait, mais la nuit était tombée du mauvais côté des astres.
— Il faut que je te dise quelque chose, enchaîna-t-il. Au sujet de cette foutue nuit à Quintay… Je me suis souvenu de ce qui s’est passé en sortant du coma : je t’ai filmée, Gab, avec ta caméra. J’ai filmé ta noyade… Et si tu t’en es sortie, ce n’est pas grâce à moi. Moi je t’ai abandonnée au milieu des vagues, comme un lâche. Le dernier des lâches que j’ai toujours été…
La Mapuche ravala sa salive. Ainsi lui aussi avait « vu » cette scène.
— Je ne suis pas à la hauteur, dit-il. De ton amour, de ta magie… Regarde-moi, fit-il en prenant sa main brisée à témoin, je suis tout juste bon pour la casse. Alors que toi…
Gabriela serra les dents : l’homme qu’elle aimait avait des serpents dans la tête. Une force maléfique testait son pouvoir de machi , ou quelque génie malin, mais elle n’avait pas ramené son âme d’entre les morts pour qu’il lui claque comme une bulle de savon entre les mains.
Читать дальше