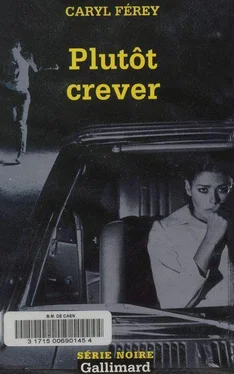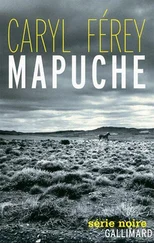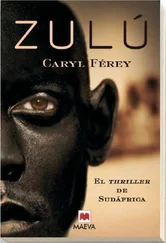— Tu crois qu’il y a une différence quand on dit « libre comme l’air » et « à l’air libre » ? murmura-t-elle dans la brise.
*
Contradictions et vieilles certitudes mijotant dans la même marmite, je méditai longuement avant de trouver la réponse qui conditionnerait le reste de ma foutue vie. Quatre jours. C’était peu et beaucoup à la fois. Muré dans un silence lourd de conséquences, je passais mes heures assis sur les rochers des criques, à lire et à penser. Il n’y avait pas grand choix au supermarché de Belle-Île mais j’avais fini par dégotter un recueil de Pessoa. Petit miracle qui vous tient en vie.
Seule la colère des ruelles sans porte entrait et sortait de mon âme sans savoir où aller ni où revenir sans tuer et sans mourir…
La vie des uns tient parfois à l’avis des autres.
Mais plus je me rapprochais de la solution, plus les choses me paraissaient abstraites, presque impossibles. Ce n’était pas en griffonnant quelques mots sur un bout de papier que j’allais changer le monde : le mien, par contre… Restait Alice. Elle taisait des choses qu’elle aurait dû me dire, évitait soigneusement toute allusion à la Justice (après quatre jours passés sur l’île de Houat, nous ne lisions même plus les journaux), et ses façons de faire me laissaient aujourd’hui totalement impuissant. On ne s’oppose pas à une vague, bon an mal an on s’y mêle. Car au-delà des apparences, c’est elle qui m’avait embarqué dans cette histoire, et non l’inverse ; elle m’avait comme glissé dans sa peau, entre l’épiderme et la chair, dans quelque lieu sanglant et bouillonnant où je me sentirais bien. Pour ça, je n’étais pas difficile. Mais le silence entre nous s’épaississait. D’elle, il ne me resta bientôt plus que son odeur primitive dans la tente et la désagréable sensation qu’elle épiait mon sommeil, qu’elle guettait au-dessus de moi comme si elle pouvait happer mes cauchemars et me les recracher : j’en avais même rêvé une nuit — Alice en cobra cracheur, ça valait son poids de terreur. Mais quand je me réveillai en sursaut, c’était pour constater qu’elle dormait enroulée dans son duvet, non pas à poings fermés mais la main ouverte, plantée dans la bouche entre le pouce et l’index, comme un os. Un os ou un bâillon…
Il fallut que j’achève les Mémoires de Lacenaire pour qu’enfin je me décide.
C’était en juillet, un 14 Juillet : un soir de révolution.
Il restait deux balles dans la trousse.
Une suffirait.
*
J’étais issu d’une famille où, avec une sorte d’acharnement génital, la benjamine avait vingt-quatre ans de moins que l’aîné — c’est-à-dire moi. Je n’aurais probablement jamais rencontré la petite si, au printemps, nos parents n’avaient trouvé la mort dans un accident de la circulation.
Les ennuis avaient véritablement commencé le jour où je m’étais retrouvé dans le bureau d’un juge avec l’avocat des grands-parents afin de statuer sur l’avenir de Mathilde. Par expérience, je savais ce qui attendait la gamine : moi aussi j’avais passé mes vacances et mes week-ends chez eux, dans leur villa de La Baule. Sous les pins il y avait « la Vioque », une espèce de caniche royal qui, lorsque son mari bougeait la main, s’agitait en se demandant où était le caillou, et « le Vioc » qui, pour m’apprendre à pisser au lit, me laissait mariner des heures dans le noir de la cave, en guise de punition.
Les parents, toujours occupés ailleurs, passaient en coup de vent le dimanche, pour les fêtes ou pour proclamer une nouvelle naissance. De toute façon, les enfants se côtoyaient peu : il en naissait un tous les quatre ou cinq ans, et comme chacun d’entre nous ne restait à La Baule que le temps de la maternelle, nous finissions éparpillés dans des pensions différentes sans presque jamais nous voir. Bien entendu, à l’annonce de leur décès, les grands-parents avaient demandé la garde de Mathilde, qui selon la coutume leur revenait de droit.
En dépit de ses cinq ans, la petite ne parlait toujours pas. Pas un mot, ou alors des bruits. Imaginer qu’elle pût un jour faire pipi au lit chez eux me faisant froid dans le dos, je m’étais attaché les services d’un avoué afin de revendiquer mon devoir de tuteur. Mais dans le bureau du juge où je plaidais seul ma cause, je voyais bien que quelque chose ne tournait pas rond ; l’avocat des grands-parents, un ténor du barreau visiblement connu du juge, expliqua ainsi que ses clients étaient encore jeunes et en forme, qu’ils avaient le temps et les moyens d’éduquer correctement l’orpheline jusqu’à sa majorité, que Mathilde les connaissait bien mieux que moi, ce frère qui jusqu’à présent avait surtout brillé par son absence, tant à la naissance que par la suite, moi dont les revenus étaient soit dit en passant ridicules, les projets de vie désespérants ( L’Ankou Magazine …), sans parler de ma moralité douteuse : on évoqua ainsi mon passé d’asocial, mes heures de TIP pour dégradations sur la voie publique, mes procès-verbaux, mon activisme dans divers mouvements protestataires, le mystérieux financement de la revue et ma consommation régulière de stupéfiants — à l’occasion, on posa la question de savoir d’où provenait l’argent de la revue, insinuant que je dealais — moi, un marchand ! J’avais senti le vent tourner quand maître Caseneuve s’envola dans un brillant plaidoyer contre la petite délinquance et la nécessité d’un climat sain et serein pour l’éducation de l’enfant.
Avec ma veste aux poches décousues et mes ratures sur les papiers officiels, je n’avais pas une chance. De fait, le juge m’écouta poliment. Quelques semaines plus tard, il donnait la garde exclusive aux grands-parents, me laissant seul avec ma rage et un droit de visite un dimanche sur deux, de trois à cinq, soit quatre heures par mois.
Aussitôt joint au téléphone, l’avoué qui m’avait épaulé dans cette affaire me signifia que son rôle s’arrêtait à remplir les papiers administratifs, que le bureau des affaires familiales n’était pas de son ressort, qu’il me souhaitait bonne chance dans un monde guère folichon… Bref, je m’étais comporté comme un parfait imbécile dans cette histoire. Je m’étais battu du bout des crocs alors que je savais ce qui attendait la petite Mathilde. Je l’avais vue au centre social, une fois. Elle m’avait tout de suite plu avec son air renfrogné, son urticaire et ses couettes à croquer. Nous avions à peine communiqué, juste des regards et quelques mots pour lui expliquer mon point de vue sur la situation mais elle était de ma famille, pas de celle des vieux. Seulement je m’y étais pris comme un manche.
Cela ne se reproduirait plus.
Penché sur mon bic, une feuille de papier à cigarette posée sur les Mémoires de Lacenaire, je racontai tout à la gamine : puisqu’elle était de ma famille, elle comprendrait mes erreurs, mes fautes et mes faiblesses. L’essentiel était qu’aujourd’hui elle pouvait me faire confiance : non, je ne lâcherais pas le morceau…
Quand tout fut consigné, noir sur blanc, j’écrivis la formule magique, celle qui tuait la culpabilité dans le dos, à bout portant, pour la petite : « J’arrive. »
En une formule, je m’étais absous de mon crime.
*
Du vent montait un crachin poisseux. Je passai la langue sur mes lèvres salées et marchai jusqu’à la crique voisine, désertée à l’heure de la fête nationale. Une nuit mauve appelait ses étoiles au-dessus du port, je ne me sentais ni euphorique ni déprimé : juste moi-même.
Ça faisait longtemps…
Avec la brise du soir, les rumeurs du bal me parvenaient par bribes. Je m’arrêtai au pied de la falaise et sortis le Smith & Wesson du sac à dos. Alice partie on ne sait où, j’avais moi-même serti la douille… Vert, fuchsia, blanc, violet, les étoiles faisaient des étincelles dans le ciel. Je tendis le revolver vers les premiers éclats du feu d’artifice en priant pour que tout ne m’explose pas à la gueule, songeai une dernière fois aux Viocs, à la guerre ouverte qu’il me faudrait leur livrer pour récupérer la gamine et attendis la déflagration pour abattre une belle bleue.
Читать дальше