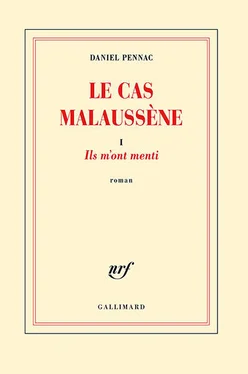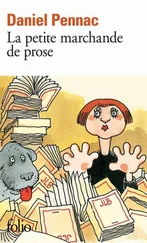TALVERN : Restez assis, Balestro !
Balestro se serait bien levé une deuxième fois mais le poids de la gendarmerie sur ses épaules l’en empêcha. Deux gendarmes occupaient le bureau de la juge à présent.
Dans le couloir, la femme qui accompagnait le garçon criait :
— Nelson, volte aqui ! Não tem mais perigo, acabou !
(Nelson, reviens ! Tu ne risques plus rien, c’est fini !)
Quelqu’un avait dû stopper l’enfant car la femme ordonna :
— Brigadier, lâchez-le, s’il vous plaît !
Et, de nouveau à l’enfant, plus doucement :
— Vem pra cà menino ! Não tenha medo. Agora ele está preso.
(Viens ici, mon petit ! N’aie pas peur. Il est prisonnier maintenant.)
Visiblement, l’enfant peinait à revenir.
Sans quitter Jacques Balestro des yeux, la juge Talvern donna à la femme le conseil suivant :
— Gervaise, dis-lui qu’il est mort, ou tout comme.
La dénommée Gervaise s’accroupit et tendit les bras :
— Nelson, vem cá, por favor ! Ele não pode mais lhe faz mal. É como se estivesse morto.
L’enfant se laissa convaincre. Il reparut dans le bureau. Cette fois, Balestro ne se retourna pas. Le garçon marchait, cuisses serrées, en se blottissant contre la femme blonde que la juge avait appelée Gervaise.
— Il s’est souillé, dit Gervaise à la juge.
— Aucune importance.
La juge tendit les bras à l’enfant, l’assit sur ses genoux et constata qu’en effet il s’était souillé. Elle referma ses bras autour de sa poitrine, déposa un baiser sur sa tempe et murmura : Chuuut.
Puis, elle demanda à Balestro :
— Ça va, Balestro ? L’odeur de la peur ne vous incommode pas ?
Et, à l’enfant, désignant Balestro du doigt :
— Regarde-le bien, Nelson, pendant dix secondes.
Ce que Gervaise traduisit.
— Olha bem o rapaz, Nelson, durante dez segundos.
— Et vous, Balestro, ne baissez pas les yeux.
Dans un murmure, la juge égrena les secondes à l’oreille de l’enfant. Elle sentait sa respiration entre ses bras. Une respiration ponctuée de brèves décharges électriques.
Jacques Balestro tentait de ne pas ciller. Un enfant et deux femmes le regardaient fixement.
— Maintenant, Nelson, demanda la première femme, tu vas me dire comment s’appelle cet homme.
— Como se chama esse rapaz ? traduisit la deuxième femme.
— Tio Ryan, murmura l’enfant.
— Oncle Ryan, traduisit à mi-voix la deuxième femme.
— Dis-le plus fort, demanda la première femme.
— Tio Ryan !
Les deux femmes et l’enfant ne lâchaient pas Balestro des yeux.
— Ryan comment ? demanda la première femme.
— Ryan Padovani, répondit l’enfant. Il répéta : È o tio Ryan !
— Il répète que c’est l’oncle Ryan, traduisit la deuxième femme. Il dit : Ryan Padovani.
— Pourquoi « oncle » ? demanda la première femme.
— Ele quer que a gente chame ele assim.
— Il veut qu’on l’appelle comme ça, traduisit la deuxième femme.
— Qui ça, « on » ?
— Todos os meninos que chegaram.
— Tous les gosses qui arrivent.
Maître Soares semblait émerger d’une longue stupeur. Il leva un doigt timide :
— Madame la juge, il me semble que les allégations de ce garçon…
TALVERN : J’ai sept autres garçons à peu près du même âge à votre disposition, maître, de trois nationalités différentes et bourrés d’allégations identiques. Mais nous verrons ça demain, si vous le voulez bien, M. Balestro a sommeil.
Sa main fourragea dans la tignasse de l’enfant.
— Pour l’heure, nous allons prendre un bon bain.
Et, à Balestro :
— Histoire de nous débarrasser de votre odeur, oncle Ryan.
Mais l’enfant ne voulait pas descendre. Il se pelotonnait dans les bras de la juge. Il posa son menton sur ses genoux qu’il venait de replier et qu’il serrait de toutes ses forces contre sa poitrine. Sur quoi, il planta ses yeux dans ceux de Balestro. Alors, la juge posa son propre menton sur le crâne du garçon. Balestro, qui avait tant de fois eu envie de s’en aller, restait cloué à sa chaise. Ces deux regards superposés le paralysaient. L’électricité s’était remise à parcourir les tendons et les muscles du garçon. Il semblait à la juge Talvern que ce courant avait changé de nature. Elle desserra doucement son étreinte. Ce fut comme si elle ouvrait la porte d’une cage. Poussant de toutes ses forces sur l’arête du fauteuil, le garçon déploya ses jambes, plongea par-dessus le bureau de la juge et, toutes griffes dehors, se planta dans le visage de Balestro dont le fauteuil bascula.
La gendarmerie eut quelque peine à libérer la proie de cet oiseau fou.
— Il m’a crevé un œil ! hurla Balestro.
La métaphore n’est pas mon fort. Le point final d’un livre comme une cloche qu’on soulève, le grand air, le ciel enfin retrouvé, dans mon cas ces images sont à prendre au pied de la lettre. Le ciel, j’y suis. Je suis arrivé chez moi à deux heures du matin, comme Malaussène l’avait prévu. Bo et Ju m’ont installé dans ma nouvelle planque, au sommet d’une Babel chinoise. Un vingt-troisième étage du treizième arrondissement. Demain Paris se déploiera sous mes pieds, je survolerai le plan de Turgot *, une abstraction palpable ! Mes meubles et mes livres sont disposés autour de moi comme si j’habitais là depuis toujours. Déménagement aux frais du Talion, le deuxième en dix-huit mois. Encore une idée de Malaussène. Dès que je suis arrivé j’ai ouvert toutes les fenêtres sur Paris, et j’ai respiré un air saturé de musique. Là est la métaphore. Dans ce que veut faire accroire cette musique… C’est sans aucun doute une idée germée dans une tête de conseiller, soufflée à l’oreille du président et communiquée à la mairie de Paris : fêter la rentrée des écoles et des chômeurs, distraire les jeunes faute de leur trouver du travail, les abrutir de basses telluriques pour qu’ils se mobilisent contre les mitraillages en terrasse, les bombes humaines et les assassinats à venir. L’art du divertissement contre la science de la terreur… Et les jeunes générations se précipitent dans les rues, en masse, garçons et filles, persuadées qu’il y a de l’héroïsme à danser sur le pont du naufrage. Demain les journaux tartineront tous dans le même sens : « Les héros de la fête », ce genre de billevesées.
Gouverner c’est distraire.
Le téléphone a sonné à la seconde où, debout à mon balcon, j’éternuais sur les flonflons de la ville.
C’était Malaussène.
— Bien arrivé, Alceste ?
— Avec une rhinite carabinée, comme prévu.
Je me demande pourquoi je le laisse m’appeler Alceste. Cette fausse complicité n’a pas lieu d’être. Mais il est juste de dire que je supporte très bien les surnoms qu’il donne aux autres auteurs du Talion : avoir appelé Coriolan *ce mégalo de Schmider ou Lorenzaccio ce faux-derche de Ducretoy, ce n’est pas mal vu. Alceste, moi ? Après tout, pourquoi pas ? Enfant déjà je le trouvais plus honorable que Philinte.
— Vous trouverez de la cortisone dans le tiroir de la salle de bains, a répondu Malaussène. Avec des antihistaminiques en comprimés.
Et il y est allé de son ordonnance :
— Deux pulvérisations dans chaque narine, vous allez dormir comme un bébé. Si ça persiste, au réveil ajoutez-y de la cortisone, mais en comprimés cette fois, je vous ai fait un petit assortiment. À boire avec votre café. Vous allez péter le feu !
Puis, il a demandé :
— L’appartement, ça va ? La vue vous plaît ?
*
Quand Alceste a raccroché j’ai laissé mon œil vaguer sur les roses trémières que caressait le clair de lune. Elles ont une fois de plus poussé où elles voulaient, développé des robes inattendues, du blanc rosé au pourpre noir en passant par des jaunes incongrus et des bleutés arachnéens. Robes de bal ou chemises de nuit, avec leurs feuilles mitées elles ont tout envahi, mes impériales guenilleuses. Il n’y a que la nuit pour les assagir. Sous le clair de lune on les croirait presque de la même couleur. Certaines années, elles refusent de pousser ; ces étés-là elles me manquent presque autant que les enfants.
Читать дальше