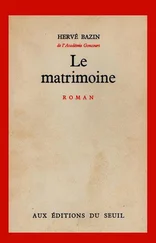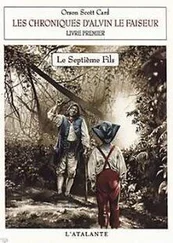« Je crains de m’être mal expliqué… »
Ma confusion m’enferre, qui peut encore donner à penser. M. Lebleye se lève :
« Je vous en prie, monsieur Astin, ceci ne nous regarde pas. Vous faites ce que vous entendez. Résumons-nous. Nous marions d’urgence ces enfants, ils s’installent ici, nous les aidons jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de se suffire. Dieu merci, s’ils ont fait une bêtise, ils ont la chance d’être nés dans deux honnêtes familles. Je le disais à ma femme, en arrivant chez vous : « Tout ça est fâcheux, bien fâcheux, mais avec « M. Astin, nous ne craignons rien, il aura vite « fait de remettre les choses en ordre. »
Il parle, il parle, il me déborde. Quand perdrai-je à la fin cet embarras de la glotte, ce goût d’être coupable et de payer mon dû à qui je ne le dois pas ? Les gémissements du père Lebleye, dont je m’amusais, n’étaient qu’une bonne préparation, destinée à me mettre mal à l’aise pour obtenir le maximum. Elle est ravie, l’agence. Lorsque « les choses » se seront tassées, notre alliance ne pourra qu’augmenter son crédit sur « la place ». Une maison pour la fille, toute meublée, avec le téléphone, deux mille mètres carrés de jardin, l’affaire est excellente. De l’œil, ce professionnel sonde les murs et les toits.
« Il faudra que nous passions à la mairie pour les bans, dit-il encore. Après-demain, trois heures, voulez-vous ? Non, c’est vrai, à trois, j’ai un client. Disons quatre. Je vous attendrai en bas, sous le drapeau, avec ma fille.
— Non, dit M. Astin, j’ai cours. »
Nous irons finalement après-demain, onze heures, si Bachelard m’y autorise. À la grille, M. Lebleye, M me Lebleye ont, cette fois, la poignée de main nerveuse. M. Lebleye murmure :
« Je ne pense pas qu’un contrat… »
Geste évasif de ma part, auquel répond le même geste, généreusement indifférent. Nul besoin de notaire. Communauté légale. Les enfants n’ont rien et les seules espérances, fort minces, sont de mon côté.
Ils sont partis. J’arpente le vivoir. Je tente de faire le point. Plus j’y repense, plus je me sens l’oreille cuisante, moins j’arrive à croire que M. Lebleye ait pu se méprendre. C’est vous qui passeriez en face… Fortunat, mon vieux maître, appelait cela : le conditionnel de suggestion. Qu’une insinuation l’accompagne », il se peut. Mal venus, les Lebleye, dira-t-on, d’y songer ! Voire. Sur les apparences les roués sont les plus stricts et c’est encore montrer leur horreur du scandale que d’en aller gratter un autre, serait-il inventé. Cette sorte de gens n’a aucune peine à prendre l’avantage sur moi. Ils flairent immanquablement vos gênes comme vos fiertés et, se servant des unes pour exciter les autres, ils ont le génie de provoquer des réactions qu’ils se garderaient bien d’avoir eux-mêmes, mais dont ils tirent aussitôt profit. C’est vous qui passeriez en face… Tout serait si bien en ordre, les ragots étouffés, le petit ménage au large, la maison nettoyée d’un père envahissant…
Il va fort, le bonhomme, mais pour se le permettre il a bien ses raisons. On peut là-dessus lui faire confiance, il aura tout pesé, calculé. Il est, pour moi, grand temps de le faire. Résumons-nous, comme dit M. Lebleye. Nous avons à caser, harmonieusement, de telle façon que chacun puisse vivre sans gêner l’autre, sans manquer de ressources, de logement et d’amour, nous avons à caser de l’un ou de l’autre côté de la rue M. Astin, Laure et le couple. Le problème ressemble étrangement à celui du passage du pont par le loup, la chèvre et le chou. Voyons toutes les solutions.
Première solution, déjà écartée, mais à noter pour le principe : le couple va s’installer où il veut. Il n’a ni logement, ni meubles, ni ressources suffisantes. M. Astin reste chez lui, sans fils, sans ménagère. Laure reste chez elle, affamée. Tout le monde est perdant.
Deuxième solution. Le couple va s’installer au premier étage du mair. Même s’il paie un loyer, Laure n’en reste guère moins désargentée. M. Astin reste chez lui, demi-abandonné, Laure, qui pouvait honorablement élever ses neveux, ne pouvant plus — comme dans le cas précédent — servir de bonne à son beau-frère, émarger à son budget sans être soupçonnée. Pour la même raison il ne saurait s’en aller chaque jour, hôte payant, manger sa petite côtelette chez M lle Hombourg. Il a l’air d’un égoïste qui a gardé son bien, qui a laissé sa très pauvre belle-sœur sacrifier le sien à sa place. S’il peut à la rigueur prendre pension chez son fils, on ne voit plus très bien pourquoi ce fils aurait traversé.
Troisième solution. Le couple s’installe au mair. Laure se dépouille complètement et vient s’installer chez moi. Tous commentaires inutiles.
Quatrième solution. Le couple s’installe au pair, avec moi. Nous savons bien, monsieur Astin, que cette solution-là vous allèche. Elle a un côté miraculeux : le long avenir, dont parlait le beau-père, semble, à notre profit, récupéré. Mais Laure, éliminée, n’a plus qu’à mourir d’inanition ; la jeune maîtresse de maison n’aura plus aucun besoin de ses services, si même elle n’en prend pas ombrage. D’autre part, la maison ne se divise pas : nous devrons vivre en commun. La répartition des chambres devient épineuse, puisqu’il n’y en a que trois : celle des garçons, celle de Louise, celle du père. Il faut pour coucher le couple priver quelqu’un de la sienne. Coucherons-nous les mariés dans le vivoir ? Solution peu pratique. À la rigueur, je peux me dévouer, coucher dans la chambre des garçons, que je partagerai avec Michel, lors de ses rares visites. Mais, on vient de me le dire, c’est ma présence même qui sera vite mise en cause. Les jeunes mariés — les vieux, aussi, du reste — supportent mal les témoins. Nul ne tient la chandelle dans une intimité. Dans leurs sorties, leurs menus, leurs aménagements, les invitations, leurs propos, leurs horaires, ils seront obligés de se contraindre, ou de me négliger. Dans les deux cas nous n’aurons qu’un faux paradis, en abîmant le leur.
Cinquième solution. Le couple s’installe au pair, seul. Il y a de la place. Il peut réserver leur chambre à Louise et à Michel. Moi, je vais en face, comme en a si fort envie M. Lebleye. Passons sur le sacrifice de mes habitudes, de mes souvenirs, de ma maison : il n’est pas fait, certes, mais il ne blesserait que moi. Envisageons les deux variantes : A) Laure divise et me loue l’étage. B) Nous vivons en commun. Dans le premier cas nous revenons à la solution deux, inversée, aggravée par le qu’en dira-t-on. Dans le second, c’est un vrai mariage blanc, qui sera réputé noir.
Il n’y a pas de solution.
Non, je dis bien, il n’y a pas de solution. Toutes sont boiteuses. Mais qui ricane ? C’est vous, Mamette, qui répétez : « Si vous aviez épousé Laure… » Évidemment. Un mariage blanc, célébré, reste blanc. Un vrai mariage aurait d’ailleurs les mêmes effets. Voilà donc pourquoi — je n’y avais sur l’instant pas prêté attention — on m’a dit : C’est vous qui passeriez en face avec Madame Laure. Une indication. Une femme sans ressources avec maison, un homme avec ressources sans maison : il avait tout de même vu la solution, le père Lebleye.
Riez, monsieur Astin. Pensez : « Pour une fois que le loup avait envie du chou, on lui offre la chèvre. » Riez encore. Pensez : « Épouser Laure après m’en être si longtemps défendu ! Mais quand je serai mort, au caveau descendu, entre mes deux femmes, l’une et l’autre belle-sœur de leur sœur comme de leur époux, Mamette, riant plus fort que moi, d’un cubitus pointu me donnerait des coups de coude. »
Читать дальше