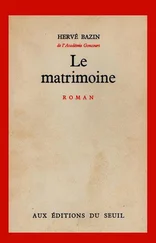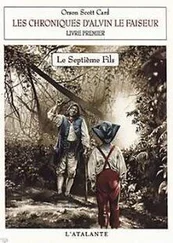Quant à mon sous-lieutenant, que j’étais allé trouver sur place, qui m’avait accueilli avec de l’autorité plein le menton et une belle aisance galonnée, il réagit, à l’annonce — voilée — des projets de Bruno par un puissant sourire, d’interprétation facile. Ainsi son frère songeait à ce qu’il avait dédaigné, à ce qui aurait pu être ses restes. Il n’en semblait pas plus fâché que de l’avenir de Bruno, qui lui assurait un définitif avantage.
« Un petit commis des P. T. T., dit-il, gendre d’un aigrefin de banlieue, voilà qui me gênera certainement pour te donner une bru convenable. Freine-le, au moins, le plus longtemps possible. Je lui dirai d’ailleurs ce que j’en pense à la première occasion. »
Il l’eut quelques jours après, mais ne put décemment s’en servir. Le premier dimanche d’octobre, vers trois heures, j’étais seul dans le vivoir, attendant tout le monde et personne, comme cela devenait mon lot, quand Laure traversa le jardin en criant mon nom. Dans son affolement, mécanisé par quinze ans de navette, elle avait oublié de se défaire d’un plateau qu’elle tenait à la main, bien horizontal. Je le lui pris des mains.
« Maman est morte », dit-elle.
Je remmenai Laure au mair, sous le regard des voisins alertés par ses cris. Dans le capharnaüm flottait l’odeur de la tisane de menthe.
« J’allais reprendre sa tasse, dit Laure. Et vous voyez… »
La tasse gisait, brisée, dans une petite flaque que buvaient les rainures du parquet. M me Hombourg, fixement, regardait le plafond d’où pendaient ses ficelles. Le menton n’était qu’à demi tombé dans un bâillement final qui paraissait d’ennui. Je tirai doucement cette pochette de soie blanche dont elle s’était souvent moquée, la brave dame, en la réputant démodée, je la nouai avec un respect presque amusé en songeant à l’un de ses traits : « Quand on m’aura attaché la mentonnière, alors seulement, mes agneaux, je cesserai de vous servir vos vérités. »
Presque aussitôt Bruno arriva seul, qui d’abord devint vert, mais se maîtrisa très vite, courut téléphoner à sa sœur, à son frère, se mit en quatre pour seconder Laure qui s’était reprise aussi et rangeait tout, préparait tout, en reniflant à petits coups.
Le lendemain ce fut encore Bruno qui, avec moi, s’occupa des formalités : paperasserie, discussion à voix basse sur les tarifs mortuaires, rédaction du faire-part, mise en bière, réception d’une cinquantaine de personnes dégurgitant presque toutes les condoléances réservées à la disparition des grands infirmes : « Dans son état, n’est-ce pas, c’est une délivrance pour elle » (sous-entendu : et pour vous donc, mes pauvres !).
Le mardi matin, sous un petit soleil guilleret d’arrière-saison, qui lui rendait hommage, Mamette rejoignait le commandant, Gisèle, les grands-parents, la tante, la tribu allongée au caveau des Hombourg. Il y eut plus de monde que je ne le pensais, derrière Michel qui, un brassard coupant la manche de l’uniforme neuf, conduisait le deuil. Louise était ravissante, en noir. Les Lebleye des deux branches, au complet, encadraient la future bru, décemment pâlotte et dont j’admis fort bien, cette fois, qu’au moment du défilé, après avoir serré la main de Michel, elle embrassât Bruno, Laure et moi-même, devant son père qui se courbait, un melon sur le cœur. Bachelard s’était délégué lui-même. Je remarquais que mon cousin Rodolphe avait beaucoup grossi. Il y avait la tristesse qu’il fallait, dans l’air, et chez qui on la devait attendre. Je revins presque satisfait et songeant, encore une fois, à une phrase de Mamette commentant la mort d’une amie : « Un enterrement de vieillard n’est jamais dramatique ; il enlève si peu de chose à la vie. »
Le moment le plus désagréable vint ensuite, quand Laure — depuis longtemps chargée de cette mission — pénétra avec nous dans le capharnaüm pour ouvrir le premier tiroir d’une commode Louis XV. (J’essayai de m’arrêter dans l’évocation, forme pieuse de la nécrophagie, mais je réentendis : « Elle est fausse, vous savez, Daniel. ») Du tiroir Laure sortit une boîte de biscuits contenant trois écrins et une enveloppe, que Laure nous distribua aussitôt. La chevalière du commandant allait à Michel ; la bague de fiançailles de Gisèle, que je n’avais jamais réclamée, allait à Louise ; la bague de fiançailles de Mamette allait à Bruno, qui ferait suivre. Moi, j’avais l’enveloppe que je n’ouvris pas tout de suite, car il nous fallait encore, dans le tiroir du dessous, violer un demi-siècle de petits secrets, trier les papiers, séparer le futile de l’important ou, du moins, de ce que peut considérer comme tel un notaire.
Quand je lus ma lettre — écrite deux ans plus tôt — je ne pus m’empêcher de sourire. Forçant le bâillon de la mentonnière, Mamette avait voulu me servir d’ultimes vérités :
Ne craignez rien, Daniel, ceci n’est pas un testament spirituel. Je veux seulement vous remercier de ce que vous avez fait, alors que vous auriez pu ne pas le faire. Si vous ne m’avez pas comblée, en redevenant une seconde fois mon gendre, je reconnais que c’était votre droit et presque notre dû.
Je ne vous recommande personne. Vous êtes déjà trop scrupuleux ; vous avez même si fort le tic de la coulpe qu’avec la foi vous eussiez fait un très bon moine. Faites cependant un peu plus attention à Michel : la vie casse les grands raides. Faites aussi un peu plus attention à Louise : j’ai cru un moment qu’elle avait dans le sang le plus virulent des aphrodisiaques : sa jeunesse, mais je vois bien maintenant qu’elle a surtout une ambition de cocotte. Casez-la le plus vite possible. Et suivez Bruno, à la distance qu’il faut.
Un mot sur Laure, tout de même. Songez que vous n’avez pas été seul, dans la famille, à faire le pélican. On n’en meurt pas, on en vit même très bien, n’est-ce pas ? Mais les pélicans en retraite risquent de secouer leur bec sur un goitre bien sec…
Elle ne m’apprenait rien, la défunte pythonisse. Elle me laissait deux enfants dont je m’étais mal occupé, un troisième dont je m’étais trop occupé.
Et Laure sur les bras, à défaut d’avoir pu la pousser dedans : je ne le savais que trop. La mort de M me Hombourg posait un problème délicat. Elle et sa fille vivaient essentiellement de la demi-pension des veuves. À la mort du commandant, la bicoque d’Anetz avait été dévolue à mes enfants, en indivis, la nue-propriété de la maison de Chelles allant à Laure et l’usufruit à sa mère, ainsi qu’un tout petit paquet d’économies. La demi-pension disparaissait. Une fois les rentes — moins de cent mille francs par an — partagées avec mes enfants, ses cohéritiers, Laure aurait à peine de quoi entretenir le mair, en payer les impôts. Il ne lui resterait pas un sou pour vivre. Si elle choisissait de travailler, tout ce qu’elle pouvait faire, c’était la dame de compagnie ou, d’une façon moins décorative et carrément ancillaire qui sauvegarderait son indépendance, la femme de ménage. (Bienheureuse encore de le pouvoir ! Quand elles se réveillent, ruinées, neuf sur dix des pécores de la petite bourgeoisie, qui maltraitaient leurs bonnes, ne sont même pas capables de prendre leur place.) Si, tant qu’à faire des ménages elle préférait, au moins provisoirement jusqu’à l’envol du dernier de la nichée, continuer à s’occuper du nôtre, elle s’offenserait d’être appointée, elle préférerait certainement rester parmi nous, au pair en quelque sorte, dans l’injuste esclavage des vieilles tantes, à qui l’on fait la charité d’exploiter leur esseulement et qui, entre deux corvées, rafistolent hâtivement les nippes qu’elles n’osent remplacer à vos frais.
Читать дальше