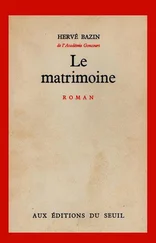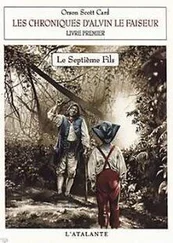Je me gardai de lui rappeler qu’il avait refusé de se mettre à ma place. Je n’étais pas très féru sur la question. Mais je commençais à me piquer au jeu, à mal supporter son désenchantement. Je proposai :
« Manque-lui un peu, Bruno. On s’aperçoit de l’absence.
— Ou on en profite, répliqua-t-il, aussitôt. Tu peux parler ! Du temps de Marie, tu étais sans arrêt fourré chez elle. »
Il rougit, se tortilla.
« Quand j’y réfléchis, je me dis maintenant que nous n’avons pas été très chic. Tu as dû en baver. »
Ce fut ce soir-là que, pour lui donner de l’importance sur quatre roues, je lui offris (en me promettant, si possible, d’en acheter une plus forte) de prendre ma voiture, le jeudi et le samedi.
Trois semaines plus tard, Bruno passa par la maison, avec Odile, avant de la reconduire chez elle. L’absence de cette complicité qui tend un fil entre deux regards, la sonorité du tutoiement me plurent. Bien coiffée, campée sur du nylon, Odile avait perdu de sa grâce adolescente, inondée de cheveux et tournant du talon. L’œil était attentif, la poitrine en bouclier ; le bout de nez, seul, palpitait. Tout montrait qu’elle évitait avec soin d’avoir l’air engagée, comme Bruno évitait l’air avantageux. Ils ne restèrent pas trois minutes, ne dirent pas trois phrases et je ne ressentis un léger pincement qu’au moment du départ, quand je les vis s’asseoir, Bruno à ma place, Odile à la place de Bruno, avec une aisance de couple qui n’en est pas à sa première sortie et qui retrouve ses façons, ses mouvements familiers.
« Il se dessale un peu, tout de même ! dit Louise, par hasard présente.
— Le terme me paraît impropre, répliquai-je.
— Tu ne veux pas dire que ça sent la fleur d’oranger, que tu laisserais faire une bêtise pareille ? » reprit Louise, presque sévère.
Près de nous Laure passa, portant le seau à charbon.
« Tu pourrais aider ta tante, fis-je sèchement.
— Laissez-la, dit Laure. Dans son métier il faut défendre ses mains. »
Mais le lendemain, quand elle put me trouver seul et après avoir longtemps rôdé autour de moi, elle osa me réclamer mon avis :
« Vous n’avez pas répondu à la question de Louise, Daniel.
— Elle est prématurée. »
Laure parut offensée et je lui donnai aussitôt raison. La brièveté de ma réponse la repoussait hors d’un débat où quinze années d’adoption lui donnaient au moins voix consultative. Je lui devais de moins hypocrites égards. Je conseillais à ma fille de lui prendre des mains le seau à charbon, mais je ne le prenais jamais moi-même ; je traitais Laure avec la considération qu’on peut avoir pour une excellente machine à laver. Lors de la découverte de la fiche de donneur, son attitude pourtant m’avait touché. Elle était un instant comme sortie du mur où, pour moi, depuis si longtemps, s’aplatissait son ombre. Je voulus me rattraper :
« Et quel est votre avis, Laure ?
— Leur jeunesse ne m’effraie pas, Daniel. Tout dépend de la petite. Bruno, c’est du lierre et on ne plante pas du lierre sur une roulotte. Je ne voudrais pas… »
Elle se reprit, le verbe « vouloir » lui écorchant la langue, même au conditionnel :
« Enfin, vous le savez mieux que tout autre, vous l’avez montré d’une façon admirable que cet enfant a un droit spécial au bonheur. »
Au mot près, toujours le même et encore plus sucré dans la bouche d’une femme, elle avait trouvé la formule, elle y avait mis de l’autorité. Son corsage en remuait. On côtoie indéfiniment un être, on ne le devine pas, on vit dans l’indifférence de ses sentiments. Ainsi chez Laure, ce n’était pas au benjamin, mais à l’abandonné qu’allait sa préférence, peu marquée, mais profonde. Je n’aurais pas su dire si j’étais satisfait que cette préférence s’accordât à la mienne ou contrarié qu’elle empiétât sur elle. Laure ajoutait :
« Je dis oui, tout de suite, si Odile peut le lui assurer. »
C’était à moi de dire oui. Mais Laure, au moins, ne pensait pas à elle.
Odile revint quatre ou cinq fois, flanquée de Bruno, qui la rencontrait plus fréquemment dehors. Nous les traitions comme des inséparables, en aucune façon comme des fiancés. J’avais dit à Laure : « Il vaut mieux que ce soit long, pour juger » et à Louise : « Il n’y a rien, je ne veux pas qu’on en parle. » Michel, qui fit deux apparitions durant le troisième trimestre, ne paraissait pas au courant ou s’en moquait totalement. Je continuai à décocher à mon voisin, le père de Marie, un coup de chapeau occasionnel. Une réunion d’anciens combattants m’avait permis de rencontrer son frère, le père d’Odile, agent immobilier qui passait pour un petit requin en affaires, mais cultivait, disait-on, une passion « chelléenne » pour la pierre taillée.
« Vous êtes le père de Bruno ? » dit-il en m’abordant.
Et fort civil, il me fit de mon fils les plus grands compliments. À entendre cet homme, dont la prunelle oscillait dans le blanc de l’œil comme la bulle dans le niveau d’eau et semblait chercher à établir la droiture de vos principes. Bruno était de la catégorie des bons petits jeunes, rares aujourd’hui, n’est-ce pas, cher Monsieur, avec qui on peut permettre à sa fille d’aller danser, canoter ou voir un film convenable approuvé par la C. C. C. À la saine camaraderie de « nos enfants » il n’attachait visiblement aucune importance. Je bus du lait, un quart d’heure durant, jusqu’à ce qu’y tombât cette mouche :
« Et M lle Louise ? Toujours aussi pétulante ? »
Politesse inquiète : pour la famille Lebleye, Louise était évidemment l’aventureuse qui, pour les Astin, se nommait Marie. On me rappelait que j’en avais trop aisément pris mon parti et je ne le savais que trop. N’avais-je pas accepté que Louise cherchât un studio, qu’elle trouvât cette chose introuvable, grâce aux bons offices de M. Varange, dont la discrétion tutélaire commençait aussi à lui prêter sa voiture et même, m’assurait-on, s’offrait à dénicher parmi ses relations, puissamment industrielles, un débouché pour mon polytechnicien, sans rien demander en échange, pas même, notamment, la main de ma fille ? Mais qu’y pouvais-je ? Louise était majeure, décidée. Un éclat eût créé un scandale, gênant Bruno, gênant Michel, rendant plus difficile pour Louise le coup de harpon qu’elle finirait par jeter sans aucun doute sur quelque belle proie.
Wait and see, refrain de ma vie. Pour Bruno, l’attente ne serait jamais assez longue. Nous glissions vers de rassurants, d’interminables préliminaires. Craignant pour son prestige, Bruno bûcha fermement son droit dans les deux derniers mois, ce qui lui valut d’être reçu, à un point près. En prévision de son affectation prochaine à un bureau des P. T. T., je lui avais fait opter pour Paris et la banlieue est ; mais l’ordre d’admission réglant celui des nominations, il avait peu de chances d’être pourvu avant un semestre. Un problème se posa pour les vacances. Laure, retenue par sa mère, ne pouvait quitter Chelles. Louise partait en tournée à travers l’Italie. Michel nous abandonnait pour la Provence. Sans la présence d’une amie ou au moins d’une autre femme, il devenait trop voyant d’emmener Odile à L’Émeronce et difficile, au surplus, de lui confier nos casseroles. Son oncle l’invitait, de nouveau, en Auvergne. Bruno, peu soucieux de l’y laisser seule, se démena, intrigua, je ne sais trop comment, tant et si bien que les Lebleye, nous rendant la monnaie de notre pièce, lui proposèrent de les suivre : on lui prêta la tente d’Odile, à partager avec un acolyte de la tribu. Je lui donnai, bien entendu, la voiture.
Читать дальше