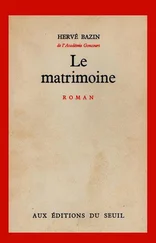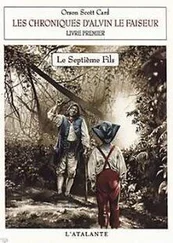« Tu as su ? Le fourreur de la rue Jean-de-Chelles, eh bien, il épouse la fille de sa femme de journée. Trente ans de plus trente millions, merde alors ! Faire la putain, encore, on peut arrêter. Mais putain à vie, au nom de la loi, ce n’est pas drôle. »
Nul esprit de révolte, pourtant : pas plus que de soumission. S’il respecte peu, il fulmine encore moins. Les choses sont ce qu’elles sont : pas belles, c’est dommage, on n’y peut rien. L’histoire est une machine à fabriquer de la bêtise et de la méchanceté ; la plus récente le montre assez, pour qui, faute de l’avoir subie, Bruno n’éprouve ni plus ni moins d’horreur que pour les cruautés assyriennes, les assassinats de Néron ou la Saint-Barthélemy. Pour lui, comme pour Michel, comme pour Louise, les guerres ne sont pas un sujet de conversation : qui en parle se date. Nous avons eu nos morts dans l’affaire : chapeau ! Puis silence. Puis recul et dans le recul, un refus : il n’est pas dans le coup, il n’est pas fou, il n’accepte pas l’héritage. L’actualité ne l’en fera pas démordre. D’un engagé volontaire qui s’est fait tuer, il dira, sans amitié, sans mépris :
« Il avait le virus. »
Et d’un superbe Mau-Mau qui, à la une de France-Soir, brandit un non moins superbe javelot :
« Au lieu de s’entraîner pour passer les 75 mètres ! »
Olympique refuge des doux. La force pour l’arène : là, les Ricains ont le droit de « faire saigner » les Russes ou vice versa. Là, mon pacifique s’échauffe. Vous l’entendrez rugir, les soirs de catch télévisé, devant cette pelote de membres que font deux monstres velus, suants, dont on ne sait qui fera le serpent et qui le Laocoon :
« Vas-y, tords-le, mais tords-le donc ! »
Si du sport nous passions à l’art, à la littérature, le saut pourrait paraître inconsidéré. D’une bonne toile, pourtant, d’un livre qu’il a lu d’une traite, Bruno dira, laconique :
« Ça cogne. »
Trente élèves m’ont appris ce que signifie aujourd’hui ce langage et je n’en suis pas peu fier : car j’en connais de très savants qui se penchent, critiquent leur émotion avec une prudence de médecin à l’écoute d’un cœur et ont l’oreille moins sûre au bout de leur stéthoscope.
Quatorze juillet. Nous devrions être partis, mais Louise, qui n’était libre qu’à partir du 13, nous a retardés. Nous faisons nos valises pour demain. Seul dans ma chambre, je prépare la mienne. Par la fenêtre grande ouverte m’arrivent de lointaines bouffées sonores où s’embrouillent les sifflets de la gare et les patriotiques sonneries de la clique, sans doute réunie autour du monument, dans le parc de la mairie. Dans le couloir on traîne longuement la grande malle d’osier. J’entends Bruno qui proteste :
« Tu ne pouvais pas m’appeler, non ? »
Il dévale l’escalier, riant aux éclats, je ne sais pourquoi, avec une gaieté d’enfant dans une gorge d’homme ; et de ce rire, qui m’allège et m’agace, je ne saurais dire si j’ai envie qu’il se prolonge ou qu’il s’arrête.
L’heure a sonné pour lui, pour moi. Fin juin, il a passé la seconde partie de son bachot, sans éclat, mais sans difficulté majeure. Finie, la navette Chelles-Villemomble, dans la 4 CV. Finie, notre petite vie à deux. Je retrouve ma panique. Par quoi, maintenant, va-t-il m’être enlevé ?
Ce n’est pas le vrai problème, je sais, qui se pose autrement : que vais-je en faire ? Et mieux : que va-t-il faire ? Michel n’a pas hésité, qui s’est mis tout de suite sur ses rails et qui termine sa première année de Polytechnique à la satisfaction générale (un peu fatigué, toutefois, et sans avoir réussi à reprendre plus de trois places sur les chefs de file de la botte). Il n’y a pas eu non plus de problème, en somme, pour Louise, qui nous a imposé son choix et qui commence à gagner quelque argent (elle m’a offert une pension que j’ai acceptée pour ménager ses susceptibilités, tout en la réduisant de moitié pour ménageries miennes). Bruno, lui, n’a pas de vocation. Interrogé à ce sujet, il s’est toujours montré vague, évasif :
« J’ai le temps. On verra. »
Ou encore :
« Je ne suis pas encore reçu. Ne me porte pas la guigne. »
Ai-je tellement cherché une réponse ? L’incertitude s’infléchit mieux. On s’excuse, on se répète : « Après tout, il a raison, il peut voir venir, le bachot n’est rien. Qu’il fasse d’abord une licence… Il en aura au moins pour trois ans. »
Mais quelle licence ? La plupart des pères aiment se répéter chez leurs enfants, préparer leur avenir avec du passé ; j’avais le vice inverse, j’ai poussé Bruno sur « moderne », l’écartant ainsi, non seulement, de ma propre carrière, mais de la licence ès lettres. Il se trouverait même un peu handicapé pour faire sa licence en droit, chère aux familles et si commode pour jouer les prolongations. Je ne lui crois pas assez de moyens pour une licence ès sciences, à plus forte raison pour les grandes écoles. Il n’a pas non plus le don des langues qui le ferait retomber, d’ailleurs, dans le professorat. La pharmacie, la médecine, je ne l’y vois guère et je songe au fonds, au cabinet, qu’il n’acquerrait pas sans aide. Je suis à peu près incapable de la lui apporter (Michel, lui-même, sauf mariage riche — et il ne l’ignore pas, je jurerais qu’il y pense — ne sera jamais plus tard qu’un bon ingénieur sans capitaux, un appointé de première classe attaché à la fortune d’autrui). Technique, administration, commerce… Restent évidemment beaucoup de portes dont je ne sais comment graisser les gonds. Cette ignorance des pères, enfermés dans leur village de routines ! Cette déréliction de paysans dont le gars va être pris au conseil ! Si Bruno n’a pas d’idée précise, je n’en ai pas non plus, je n’ai pas envie d’en avoir. Pour être délivré de toute comparaison, pour n’être pas offusqué, concurrencé dans sa spécialité par l’un des siens, je souhaite seulement — comme il est toujours préférable pour les enfants d’une même famille — qu’il se singularise, qu’il fasse autre chose. Et qu’il ne le fasse pas loin.
On frappe, on pousse la porte. Voilà Bruno, qui demande : « On peut ? » jette un coup d’œil au portrait de sa mère et, lui trouvant un air penché, le redresse d’un doigt. Un autre pas : voilà Louise que précède son parfum.
« Papa, j’ai réfléchi », fait Bruno, tout à trac.
Aurait-il choisi un métier, brusquement, sous l’égide de Michel ?
« Tu m’as demandé ce que je voulais », continue Bruno.
Autre affaire. D’un coup sec je referme ma valise. Aurait-il changé d’avis, opté pour l’Angleterre ? Michel, lui-même, qui a besoin de repos, annonçait hier qu’il resterait un mois à L’Émeronce avant d’accepter l’invitation d’un de ses camarades de Louis-le-Grand, fils d’un industriel du Midi et qui, sous-admissible l’an passé, vient de réussir au dernier concours. Mais sans Bruno mes vacances sont gâchées.
« Rassure-toi, dit Bruno, pas question de te fausser compagnie. On va seulement abuser de toi. »
On : c’est une délégation, utilisant les pouvoirs bien connus et la créance présente de Bruno.
« On aimerait emmener des amis à L’Émeronce. Ils feraient leur propre tambouille et camperaient dans le petit pré.
— Qui ? » murmure M. Astin, méfiant, mais dont le seul mot est un consentement.
Ce n’est pas que ça l’emballe, loin de là. Il grognerait volontiers : « Anetz, mon isoloir, mon reposoir, ils vont m’en faire un foutoir. Quelle rage de rassemblement ils ont, tous ! On se mélangeait moins de mon temps. La famille, ce n’était pas la bande. » Mais M. Astin est un père moderne, ouvert et généreux, qui ne ronchonne qu’en dedans.
Читать дальше