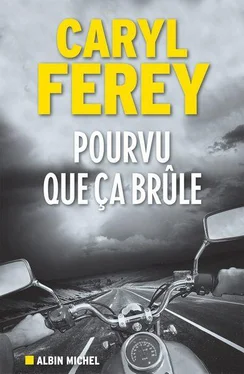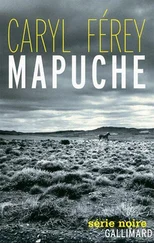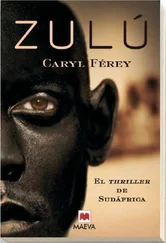Les ceviches des restaurants de Bahia Blanca étaient délicieux, comme José Luis et ses amis. Chorizo-Bouillant profita de la halte pour séduire une de ses copines lors d’une nuit particulièrement arrosée, moi pour imaginer la dernière scène d’amour entre Gabriela et Esteban, seul sur la plage de sable blanc face aux rouleaux qui défilaient. Nous promîmes de repasser par Bahia Blanca sur la route du retour.
La chaleur grandit à mesure que nous montions vers Antofagasta, Clope-Dur assurait les relais au volant de la Chevrolet, Ippon-Sanglant tenait le coup en disant « Putain » — le soleil, le désert, la poussière avalée, tous ces pisco sour qu’il fallait boire pour suivre le rythme, putain ! Quittant la Panaméricaine, nous traversâmes le désert jusqu’à San Pedro d’Atacama, mille kilomètres plus au nord : Longue-Figure, notre vieux complice mapuche, nous y attendait de sandales fermes.
Longue-Figure descendait du Pérou, ses appareils photo en bandoulière, avec son éternel air de débarquer des étoiles. Le paysage de l’Atacama, aride, minéral et désertique, s’y prêtait magnifiquement. Nous louâmes un rancho près de la vallée de la Lune, dont la terrasse donnait sur des crépuscules montagneux d’un genre fabuleux. La roche me parle. L’univers minéral. La mémoire du temps, ses mots secrets… Mes équipiers étaient dorénavant rôdés au Chili, pays géographique s’il en est avec ses Andes omniprésentes, ses secousses telluriques hebdomadaires (bizarre de se réveiller en sursaut avec les rideaux de la chambre inclinés), ses catastrophes et ses volcans, endormis ou menaçants. Les hauts plateaux de l’Atacama étaient là, sous nos yeux avides, beauté brute, pure.
À cinq mille mètres d’altitude, il fallait mâcher de la coca pour garder le cerveau irrigué, se munir d’un guide pour ne pas se perdre dans les immensités, parfum d’aventure et de solitude. Dans ce désert — un des plus hauts du monde — nous croisâmes des titans sculptés par le vent le long des pistes poussiéreuses, des carcasses de camion, des lacs au fond des plaines, des montagnes érodées. Je suis resté des heures, en silence, goûtant tous les verbes vivants en moi avec la seule amertume de la coca. Les paysages de l’Atacama me remplissaient de poésie sauvage, de liberté et de désespoir — un jour je ne verrais plus tout ça…
Nul besoin de drogues, de religion pour affronter la vision de ce désert d’altitude : Nietzsche est là, en pierre et en os, rameutant la poésie de René Char pour me poser, délicat, sur le fil du rasoir de la vie, la meilleure dope qui soit.
Je prenais ma dose.
Le Salar de Tara, auquel on accédait après plusieurs heures de piste hallucinante, se prêtait particulièrement bien au final de mon livre, avec ce vent glacé à décorner les bœufs, ses cruels caranchos et sa mer translucide qui s’étend au pied des volcans, à perte de vue, au-delà de la frontière bolivienne. Je situai les dernières scènes de Condor dans ce salar , un décor à la Sergio Leone propre à un duel à mort et à l’errance des âmes.
Du sublime, enfin.
La nature. Les pierres et les hommes. L’écriture.
Quittant San Pedro par une route de sel à travers les hauts plateaux, nous regagnâmes la civilisation avec une pointe de mélancolie. La poussière de l’Atacama redescendait à peine sur nos corps éreintés par l’altitude, le pisco et les milliers de kilomètres avalés depuis notre départ de Santiago, dix jours plus tôt.
Antofagasta, Chañaral, Copiapó, Vallenar : nous traversâmes des villes minières à l’ambiance rustique, suivîmes la nationale camionneuse et ses animitas (« petites âmes ») qui ponctuaient le bord de route, cortège funèbre de sépultures rappelant le prix humain payé à l’expansion du pays… C’était assez flippant de voir toutes ces croix sur le bas-côté, une par kilomètre, surtout quand un semi-remorque chargé de liquides hautement inflammables vous double en pleine côte, vous et les camions qui vous précèdent, à grand renfort de klaxon. On se dit alors qu’il faut :
1/ les avoir bien accrochées pour être routier au Chili,
2/ être complètement con.
Une flânerie sur la côte semblant de bon aloi face au chaos mécanique, nous déviâmes vers la réserve qui menait à Los Choros, saluant charmantes vigognes et guanacos d’un coup de gaz fraternel. Le village de Los Choros était assoupi, comme tout ce qui traîne sur la côte nord du pays, un monde au silence sous un soleil de plomb. Pas âme qui vive sur la place. Enfin, échappée d’une fenêtre ouverte, la voix de Violeta Parra nous guida.
Le kisco du village passait un vieux disque de la chanteuse chilienne, suicidée par amour mais sans rancune : Gracias a la vida . La fille qui tenait la petite épicerie avait un piercing branché, un sourire avenant et le visage de sa mère, qui sortait les empenadas du four. Non, il n’y avait pas de chambres à louer dans le village, mais des cabanes en bord de mer qui feraient certainement notre affaire.
De fait, l’océan un peu plus loin s’écroulait le long de rochers impavides, les criques se terraient dans les angles pour qu’on mérite de les trouver, et toujours personne à l’horizon : tout à fait ce qu’il nous fallait… Le soir tombait quand on a sonné à la grille d’Yvonne.
Prénom français mais chilienne d’origine germano-suisse, elle louait des cabanas aux gens de passage. Yvonne nous accueillit à l’entrée, la soixantaine décontractée, de longs cheveux blond et blanc, mais l’œil acéré devant l’allure du Mapuche qui nous accompagnait. Por seguro , avec ses sandales poussiéreuses, ses cheveux à la taille et son accent du sud, Longue-Figure n’avait pas la tête d’un touriste. Des cabanas à louer, fallait voir. La patronne du lieu aperçut alors Loutre-Bouclée, la seule fille du groupe, se dérida et, dans un sourire retrouvé, consentit à ouvrir la grille, elle aussi blanche. En revanche, négocier le prix alors qu’il n’y avait pas un chat dans les environs, pas question : c’était cher ou rien.
Yvonne était heureuse de nous voir, des Français c’était formidable, elle baragouina quelques mots, repassant nos billets comme on caresse un petit chat avant de les ranger dans sa cassette. C’était touchant. Comme je lui expliquai le but du voyage (écrire un livre sur le Chili d’hier et d’aujourd’hui), Yvonne compatit.
La dictature, oui, c’était une époque terrible. Mais il fallait remettre les événements dans leur contexte : la période était dure pour tout le monde, elle-même avait dû faire barrage de son corps pour défendre la voiture de son père que les métayers, aiguillonnés par les chimères du parti de l’Unité populaire d’Allende, voulaient voler ainsi que leur domaine dans le Sud. La voiture de son père, c’est tout ce que la jeune Yvonne avait pu sauver de l’expropriation forcée : sa famille avait perdu tout le reste, terres, propriété, Mercedes, une débandade socialiste, ses frères et sœurs avaient dû se réfugier en Suisse, les pauvres avaient souffert dans la chair de leur porte-monnaie, ils avaient connu l’exil, l’humiliation. Alors oui, Pinochet avait été dur avec les communistes, mais si Allende était resté au pouvoir, le Chili serait aujourd’hui comme le Venezuela de Chavez, un pays en proie au chaos et à l’insécurité.
« La dictature a été mal interprétée », répétait Yvonne.
Pour sûr.
Sur les 771 enquêtes menées contre les agents de l’État accusés de crimes contre l’humanité, 526 inculpés avaient été condamnés sans sentences définitives, 173 avaient été condamnés avec des sentences définitives sans être incarcérés, 6 avaient été condamnés mais libérés par réduction ou commutation de peines, 66 avaient été en prison de manière effective. Des prisons cinq étoiles, où Contreras, le chef de la sanglante DINA, finirait sa vie sans un regret.
Читать дальше