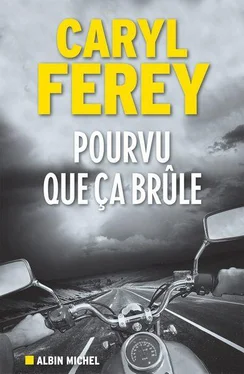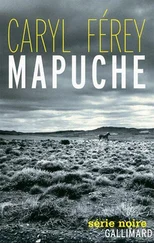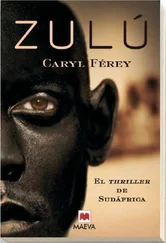Au Chili, l’inégalité sociale est l’une des plus importantes des pays développés. Les grandes familles qui aujourd’hui se partagent les richesses ont hérité de la noblesse espagnole conquérante le peu de goût pour le partage, et un mépris souverain pour le peuple en général.
Salvador Allende avait tenté de remédier au problème en créant le premier parti socialiste du pays. Médecin de formation, il avait autopsié mille six cents enfants morts dans les rues (malnutrition, violences, maladies) et savait que les carences subies au plus jeune âge étaient irréversibles. Une fois élu démocratiquement, il prit comme première mesure la distribution de lait aux enfants lors de leur arrivée à l’école, pour que les plus pauvres aient au moins une chance de grandir et développer leur cerveau comme les autres. Puis, pour financer ses campagnes d’alphabétisation et de protection sociale, Allende avait décidé de nationaliser l’extraction du cuivre — première richesse du pays —, jusqu’alors exploité par les multinationales majoritairement nord-américaines.
C’était trop pour Nixon : « Il faut buter ce fils de pute ! » avait-il vociféré à l’intention de son ambassadeur à Santiago.
Le général Pinochet (qu’Allende avait mis à la tête de l’armée) avait ainsi rétabli l’ordre avec l’aide de la CIA, un ordre politique mais aussi économique. Les Chicago Boys, qui avaient étudié les travaux d’Hayek et Friedman aux États-Unis, appliquèrent ces nouvelles théories au lendemain du coup d’État, faisant du Chili dès 1973 le premier pays néo-libéral au monde.
Le secteur privé dictant la loi d’un marché dérégulé tous azimuts, tout y est payant : études, sécurité sociale, retraites, contraignant la population à emprunter pour vivre. Une bonne manière de faire taire les contestations. Quant à la lutte des classes, même les caissières des supermarchés prétendent aimer les multinationales parce qu’elles sont riches !
Désespérant.
Heureusement, la jeunesse s’était mobilisée pour réclamer des études « gratuites et de qualité », et avait organisé des manifestations monstres qui avaient secoué le pays. C’est aussi cet espoir que je voulais dépeindre dans mon livre « chilien ».
L’idée s’était imposée un soir à la Maison de l’Amérique latine à Paris, lorsque je présentai Mapuche avec mes amis argentins et l’avocate des Grands-Mères. L’évocation de ces années sombres ne laissait pas indemne, encore moins ceux qui, présents dans la salle, avaient subi torture, disparition ou emprisonnement. L’ambiance était tendue entre ex-factions d’extrême gauche quand une femme de trente-cinq ans avait pris la parole ; Renata expliqua que son père avait été enlevé et tué dans le cadre du plan Condor, un plan d’extermination des opposants politiques par les services secrets de Pinochet et ceux des dictatures affiliées. Accidents, suicides, assassinats crapuleux, attentats revendiqués par des organisations fantoches, disparitions… : soixante mille personnes avaient ainsi été exterminées à travers le monde. Sa mère, incarcérée au Stade national de Santiago alors qu’elle était enceinte, aurait dû être abusée avec les autres détenues mais les geôliers, qui venaient de violer à mort l’une d’entre elles, avaient été punis par leur officier : interdiction d’abuser des prisonnières pendant deux mois.
Renata avait bénéficié de ce sursis sordide pour survivre dans le ventre de sa mère, libérée puis exilée en France. Renata était née trois jours après leur arrivée, sans malformations ou tares irrémédiables causées par la torture in utero . Ce qui ne l’empêchait pas, trente-cinq ans après les faits, de porter plainte au Chili pour l’enlèvement de son père et les sévices subis.
Les voix discordantes s’étaient tues dans la salle chauffée à blanc ; Renata m’offrait le titre de mon futur roman, Condor , et le background d’un personnage clé, Edwards.
De mon premier voyage au Chili, j’avais gardé une foule d’informations concernant la situation politique et sociale des Mapuches, et l’énigme de la machi continuait de me tarabuster. Comment une vieille femme ignorante du planisphère terrestre avait-elle pu prédire que l’éruption d’un volcan islandais toucherait la France ?
Poca, la petite danseuse mapuche, m’avait mis sur la piste en me révélant un fait étrange survenu lors de son enfance, lorsqu’une araignée l’avait mordue au bras : la médecine se révélant impuissante face au venin, la fièvre avait failli l’emporter. Sa mère priait les dieux mapuches sur son lit d’agonie, désespérée, quand, après des jours de délire, la fièvre était subitement retombée. Poca garderait une brûlure impressionnante sur le bras mais elle vivrait.
Quant à la machi , elle n’était pas venue la soigner. D’après elle, cette mésaventure participait d’un long processus qui, au prix d’épreuves retorses pouvant durer toute la vie, amènerait un jour la jeune femme au pouvoir des machis : elle aussi communiquerait avec les volcans. Poca refusait d’y croire. Elle voulait être danseuse, pas chamane d’une communauté d’Araucanie perdue dans les bois, même si le destin la rattrapait.
Lors de nos contacts par réseaux sociaux, j’appris en effet qu’elle venait d’avoir un terrible accident de voiture : alors qu’elle conduisait sur l’autoroute, une pluie de grêlons gros comme des poings s’était soudain abattue sur elle, qui avait perdu le contrôle du véhicule, une jambe et les côtes brisées dans l’accident.
Je ne savais trop quoi en penser — sinon que bien des choses nous échappent. Mais les mésaventures de Poca quant à son devenir machi m’inspirèrent le personnage de Gabriela, jeune vidéaste mapuche exilée à Santiago et étudiante militante.
Esteban Roz-Tagle serait son alter ego masculin, fils d’une des plus grosses fortunes du Chili, un avocat spécialisé dans les « causes perdues » et surtout dans le sabotage de sa vie pour se venger de ses biens trop mal acquis. D’une désinvolture passionnellement suicidaire, Esteban a le comportement anarchiste de Belmondo dans Pierrot le fou , se trimballe pieds nus dans son Aston Martin et écrit sous drogue et en secret des contes morbides où la poésie caresse l’ultra-violence. Un type que j’aimais bien.
Un autre personnage central émergea vite, Stefano, un ancien du MIR (la gauche révolutionnaire) chargé de la protection d’Allende qui, après avoir réussi à fuir le palais présidentiel bombardé lors du coup d’État de Pinochet et un long exil en France, est revenu à Santiago pour monter un petit cinéma de quartier. Il vit depuis avec Gabriela, qu’il considère comme la fille qu’il n’a jamais eue. Stefano aussi est un désillusionné de l’amour.
L’histoire de Condor commence à La Victoria, la banlieue déshéritée de la capitale, symbole de la résistance à la dictature. Gabriela et Stefano passent un film dans l’église de leur ami curé, le vieux Patricio, quand on découvre le corps du fils d’un ami sur un terrain vague ; c’est le quatrième adolescent qu’on retrouve en dix jours, sans explication. Gabriela, qui filme tout avec sa GoPro, découvre des traces de poudre blanche sous les narines de la jeune victime : de la cocaïne ?
Contacté par Gabriela, Esteban se prend d’une passion suspecte pour cette « cause perdue », embarque la vidéaste dans son Aston Martin et son délire de gosse de riches anéanti de l’intérieur. Leur première journée ensemble les voit enquêter à La Victoria, ferrailler avec les carabiniers, demander en vain l’aide du père d’Esteban, qui possède la moitié des médias du pays, boire du pisco sour au-delà du raisonnable et se réveiller le lendemain matin sur une plage isolée à soixante kilomètres de Santiago… Les rouleaux se fracassent sur le rivage, ils n’ont aucun souvenir de ce qui a pu se passer mais la robe de Gabriela est trempée : qu’ont-ils fait de leur nuit ? Il s’est passé quelque chose d’étrange, l’apprentie machi le sent, comme un mauvais rêve.
Читать дальше