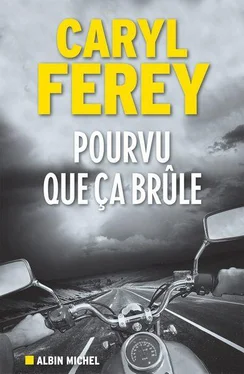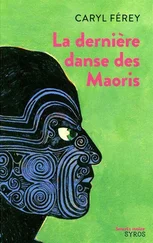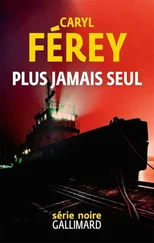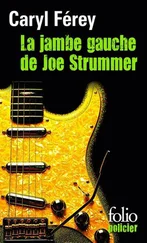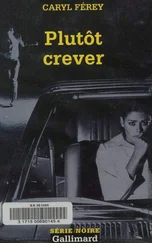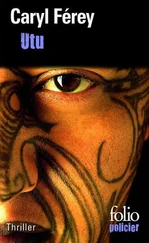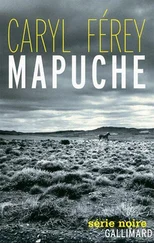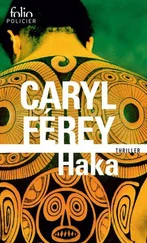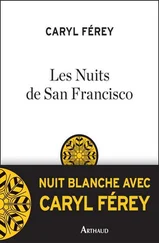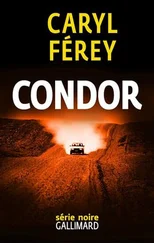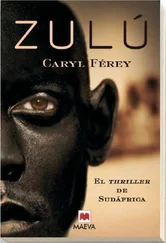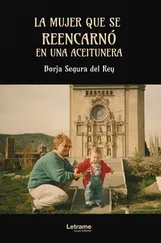Un peuple volontaire.
Ce qui ne cachait pas la réalité : un taux d’incarcération à la hauteur des armes en circulation, vingt millions de personnes vivant dans des mobile homes, des travailleurs pauvres cumulant les jobs pourris pour payer leurs dettes (sans système d’assurance santé digne de ce nom, une simple jambe cassée suffit à vous mettre sur la paille), autant de gens sortis des statistiques du chômage pour avoir refusé des tâches indignes ou sans rapport avec leurs compétences, la loi du « marche ou crève » sévit dans tous les États, avec l’obligation de garder le sourire puisque ici il est peu recommandé de paraître déprimé, malade, oisif ou pauvre, comme si l’on était atteint d’un virus contagieux.
Le rêve américain.
Une vraie beauté pourtant, avec ses parcs nationaux, ses déserts de serpents à sonnette, ses séquoias géants, et toujours ses routes sans fin où l’on se surprend à chercher la caméra du film. Le mien commençait à se structurer, autour de Flagstaff où nous avions passé plusieurs jours et de ma rencontre avec l’Indien oglala. De retour vers la côte après six mille kilomètres à travers l’Ouest, nous fîmes un stop pour dormir à Fresno, 500 000 habitants, estampillé par un magazine comme « la deuxième ville la plus naze des États-Unis ».
On n’avait pas hâte de voir la première.
Fresno n’avait pas de centre-ville, que des buildings amorphes le long d’avenues vides, des jets d’eau sans enfants, aucun bar ou restaurant à l’horizon. Le portier de l’hôtel nous indiqua la rue festive de la ville, dix blocs plus loin. Nous y trouvâmes un bar-restaurant du genre cow-boys pour les jeunes du coin. À voir les nuques rases des garçons, les casquettes de base-ball et leurs rires gras dégoulinant dans les décolletés, j’avais mal aux filles. Nous bûmes des verres à la terrasse du seul bar ouvert jusqu’à une heure du matin : il était moins une quand une trentaine de policiers nous ont encerclés, armés de torches et la main sur la matraque qui pendait à leur ceinture.
« C’est l’heure, maintenant dégagez ! Dégagez ! Allez ! »
Ils nous aveuglaient, ces flics au front bas qui visiblement n’attendaient qu’un mot pour taper dans le tas. Très désagréable.
De retour à San Francisco, je pensais toujours au Sioux croisé sur la piste, à son errance alcoolique à travers ce pays qui n’était plus le sien depuis des lustres mais qui, s’il n’avait plus de ceinture pour retenir son pauvre froc, me vantait la qualité de ses chaussures, la seule chose qui le portait encore.
Mal au cœur.
Mal au corps.
À l’enfance, et à mes rêves d’Indiens.
Je voulais écrire sur lui, tenter de retracer son parcours pour témoigner de la déroute de son peuple, mais il me manquait un lien.
Nous sortions d’un cinéma de quartier où passait un documentaire sur Death, le premier groupe punk noir, profitâmes d’un rayon de soleil pour flâner en terrasse. Le Libraire-qui-trouvait-ça-nul n’est pas un macho (la faute chez nous est éliminatoire) mais laissez deux garçons ensemble et le cerveau reptilien revient au petit trot : l’Amérique c’était bien joli, mais nous étions plutôt déçus par la prestance des Californiennes. Mal habillées, mal arrangées, mal dégrossies, on était loin des canons parisiens.
« Pour une fois qu’on peut mettre la pâtée aux Amerloques ! » plaisantait le Libraire-qui-trouvait-ça-nul.
Et puis soudain on s’est tus. Une femme passa dans notre champ de vision, vêtue d’une petite robe toute simple qui dégageait la courbe de ses épaules, ses bras, son visage aux cheveux libres flottant sur le trottoir, une apparition aérienne. Cette grâce, cette démarche, cette souplesse si féminines, oh Lord , je retirai en silence toutes les bêtises francophiles accumulées en un mois d’Amérique : cette jeune femme avait l’élégance au bout des doigts, qui gravitaient à hauteur de ses hanches. Elle chaloupa devant la terrasse où quelques tables nous empêchaient de l’admirer en pied, marcha sur le trottoir comme sur un fil de soie ; nous suivions le mouvement de sa robe, quand un choc me pulvérisa.
La femme qui passait devant moi était amputée de la jambe droite. La vie l’avait sciée jusqu’au genou, moignon obscène sous sa robe qui dansait. La vision était d’autant plus brutale que parfaitement inattendue. Le secret de sa grâce préservée : une prothèse hydraulique fixée à son genou amputé, articulée pour épouser les mouvements de sa jambe, petite merveille technologique qui nous laissa sans voix.
La fille bipa l’ouverture de sa voiture garée là, grimpa avec aisance, démarra et s’engagea sur la rue où elle disparut bientôt, par enchantement.
« Tu as vu ce que je viens de voir ? » souffla le Libraire-qui-trouvait-ça-nul, estomaqué.
Bien sûr ! Cette femme au genou blessé — wounded knee —, le Sioux dont la tribu avait été massacrée là-bas : je tenais les deux personnages de mon livre californien.
Une pauvre, pauvre histoire d’amour.
Le Lakota de Flagstaff m’a remué les tripes à en vomir de rage et d’impuissance sur un parking d’hôtel, tout comme la beauté amputée de cette femme croisée dans la rue de San Francisco. Je laisse le cynisme aux cœurs de chenille. D’où je viens, on s’enivre peut-être un peu trop mais on ne mange pas de ce poison-là.
Deux récits parallèles se croisent dans Les Nuits de San Francisco . Celle de Jane, une fille grandie à Fresno ayant pour première ambition de quitter la ville. Lors de la soirée de fin de diplôme, elle se fait peloter par son petit ami devant les yeux de ses copains cachés dans les buissons du jardin ; alertée par leurs rires, Jane veut repartir à la fête mais son redneck de petit copain ne l’entend pas de cette oreille et, puisqu’elle va poursuivre ses études ailleurs, la viole, en souvenir de Fresno. Devenue à San Francisco une mannequin à la mode et un peu trop portée sur la cocaïne, Jane s’en sort grâce à un jeune musicien de rock rencontré à Flagstaff, qui parcourt le pays avec son frère.
Le jeune couple a un enfant, ils sont beaux, fauchés et heureux, jusqu’à ce qu’un accident broie leur vie.
L’année de mes vingt ans, sur une longue ligne droite où je roulais depuis Montfort, un vieux à demi aveugle conduisant un paquebot des années 1970 m’avait soudain coupé la route, plantant son tank au beau milieu de la route. Sans ceinture, à quatre-vingt-dix kilomètres à l’heure, je choisis de percuter le bout du capot du chauffard. Sous le choc ma R5 opéra un demi-tour sur elle-même tout en survolant le fossé et retrouva miraculeusement la portion d’asphalte, en sens inverse, sans qu’aucun véhicule soit venu me heurter en retour.
Jane, dans mon livre, a moins de chance : sa voiture part en tonneaux, causant la mort de son bébé et l’amputation de sa jambe droite.
À la dérive, seule et psychiquement détruite, Jane rencontre un homeless dans un parc de la ville, un Indien oglala. Descendant de rescapés de Wounded Knee, le Sioux a quitté sa réserve où le désœuvrement le consignait, travaillé un moment comme laveur de vitres ou manœuvre sur les chantiers, s’est mis à picoler, à errer de ville en ville avant de se noyer à Las Vegas et de finir sa course à San Francisco, grossissant les rangs des sans-abri détraqués qui ne se font pas de cadeaux. Elle et lui verront une dernière fois les lumières de la ville, éclopés du rêve américain, mais bien calés l’un contre l’autre… Solidarité des barbelés.
Il y a un ennemi à fuir en littérature : l’idéologie. Si j’avais à écrire un livre sur le Cambodge, la Chine, l’URSS ou même Cuba, la « gauche » en prendrait pour son grade. Il se trouve qu’en Amérique du Sud, les dictatures ont toutes été d’extrême droite et que ce continent m’attire pour des raisons historiques, géographiques, ethniques. Un travail de journaliste reporter est la base de mes romans, qui se doivent de donner la vision la plus juste d’un pays. Si les passages trop didactiques sont à éviter, il faut que le lecteur, à travers la fiction, sorte du livre mieux informé qu’il n’y est entré. Certains d’entre eux n’aiment pas trop être secoués, c’est pourtant ce que j’essaie de faire à travers les émotions de mes héros.
Читать дальше