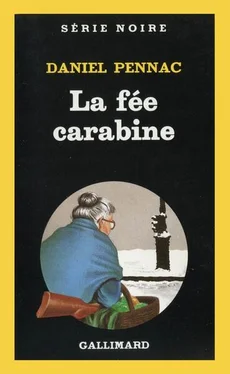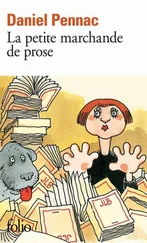— On a tout le temps.
— Pas toi, Ben, oncle Stojil a dit qu’il passerait ce soir.
(Stojil, je t’en prie, laisse-moi dans cette nuit rouge, avec ma sœur préférée.)
— Il a besoin de toi, Ben, il ne se remet pas de l’assassinat de madame Dolgorouki. Va, si je trouve quelque chose, je t’appellerai.
* * *
Il est arrivé, Stojil. Il a pris une chaise. Il s’est assis seul au milieu de la chambre où dorment les enfants et les grands-pères. Il m’attend. C’est presque devenu une habitude entre nous, d’écouter dormir les vieux et les mômes. Les enfants sur les lits du dessus, et leur grand-père attitré au-dessous. (Une idée de Thérèse, approuvée par Clara, plébiscitée par les petits, et autorisée par mon autorité. Secoués comme ils l’étaient en arrivant chez nous, les vieux avaient perdu le sommeil. « Le souffle des petits les apaisera », a déclaré Thérèse. Le souffle des petits ou le parfum des jeunes filles ? Toujours est-il que depuis cette décision, les grands-pères roupillent comme des sonneurs. Et nous passons, Stojil et moi, de longues heures à jouer aux échecs en parlant doucement dans ces sommeils mêlés.)
— Aujourd’hui, dit Stojil, j’ai promené des Russes, en ville.
Jérémy se retourne dans son lit, au-dessus de Papy-Merlan qui en fait autant.
— De bons communistes, avec autorisation de sortie et consignes de vigilance.
Le Petit a un gémissement. Thérèse tousse.
— À l’Agence, on m’a recommandé de bien les soigner. Il y avait un aparatchik avec eux, un Ukrainien, du genre jovial. Il m’a dit en rigolant : « Et pas de propagande, camarade, nous savons tout de vos mensonges. » Toujours pareil avec eux : beaucoup de choses se disent en plaisantant, mais c’est un rire qui tue. Comme si tu te faisais piquer par un serpent hilare.
— Je me rappelle Khrouchtchev, oui, il riait beaucoup.
— C’était un spécialiste, celui-là, jusqu’au jour où un autre a rigolé à sa place.
Le souffle des grands-pères s’est petit à petit réglé sur celui des enfants.
— Alors, je leur ai fait visiter un Paris bien de chez eux : place du colonel Fabien, Bourse du Travail, immeuble de la C.G.T., ils n’ont rien vu d’autre. Quand l’aparatchik louchait sur une vitrine de charcuterie, je lui disais : « Propagande ! tout est faux à l’intérieur, saucisses en carton ! si vous regardez ça, Alexeï Trophimovitch, je vais être obligé de faire un rapport ! »
Risson produit un hoquet joyeux, comme s’il riait à l’intérieur de son sommeil.
— À midi, poursuit Stojil, je les ai emmenés bouffer à la cantine de Renault, et l’après-midi, ils ont voulu voir Versailles. Ils veulent tous voir Versailles. Je n’avais pas envie de me traîner une fois de plus jusque-là, alors je les ai conduits devant la gare Saint-Lazare, et je leur ai dit : « Voilà Versailles, le palais du tyran que la Révolution a adapté à l’usage des masses ! » Crépitement unanime des flashs.
Sourire. Respiration synchrone des dormeurs. Toutes ces vies en un seul souffle… Je dis :
— Ils te doivent une visite de Moscou, maintenant.
Mais Stojil est passé à autre chose.
— Ma veuve Dolgorouki connaissait parfaitement les écrivains prérévolutionnaires. À vingt ans, elle était communiste, comme moi au sortir de mon couvent. Elle faisait la résistante ici, pendant que je faisais le maquisard en Croatie. Elle savait les poèmes de Maïakovski par cœur, nous nous récitions des scènes entières du Revizor et elle connaissait Bielyï. Oui.
— Je me rappelle cette vieille dame. Elle disait à maman : « Le visage de votre Clara est pur comme une icône de Vieux Croyant. »
— C’étaient des princes, dans le temps, les Dolgorouki, des princes de légende, même. Certains ont choisi la Révolution.
Stojil se lève. Il remet en place le bras du Petit qui s’est échappé de ses couvertures.
— Qu’est-ce que Risson leur a raconté, ce soir ?
— Août 14. Soljenitsyne. Comme Jérémy voulait tout savoir sur l’habillement des bidasses en 14, Verdun est venu au secours de Risson. Il paraît que l’armée dépensait 700 000 mètres de flanelle par mois à 3,50 F le mètre, 2 550 000 paires de chaussettes, 250 000 cache-nez, 10 000 passe-montagnes, 2 400 000 mètres de drap en 140 pour les uniformes, représentant 77 000 tonnes de laine en suint. Il connaît tout ça, Verdun, avec les prix au centime près, il était tailleur, à l’époque. En écoutant ce déluge, les mômes étaient encore plus passionnés que par les taxis de la Marne.
— Oui, fait rêveusement Stojil, les jeunes aiment la mort.
— Tu dis ?
— Les jeunes aiment la mort. À douze ans ils s’endorment sur des récits de guerre, à vingt ans ils la font, comme la veuve Dolgorouki ou moi. Ils rêvent de donner une mort juste ou de recevoir une mort glorieuse, mais dans tous les cas c’est la mort qu’ils aiment. Ici, aujourd’hui, à Belleville, ils égorgent une vieille dame et s’envoient ses économies dans les veines pour trouver une mort lumineuse. C’est de cela qu’elle est morte, ma veuve : de la passion des jeunes pour la mort. Elle aurait pu se faire écraser par un jeune fou dans un bolide, ç’aurait été la même mort. Oui.
Silence. Souffle régulier des dormeurs. Puis :
— Tiens, le lit de Clara est vide ?
— Pas pour longtemps, oncle Stojil, répond la voix de Clara toute proche. (Même lointaine, la voix veloutée de Clara est toute proche.) Je suis là.
Et, après avoir embrassé Stojil :
— Je crois que j’ai trouvé notre infirmière, Ben.
Lumière. Une petite brune, en effet. Les yeux lui mangent la figure (« un regard lumineux », disait Semelle). Des cheveux très noirs encadrant un visage très blanc. Sur une des photos, son sac est ouvert et elle en tire un petit paquet qui pourrait bien être le sachet de gélules. Confirmation dans l’agrandissement suivant. Oui, c’est peut-être ça…
— Bravo, ma chérie, on se fera confirmer ça demain par Julie.
Il ne fallut pas plus de deux secondes à l’inspecteur Caregga pour apprendre à Pastor ce qu’il cherchait à savoir depuis une bonne semaine. La belle à la péniche dormant s’appelait Julie Corrençon, elle était reporter au journal Actuel, on l’avait interrogée l’année dernière dans l’affaire des bombes qui explosaient dans cette grande boutique, le Magasin.
— Suspecte ? demanda Pastor.
— Non, simple témoin. Elle se trouvait sur les lieux quand une des bombes a explosé [1] Voir Au bonheur des ogres , Folio n° 1972.
.
* * *
Pastor n’apprit pas grand-chose au journal lui-même. Personne, dans l’équipe de rédaction, ne savait où se trouvait Julie Corrençon, et personne ne s’en souciait. Elle disparaissait quelquefois pendant des mois et revenait avec un papier qu’elle glanait aux antipodes ou tout au fond de la plus proche banlieue. Elle ne se manifestait jamais dans l’intervalle. Elle fréquentait peu ses collègues et moins encore le monde journalistique en général. Dans ce milieu d’introvertis exubérants, elle faisait figure de grande fille pas bêcheuse mais secrète, sans états d’âme particuliers, sans bobo-psycho, sans attaches d’aucune sorte, l’essentiel de sa vie se ramenant à ceci : elle écrivait des articles du tonnerre dont elle ne communiquait jamais les sujets à l’avance. Ils étaient toujours pris. « C’est une sacrée nana, on va en entendre parler un jour. » Elle ne se shootait ni ne picolait. Tous ses collègues s’accordaient à la trouver « vachement belle », « superbandante », indestructible. Quant à ses mœurs, on ne lui connaissait de liaison avec personne. La question de savoir si elle était hétéro, homo, onano, sportive ou collectionneuse de timbres, cette question étant démodée (Pastor le comprit trop tard) n’appelait pas de réponse précise. Une certitude, pourtant : Julie Corrençon pouvait engendrer des passions dévorantes, ça oui, mais de là à tomber sur un dingue qui la dévore, ça non.
Читать дальше