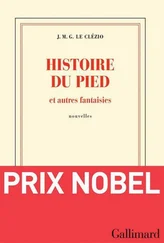Elle est rentrée dans la maison de Mazaugues avant la nuit. Elle a marché depuis le village toute seule sur la route, entre les vignes, en fumant une cigarette, et ça lui a paru délicieux. Le petit garçon Laurent est descendu à travers le pré pour l’accueillir, toujours à cheval sur son grand bouvier noir. « Tu es allée voir ton amoureux ? » Finalement il était plus malin que sa mère. Pervenche a dit : « Oui, mais ne le répète à personne. » Les fenêtres de la maison brillaient contre le ciel bleu. Pervenche a monté la pente jusqu’à la grande pièce où les filles gardaient les bébés ensemble. Elles avaient fait comme une arène au centre, avec des coussins, et les bébés roulaient et tanguaient. Tania était là, elle rampait cul nu au milieu des autres. Pervenche a ri, elle s’est sentie libre.
Vers l’été, Clémence est partie en voyage avec Paul. C’étaient leurs premières vacances depuis qu’ils étaient mariés. Clémence a choisi le Mexique, naturellement. L’avion jusqu’à Mexico, c’était long, mais ça n’était qu’un voyage. Ça ne ressemblait pas à ce qu’elle avait fait autrefois avec sa mère, quand Pervenche était restée à Ganagobie avec la grand-mère Lauro, et qu’elles étaient parties pour ne jamais revenir.
Bien sûr, Clémence n’a rien reconnu. Le bus du Michoacán roulait sur une autoroute nouvelle, qui passait par la via corta, par Querétaro, Acambaro, Morelia. Il n’y avait pas de poules sur le toit, ni d’Indiennes accroupies dans l’allée. C’était un bus de luxe aux vitres teintées, qui ne s’arrêtait pas dans les villages. À la ville de Zamora, au bout de la chaussée, il y avait de nouveaux hôtels avec des jardins et des piscines. Il y avait des embouteillages.
Un taxi les a laissés à l’angle de la rue des Tulipanes. La nuit tombait, mais la rue était vide d’enfants. Il n’y avait qu’une vieille sur le pas de la porte, devant la maison où vivait autrefois Chavela. Clémence n’a rien osé lui demander, parce que Paul était avec elle.
Paul lui serrait fort la main, il était ému. Il lui a dit : « C’est ici que tu habitais ? » La petite maison du docteur Perrine avait l’air abandonnée. Le jardinet devant la fenêtre de la cuisine était envahi par les herbes. Pervenche a cherché la maison de Pina, où vivait le maître des abeilles. Quand elle a frappé au carreau, le vieil homme est sorti. Il était maigre, avec un visage émacié, maladif. Clémence a dit son nom, mais le vieux ne se souvenait plus. Par politesse, il a demandé des nouvelles de sa famille. En revanche, il se souvenait très bien du docteur Perrine. Et Pina ? Et Rosalba ? Carlos Quinto ? Il a eu un geste vague de la main, il les montrait au loin, de l’autre côté des volcans. Ils sont partis, ils sont de l’autre côté, à Los Angeles, Californie.
Pina travaille, il paraît qu’elle va se marier. Carlos est soldat. Rosalba et Maïra vont à l’école là-bas. Ils ne sont jamais revenus. Leur mère envoie un peu d’argent par la poste. Elle s’est mariée à un gringo, ils habitent une grande maison, ils ont une voiture neuve avec même la télé à bord et un lecteur de cassettes. Il a dit ça avec la voix de quelqu’un qui n’y croyait pas vraiment.
La rue des Tulipanes est froide et humide, sans les enfants. Clémence tient la main de Paul fermement. C’est comme si elle avait rêvé tout cela, la rue le soir, les jeux des enfants, Chavela, Beto le berger, Pina, Maïra, Rosalba la Güera. Pas vécu, rêvé tout cela. Et les cris et les chansons, Pervenche gardait sa petite main serrée dans la sienne, tandis que les flammes jaillissaient au bord du trottoir, devant les enfants, et dans la nuit les étincelles tourbillonnaient, montaient, rejoignaient les étoiles.
Durant la fête qu’ils appelaient Ixnextiua, ce qui veut dire chercher l’aventure, ils disaient que tous les dieux dansaient, et ainsi tous ceux qui dansaient se déguisaient en divers personnages, les uns en oiseaux, d’autres en animaux, et ainsi certains se métarmorphosaient en colibris, d’autres en papillons, d’autres en abeilles, d’autres en mouches, d’autres en scarabées. D’autres encore portaient sur leur dos un homme endormi, et ils disaient que c’était le rêve.
BERNARDINO DE SAHAGUN, Historia général de las cosas de Nueva España.
La nuit tombe et avec elle vient le souvenir des peuples nomades, les peuples du désert et les peuples de la mer. C’est ce souvenir qui hante l’adolescence au moment d’entrer dans la vie, qui est son génie. La jeune fille porte en elle, sans vraiment le savoir, la mémoire de Rimbaud et de Kerouac, le rêve de Jack London ou bien le visage de Jean Genet, la vie de Moll Flanders, le regard égaré de Nadja dans les rues de Paris.
En vérité, c’est si difficile d’entrer dans le monde adulte quand toutes les routes conduisent aux mêmes frontières, quand le ciel est si lointain, que les arbres n’ont plus d’yeux et que les majestueuses rivières sont recouvertes de plaques de ciment gris, que les animaux ne parlent plus et que les hommes eux-mêmes ont perdu leurs signes.
La jeune fille de quinze ans monte lentement la route qui la conduit chaque matin au lycée, entre les falaises des immeubles, dans le bruit des camions et des autos qui vont et viennent. Elle pense : aujourd’hui, peut-être, j’arriverai en haut de la pente et de l’autre côté, d’un seul coup il n’y aura plus rien, seulement un grand trou creusé dans la terre.
La jeune fille de quinze ans marche dans la foule, à midi, comme si elle avait laissé l’école quelques heures, juste quelques heures d’escapade volées aux maîtres de maths, de sciences nat ou d’histoire-géo, et qu’elle était à bord d’un grand train rouillé dans lequel elle aurait sauté en marche et qui la conduirait à l’autre bout de la terre, vraiment aux confins, au Havre ou à Rotterdam, ou peut-être même à Yokohama. Elle marche, et elle cherche dans les yeux qui croisent son regard quelque chose, une exaltation, une étincelle neuve, juste avant le sourire et les mots qui l’entraîneraient vers une vie nouvelle.
Ou bien à minuit, vêtue de son blouson de cuir acheté au clou, et qui porte écrit sur le col SCHOTT. La nuit froide est un frisson sur sa peau, la nuit brille dans l’obsidienne de ses yeux, la nuit fourmille de lumières, d’étoiles, de feux rouges, de noms au néon magnifiques et étrangers, de noms dangereux, de noms qui rugissent du fond de la vie, qui disent,
CHANGE
Maccari & Franco
HASARD
LOCUST
SOLEDAD
Son cœur bat au rythme des mots lointains, des airs insensés. La jeune fille de quinze ans marche seule dans la nuit, à la recherche d’une image, d’un reflet, d’une étincelle. C’est au fond d’elle, il y a ce vide, cette fenêtre qui bat, un vent qui souffle, une chauve-souris qui la frôle, et son cœur qui bat, qui bat. Elle ne sait pas ce qu’elle cherche. Pourquoi se creuse la vague, au-dessus de la ville, et s’ouvrent les portes infinies de l’horizon, au-delà des esplanades et des boulevards de ceinture. Qu’y a-t-il là-bas, de l’autre côté ? Est-ce qu’on n’y meurt pas ?
Mais le souvenir des temps nomades est plus fort que tout. Chaque soir, il fait battre le cœur adolescent, il creuse le ventre. Le souvenir des temps arapahœs, cheyenne, lakota, texas. Alors il n’y avait pas de murs ni de noms. Il n’y avait pas de numéros. Il n’y avait pas de licence, ni de fichier central de police, ni de livrets de famille, ni d’actes notariés, ni les terribles marques sur les bras, sous la plante des pieds, ni les trous des piqûres à la saignée du coude, ni tout cela, les timbres, les photos, les empreintes du pouce et les bracelets de plastique entourant les poignets des bébés et les chevilles des morts.
Читать дальше