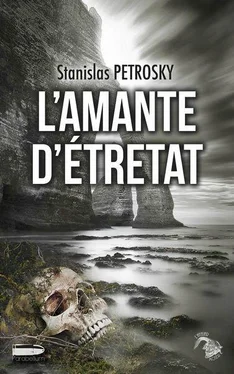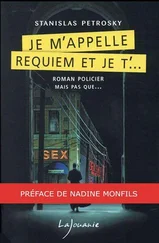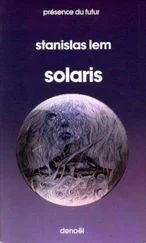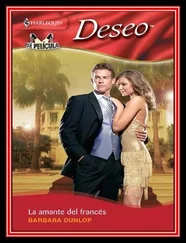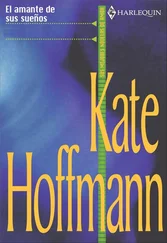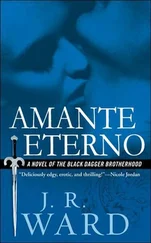La psychiatre ne lui posa aucune question au téléphone. Le lendemain, en fin de matinée, elle était disponible.
Isabelle ne put s’empêcher de se rendre sur la digue, elle avait garé la voiture devant la maison, n’avait même pas pris la peine de rentrer poser ses affaires. Elle avait marché vers la mer et les falaises. Les yeux perdus face à la ligne d’horizon, elle sentait les larmes couler. Elle ne savait pas si elle pleurait de désespoir, ou de déception en sentant tous ses souvenirs remonter à la surface.
Elle se croyait sortie d’affaire, que la mauvaise passe était terminée, que de reprendre le travail, d’avoir de nouveau une vie sociale avait pansé les plaies, mais elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle resterait donc toute sa vie au bord du gouffre ? Prête à retomber dans les affres de la dépression ? On ne pouvait donc pas s’en sortir définitivement ?
Elle décida de rentrer, rester ici face à la Manche ne lui apportait rien si ce n’est une raison de plus de chavirer, tout irait mieux dès demain, Finck saurait quoi faire, comment l’aider.
Elle tenta de s’occuper, faire sa comptabilité, mais ses idées étaient ailleurs. Le visage de cet inconnu avait fait ressurgir les démons. Elle en était arrivée à se demander s’il n’avait pas la même voix que Frédéric, cette même intonation. Non, tout cela était dans sa tête, le fruit de son imagination. Si tel avait été le cas, elle s’en serait rendu compte aussitôt, et non pas des heures après.
Isabelle sortit une bouteille du réfrigérateur, se servit un verre de vin blanc, se mit face à la fenêtre. Le bambou occupait pratiquement tout l’espace maintenant, il ne subsistait plus rien de la pelouse, du sable. Elle remplit à nouveau le verre, prenant le temps de savourer cette fois-ci, le premier avait été avalé un peu trop vite à son goût. Elle sortit et se dirigea vers le métaké. Elle se planta devant les chaumes. Les feuilles, sous l’effet du soleil de juillet, étaient roulées sur elles-mêmes pour se préserver de la sécheresse. Elle but une gorgée de Pouilly.
— Je devrais t’arroser, tu as soif, toi aussi.
De sa main libre elle caressa le feuillage, à qui parlait-elle ? À la plante ou à Frédéric ? Elle ne le savait pas, ou ne voulait pas savoir, mais le flot de ses paroles l’orientait plus vers un monologue avec Frédéric.
— Je ne comprends pas, tout allait bien, puis là, ce type, j’ai cru que c’était toi. Je pensais être guérie, enfin tranquille, mais non, je suis là comme une conne à te parler, à parler à ce putain de bambou comme si tu pouvais m’entendre et me répondre. J’en ai marre, Frédéric, marre. Quand est-ce que tout cela cessera ? À quel moment retrouverai-je la paix ?
Isabelle jeta le reste du vin sur la plante et rentra dans la maison en pleurant. Elle décida que la meilleure chose à faire c’était de prendre une douche, un somnifère et de se coucher. Dormir pour ne plus penser, dormir pour être déjà demain et voir sa thérapeute. Elle n’avait pas dîné, elle n’avait pas faim, une fois de plus, tout était noué à l’intérieur.
Elle se réveilla avec des aigreurs d’estomac, prendre juste du vin pour le repas, voilà le résultat. Elle prit un café, le téléphone sonna, on avait besoin de ses services à la chambre mortuaire de l’hôpital, cela tombait très bien, juste à côté de son rendez-vous et de quoi occuper ses pensées.
Le temps ne passa pas assez vite à son goût, elle avait besoin de voir le docteur Finck, de lui expliquer et surtout qu’elle puisse l’aider comme elle l’avait déjà fait. Quand elle frappa à la porte de sa psychiatre, ce fut comme une délivrance. Elle lui expliqua l’accident, et surtout le choc psychologique de voir un homme si ressemblant à Frédéric. Et sa peur surtout, la peur de retomber en dépression, de ne plus pouvoir travailler, sortir. Claire Finck la rassura aussitôt :
— N’ayez aucune crainte, Isabelle, c’est tout à fait normal. Vous avez vécu un deuil particulièrement compliqué, votre mari était jeune, il a été porté disparu. Longtemps vous vous êtes posé la question de savoir s’il était vraiment mort ou non. Il vous a fallu vous battre afin d’affronter cette terrible réalité, votre époux est bel et bien décédé. Et hier, vous croisez une personne qui lui ressemble.
La voix posée de Claire rassurait Isabelle qui l’écoutait attentivement sans la couper, savoir que ce qui venait de se produire était normal lui fit le plus grand bien.
— Peut-être même que cet individu avait un vague air de ressemblance, votre cerveau, et plus particulièrement votre subconscient a fait le reste. De même vous me parlez de la voix de cet homme, je suis intimement convaincu que c’est faux, qu’elle était totalement différente, qu’une fois encore c’est une illusion. Une réminiscence de votre déni. Cela va passer. Que vous vous soyez adressé au bambou ce n’est pas important non plus à proprement parler, tant que cela ne redevient pas une habitude. Il ne faut pas en refaire un sanctuaire. Où en êtes-vous avec cela ? Que reste-t-il là-bas qui fasse que ce lieu ressemble à une sépulture ?
— Plus rien, comme vous me l’aviez conseillé, plus de photophore, de plaque, de banc, juste le bambou qui poursuit sa croissance. Je le trouve joli, cela m’embêterait de devoir l’arracher…
— Il ne faut pas, l’arracher pour ne plus le voir, c’est lui donner une véritable connotation de sacré, c’est le relier à votre époux. Ce n’est qu’une plante ornementale, si vous l’aimez, gardez-le. Et dans la maison ?
— Dans la maison ?
— Oui, est-ce que dans votre habitation il y a beaucoup de photos de Frédéric, est-ce que ses affaires sont toujours là autour de vous. Est-ce que vous vivez perpétuellement dans son souvenir ?
Isabelle prit le temps de réfléchir, de visualiser toutes les pièces, à force d’y vivre, on ne fait plus vraiment attention. Et elle voulait que ses réponses soient le plus juste possible afin que le docteur Finck puisse l’aider au maximum.
— J’ai retiré presque toutes les photos, il n’en reste que deux, une dans le salon, celle de notre mariage, et une autre dans la chambre, un portrait. Le livre de Frédéric Dard que je lui lisais sans cesse, enfin que je lisais au pied du bambou, je l’ai jeté il y a peu. Je le connaissais pratiquement par cœur, il était très abimé, je ne l’ai plus. Quant aux objets personnels, Frédéric en possédait très peu, il n’était pas très matérialiste, je porte son alliance en sautoir, lui ne la portait jamais, elle dormait dans ma boîte à bijoux… Je ne vois pas d’autre chose.
— Ses vêtements, ses affaires de véliplanchiste, où est tout cela ?
— Dans les armoires et malles de la maison, mais je ne les ai jamais sortis. Au départ un tee-shirt, celui qu’il portait la veille de sa disparition, son parfum. Mais au fur et à mesure l’odeur est partie, je l’ai lavé et rangé.
— Il est temps de vous débarrasser de tout cela, Isabelle, vous avez maintenant assimilé son décès, c’est acté en vous, votre esprit l’a compris, il ne reviendra pas. Garder cela ne vous donne rien, d’avoir encore ça chez vous, ce qui est inutile et qui n’a pas acte à être un véritable souvenir comme une photo ou son alliance n’a plus sa place. C’est de la tentation en puissance si je puis dire.
— Je dois tout jeter ?
— Qui vous parle de jeter ? Certainement pas moi, je vous ai dit de vous en débarrasser, vous pouvez donner ses vêtements à une association…
— Oui, vous avez raison, docteur, et ses affaires de voile, je peux les donner au club Voiles et galets où il a été moniteur. Je vais faire cela cet après-midi, pour l’instant je n’ai rien de prévu.
Читать дальше