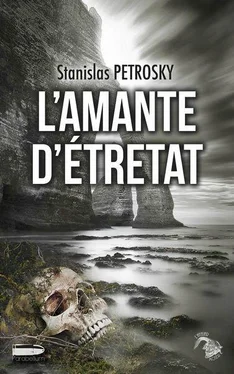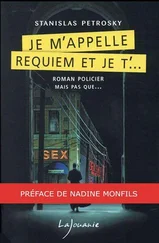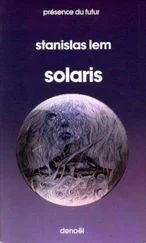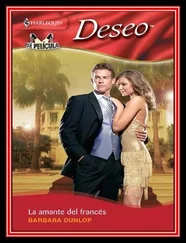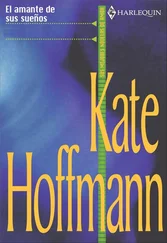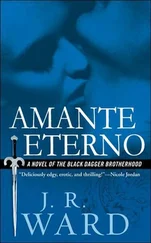Quand le SAMU était arrivé sur place, Isabelle était en coma léger, elle n’avait plus que six de tension artérielle, son pouls était descendu à cinquante et sa température à tout juste trente-cinq degrés. Elle était en hypothermie et en crise de bradycardie, le tout couronné par un état de très grande fatigue générale. La dépression nerveuse avait fait son œuvre, et pourtant, une fois encore, la mort lui refusait la délivrance. Elle aurait pu, elle aurait dû mourir cette nuit-là, à ses côtés, le froid l’aurait engourdie, elle n’aurait pratiquement rien senti, elle ne se serait simplement pas réveillée et enfin, cette fois-ci, elle l’aurait rejoint. Mais le destin avait mis Papet et son grand cœur sur son, sur leur chemin, et elle était là, fatiguée, alitée, certes, mais bel et bien en vie.
On lui avait placé un goutte-à-goutte de glucose afin de la nourrir, elle avait dormi un peu plus de trente-six heures d’affilée. Éric, qui était sa seule famille, venait la voir après la fermeture ; une petite trentaine de kilomètres séparait Étretat de Montivilliers, juste à côté du Havre.
S’il n’avait pas eu la présence d’esprit de venir chez elle, elle ne serait plus de ce monde aujourd’hui. Seulement, au lieu de le remercier, de lui montrer un peu de gratitude pour lui avoir sauvé la vie, Isabelle s’emporta d’un coup :
— Pourquoi tu as appelé les secours, Papet, tu ne pouvais pas me laisser crever, me laisser le rejoindre ?
— Petite conne… Tu n’es qu’une petite conne égoïste ! C’est trop facile de vouloir mourir comme ça pour effacer son chagrin. La vie c’est un cadeau, on se bat pour la garder, on lutte ! Tu crois que mourir le fera revenir ? Non ! Il est mort, c’est fini. Toi tu es une gamine, tu as toute la vie encore, même sans lui tu dois vivre.
— Pourquoi vivre sans lui, à quoi bon ?
— Parce qu’il y a des gens comme moi qui t’aiment, idiote. Alors tu vas me faire le plaisir d’arrêter toutes tes conneries… Tu vas cesser de ne penser qu’à lui, il est parti, définitivement, il ne reviendra pas, il est mort ! Tu m’entends, Isabelle ? Mort !
— Oui, Papet…
— C’est fini, ma petite, faut arrêter de vivre avec un fantôme, tu ne peux pas continuer ainsi, pense aux autres.
Isabelle ne répondit pas, car Papet avait touché là où ça faisait mal… Éric avait peut-être raison, et si elle était égoïste ? Et si elle ne pensait qu’à sa petite personne ? Elle avait eu la preuve qu’elle comptait pour lui. Peut-être fallait-il lutter comme il venait de le lui demander ?
Ce jour-là, elle décida d’essayer de remonter la pente, elle devait vivre, manger. Il lui fallait tirer un trait sur son passé, pour ne plus vivre avec et pour un fantôme.
Ce malaise qui aurait pu lui être fatal fut le déclic, elle reprit pied dans la réalité. Elle accepta alors l’idée de se faire aider, car seule elle n’y arriverait pas.
Peu de temps après son réveil, elle fut prise en charge par une psychiatre qui se consacra à lui réapprendre à vivre. Dans leur premier entretien, la thérapeute lui expliqua longuement qu’il fallait laisser les morts à leur place, les laisser partir, sans pour autant les oublier. On ne pouvait pas vivre avec les morts, encore moins pour eux, on devait vivre pour soi.
Isabelle commença à faire un travail sur elle-même. Elle raconta toute son histoire au docteur Claire Finck, une femme d’une grande compréhension. Pendant les trois semaines qu’elle passa à l’hôpital, elle vit la doctoresse tous les jours. Celle-ci l’écouta attentivement. C’était comme si faire sortir les mots purgeait quelque peu sa douleur. Le docteur Finck ne la faisait parler pratiquement que de Frédéric, de leur vie commune, de la mort et curieusement, Isabelle se sentait de mieux en mieux après chaque séance.
Sa principale hantise était de se retrouver à Étretat, face au jardin. Elles parlèrent longuement de son retour à la maison, de ce bout de verdure à ne pas détruire, mais à aménager autrement : retirer peut-être le panneau avec le prénom, ne plus mettre sans cesse des bougies dans la lanterne, en faire un véritable jardin, et non pas un hypogée.
Claire Finck la convainquit qu’à la trentaine passée, huit ans, ce n’était pas si long. Dans huit petites années, Isabelle pourrait faire une sépulture décente pour son mari, dans un vrai cimetière, en dehors de son domicile, mais en attendant, elle devait faire son deuil. Tout du moins le commencer. Le docteur Finck l’entretenait aussi beaucoup de son travail de vendeuse. Était-ce vraiment ce qu’elle voulait faire ? N’était-il pas temps de se demander si elle ne devait pas reprendre le métier pour lequel elle avait été formée, celui de thanatopracteur ?
Isabelle hésita, mais elle savait au fond d’elle-même qu’elle ne s’épanouissait pas dans l’épicerie d’Éric. Thanatopractrice avait été une véritable vocation, un métier qu’elle avait exercé avec fierté et passion. La psychiatre insista : c’était aussi un très bon moyen de faire son deuil que de se rendre compte qu’elle n’était pas la seule à affronter la mort. Que d’autres aussi perdaient un être cher, mais eux réussissaient à passer le cap, à continuer de vivre, pour eux, pour les autres… Elle lui demanda de bien réfléchir, de peser le pour et le contre. Bien sûr, il n’était nullement question de retourner travailler chez les Dargelin, Isabelle pouvait se mettre à son compte. Même si depuis de longs mois elle n’exerçait plus, sa bonne réputation était encore ancrée dans l’esprit des professionnels du funéraire.
La psychiatre lui indiqua alors qu’elle serait toujours là pour elle en cas de besoin.
— Après votre sortie, je vous verrai toutes les deux semaines en consultation pendant un trimestre complet, puis nous espacerons les rendez-vous si vous allez mieux.
Doucement mais sûrement, Isabelle comprit qu’elle devait briser ce lien étrange qui la reliait à son mari disparu, elle devait lâcher prise. L’idée de reprendre ses valises d'embaumeuse mûrissait dans sa tête. Éric l’avait certes dépannée en lui offrant un travail dans l’épicerie, mais elle ne se voyait pas continuer encore des années à vendre des boîtes de conserve. « Réparer les morts » comme disait Frédéric, c’était cela son vrai métier. Elle se rendit compte qu’elle venait d’évoquer son mari sans pleurer, sans serrement de cœur, mais avec le sourire, la guérison était en route.
Isabelle sortit de l’hôpital le jeudi 25 octobre. Éric vint la chercher, il y tenait, il lui dit qu’il ne voulait pas qu’elle prenne un taxi, mais la vérité était qu’il voulait voir sa réaction quand elle arriverait chez elle. Il lui parla des clients habituels du magasin. Certains demandaient de ses nouvelles, ils n’avaient pas osé l’aborder après le drame qu’elle avait vécu, mais ils l’aimaient bien. Et lorsqu’ils souriaient sur son passage ce n’était pas forcément qu’ils se moquaient d’elle, mais ils voulaient donner une marque de sympathie, sans insister. Stéphanie aussi l’avait appelée, elle était très inquiète puisque son amie refusait de lui répondre au téléphone.
Quand la vieille voiture de Papet stoppa devant la maison, Isabelle pensa cette fois-ci à lui offrir un café. Elle avait surtout besoin de ne pas être seule pour repasser devant le jardin la première fois. Elle s’arrêta face au bambou, passa la main dans le feuillage, comme pour le caresser, puis elle retira la pancarte avec le prénom, la mit dans le bac de la poubelle et elle rentra faire du café. Éric lui dit que si elle voulait, elle pouvait poser des jours de congé en plus si elle ne se sentait pas prête à reprendre le travail. Il était temps pour Isabelle de prendre une décision, ce qu’elle fit immédiatement.
Читать дальше