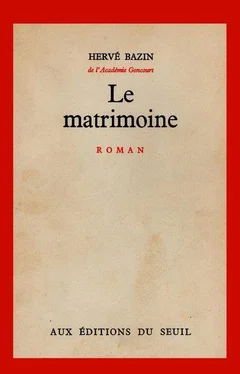— C’est la fin des Aufray. Ils sont quinze là-dessous. Mais quand viendra mon tour je ne veux pas qu’on les fasse réduire pour me caser à tout prix parmi eux. Ton père m’attend au cimetière de l’est, à Angers.
Puis elle me remit l’enveloppe qui contenait le testament de ma tante. Comme je le craignais (imaginant bien que ma mère avait dû plaider dans ce sens), ce testament m’instituait légataire universel sans même réserver l’usufruit et je me trouvai aussitôt dans une situation impossible que la candide bonté de la disparue et de la survivante n’avaient pas prévue. La Rouselle constituait tout le patrimoine. Vendre ma part, c’était forcer ma mère — qui n’avait pas de quoi me la racheter — à vendre la sienne ; et la mettre dehors en rompant au surplus avec la moitié de mes racines. Ne pas vendre, c’était me condamner à l’emprunt, aux hypothèques, pour régler des droits de succession dont je n’avais pas le premier sou. Liquider de la terre, à cet effet, c’était rendre inexploitable un domaine qui, déjà, comme la plupart des entreprises de la vallée, était trop petit. Enfin l’affermer, c’était en rendre le rapport dérisoire et lui enlever la moitié de sa valeur pour la durée du bail. Restait une solution : abandonner la rue du Temple, vendre la maison et me fixer à la Rouselle, d’où j’aurais pu chaque matin descendre au palais. Mariette n’eut aucune peine à me démontrer qu’elle était impraticable :
— Tu parles d’une navette ! Et tes clients, tu les recevrais où ? Tu me vois faire vingt kilomètres chaque fois que j’aurais besoin de maman ? Et puis franchement je n’ai aucune envie de m’enterrer dans ce trou.
Elle n’avait aussi aucune envie de vivre avec ma mère et, somme toute, c’était normal. Mais les Guimarch, alertés, mirent un acharnement particulier à démolir “cette idée folle”.
— Pour sauver la maison de votre mère, qui ne vous est d’aucune utilité, vous condamneriez celle de votre père, vraiment je ne comprends plus, répétait M me Guimarch.
Elle comprenait très bien. J’aurais bien voulu garder les deux et, seuls, les beaux-parents pouvaient m’avancer l’argent nécessaire, à taux bénin. N’osant le leur demander, j’espérais vaguement les amener à me proposer ce prêt. Mais ils n’en avaient pas la moindre intention. M. Guimarch lui-même s’en mêla, me téléphona pour me dire qu’il aimerait “me parler de choses sérieuses, entre hommes”. En fait il vint déjeuner à la maison, avec la belle-mère et tandis que Mariette, après le dessert, se retirait discrètement “pour changer Loulou”, M. et M me Guimarch se relayèrent auprès de moi. Le beau-père dit au moins trois fois de sa voix creuse :
— Vous savez, Abel, il n’y a pas que les sentiments qui comptent…
La belle-mère dit au moins six fois :
— Croyez bien que si la chose était raisonnable, malgré les difficultés actuelles, nous ferions l’impossible…
Puis vinrent les arguments solides :
— Ni votre mère ni vous, assura M me Guimarch, n’entendez rien à la floriculture et, soit dit sans vous offenser, aux chiffres. Votre tante, déjà, vivotait. Gustave parti, Dieu sait ce que vous allez trouver comme personnel ! Incapable de le contrôler, pris par votre métier, je ne vous donne pas six mois avant de vous retrouver sur le sable.
Je le savais. Les vraies préoccupations des Guimarch, pourtant, je ne les avais pas toutes devinées. Me voyant silencieux, le beau-père se déboutonna tout à fait :
— Avec les charges que vous avez et les moyens limités que vous procure le barreau, ce serait tout de même scandaleux que vous fassiez un petit héritage et que votre situation s’obère au lieu de s’améliorer !
C’était donc ça. M me Guimarch, aussitôt, enrobait :
— Mon pauvre Abel, on est toujours coincé entre ses scrupules, entre ce qu’on doit à ses parents et ce qu’on doit à ses enfants. Je vous en parle savamment, j’ai eu ma mère paralysée à la maison pendant sept ans. Nous avions cinq mioches sur les bras et nos affaires n’étaient pas ce qu’elles sont…
Ainsi, M me Guimarch, malgré les “difficultés actuelles” s’avouait plus prospère que jadis. Ainsi, M me Guimarch, au temps des vaches maigres, n’avait pas hésité à recueillir sa propre mère. Mais ma mère à moi n’était que celle du gendre : nos devoirs dépendent de qui les envisage.
— Voyons, reprit M. Guimarch, soyons réalistes. Votre maman, à son âge, ne peut pas rester seule, éloignée des siens, dans cette maison trop grande, sans confort. Ce qu’il lui faut, c’est un appartement à Angers…
— Et alors, enchaîna M me Guimarch, tout devient facile. Vous avez autour de la Roussette quelques bons hectares susceptibles d’intéresser vos voisins, toujours à court de terre. La maison peut être détachée, avec son jardin, pour un amateur de week-end…
Elle s’était même renseignée sur les prix. Vingt millions pour le tout, c’était le moins que nous en puissions espérer. Vingt, dont dix, en toute justice, pour maman, c’est-à-dire un peu plus que ce qu’il lui fallait pour s’acheter un trois-pièces. Et encore ? N’était-il pas préférable qu’elle le louât, qu’elle plaçât son argent, pas en viager, non, puisqu’elle avait des héritiers, mais en bonnes valeurs ou encore chez le notaire, où le capital est moins garanti, certes, mais dont on peut espérer du dix, voire du onze pour cent ? Avec ces rentes jointes à sa demi-pension de veuve de percepteur, ma chère maman se trouverait à l’abri et je pourrais avec sérénité disposer de ma propre part pour soulager Mariette qui n’avait toujours personne pour l’aider…
— Oh, dit Mariette, rentrant juste à point, je me débrouille ; il y en a de plus à plaindre que moi ! Mais j’avoue que j’aimerais pouvoir me servir de la pièce que la mère d’Abel s’est réservée ici. Je n’ai qu’une chambre pour les enfants.
— Et si jamais tu as une bonne, dit M me Guimarch, je me demande où tu la coucheras.
— Il suffirait de faire mansarder le grenier, dit M. Guimarch.
— Ce n’est plus une dépense somptuaire pour vous, conclut M me Guimarch, sans craindre le pléonasme.
Tio, puis les Éric arrivant sur ces entrefaites, pour le café, me délivrèrent de toute réponse. Jamais sans doute je n’avais mieux senti la force d’une belle-famille, une en ses intentions, pour envelopper le gendre. J’avais honte de mon silence, de mon embarras. J’avais honte de les laisser me traiter en mineur et s’occuper de mes intérêts comme s’il s’agissait des leurs. J’avais honte de savoir qu’au surplus, ils n’avaient pas tort, que mon sang Bretaudeau n’était même pas d’accord avec mon sang Aufray et qu’en fin de compte mes nostalgies ne manqueraient pas de céder à mes nécessités. Mariette en était si persuadée qu’à deux reprises, pendant le bridge traditionnel, elle arrêta du regard certaines allusions. Et comme Tio, l’innocent, demandait en abattant ses cartes pour faire le mort :
— À propos, la Rousselle, qu’est-ce que vous en faites ?
Elle répondit très vite pour couper court :
— Abel y a beaucoup réfléchi, mais il ne peut rien décider sans sa mère. Nous ferons ce qu’elle voudra.
Huit jours plus tard, ma mère m’annonçait, avec une sécheresse inhabituelle, que l’indivis lui paraissait impraticable, à elle aussi, qu’elle ne se sentait ni la force ni le goût de continuer une exploitation dont je serais de toute façon, un jour ou l’autre, amené à me défaire.
— J’en ai parlé avec ta belle-mère, précisa-t-elle, et votre point de vue me paraît juste.
Elle n’ajouta rien. Je ne sus même pas si elle avait rencontré la belle-mère par hasard ou si celle-ci était carrément allée la trouver. Je ne protestais pas : ni auprès de ma mère pour me disculper, ni auprès de Mariette pour me plaindre de l’ingérence des siens. Quand ce qui vous navre en même temps vous arrange et que chacun le sait, mieux vaut se taire. Entre Mariette et moi je laissai se créer une zone de silence. Le ni-oui-ni-non, c’est mon vice. Pourtant si je supporte assez bien qu’on m’inspire, voire qu’on me commande, j’en veux à qui me manœuvre. Il allait prospérer, ce sentiment — pas nouveau, mais cette fois très clair — de n’être pas seulement encerclé par des bras.
Читать дальше