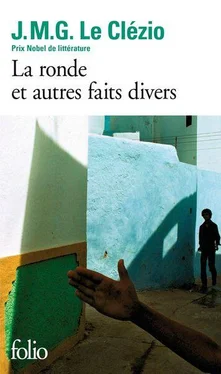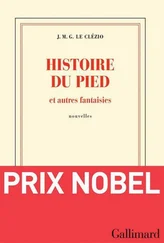À nouveau le vertige. Il se lève, il titube à travers le maquis. Le chant des insectes s’élève, ondoie, tantôt devant lui, tout près, tantôt loin en arrière. La chaleur du soleil a fait jaillir la sueur sur son visage, sur son corps, la chemise colle à son dos, sous ses bras. Il enlève la veste de son complet, il la tient serrée dans sa main droite comme un chiffon, et elle s’accroche et se déchire sur les épines des arbustes. Puis le vent souffle, froid, presque glacé, et il frissonne. Il erre longtemps sur le plateau, au hasard, en regardant toutes les clairières où les broussailles et la terre rouge portent la marque des corps de la nuit passée.
C’est un vertige, comme dans un piège, parce qu’il sait qu’il n’y a qu’ici, sur le plateau, que l’ombre d’Anne n’est pas. Elle ne peut pas venir, c’est un endroit plein de haine et de violence, un endroit âpre et solitaire, comme la lande sur laquelle marche le vieil homme avec son fusil à double canon.
Ailleurs, elle est là, elle attend. Ailleurs, c’est sa lumière, son ciel, son soleil, ses arbres, ses pierres. Il pense à la mer, et tout d’un coup, le vertige cesse, et la violence, la fureur, la haine se résorbent. Il reste debout, immobile, tourné vers l’ouest, là où commence à descendre le soleil. Il y a la ville immense, aux artères qui grondent, aux feux qui clignotent. Il y a la mer, d’un bleu presque noir, dure comme du métal, silencieuse et infinie.
Presque en courant, il traverse toute l’étendue du plateau crissant d’insectes, jusqu’à la route. La voiture est immobile au soleil, sa coque noire brille avec des éclats brûlants.
Quand il s’assoit, il sent la chaleur étouffante. Il ouvre la glace, il met le moteur en marche, il passe en première, il avance. La route est longue, maintenant, mais il sait où il va. Il ne pourra plus l’oublier maintenant. La ville, derrière lui, qui s’éloigne, est solitaire comme le maudit plateau où souffle le vent. C’est un endroit pour la haine, pour le plaisir et la peur, qui sont tout un.
Il n’y a plus de maison pour lui là-bas. Les chambres ne veulent pas de lui, elles le serrent de leurs murs, elles lui tendent les pièges de leurs papiers peints, fers de lance, faisceaux d’aiguilles, volutes, irisations angulaires des noyaux du platine. Tous les soirs, il a changé d’hôtel, comme un qui serait poursuivi par les flics, mais rien n’y a fait. Tous les soirs, tous les jours. Dans la maison de sa mère, c’est plus terrible encore, et cela fait des jours et des jours qu’il n’a pas pu s’asseoir pour manger. Elle est si vieille, avec ses cheveux blancs et ses yeux bleu délavé derrière ses lunettes. La lumière sur ses cheveux blancs et sur les verres de ses lunettes fait bondir son cœur, fait monter un frisson douloureux le long de sa colonne vertébrale. Est-ce qu’il a peur ? Non, ce n’est pas cela, c’est plutôt la peur qui est en lui, et qui se répand au-dehors, en longs frissons.
Maintenant, il roule lentement sur la route, en plein soleil. À droite, il y a la mer, comme vue par un oiseau, si haut que les vagues semblent arrêtées en cercles concentriques autour de la tache du soleil. C’est cela qu’Anne aime par-dessus tout, quand il n’y a rien qui s’interpose entre elle et l’horizon, et qu’on voit la grande ligne courbe sur laquelle repose le ciel. Elle peut rester des heures assise sur un rocher à regarder la mer, immobile comme un pêcheur. Il lui a dit cela un jour, et elle s’est mise à rire. Elle lui a dit qu’elle allait à la pêche autrefois, avec les garçons, elle fabriquait elle-même ses hameçons avec des épingles volées à sa mère. Mais elle n’a jamais rien pris d’autre que des touffes de varech.
Il est entré dans la zone de paix, maintenant, il est revenu dans le domaine d’Anne. Son cœur s’est calmé, et il ne pense plus à rien d’autre qu’à elle. La voiture suit tranquillement sa route, celle que la jeune femme a tracée il y a exactement un an. En quittant l’Observatoire, Anne a roulé vers l’Italie, pour voir la mer. C’était une journée exceptionnelle, le ciel était immense et vide, et la mer était d’un bleu sombre plein d’étincelles, et les montagnes éclairées par le soleil. L’auto d’Anne roule doucement, lentement, dans l’ouverture de la lumière. Sur la carrosserie vert sombre, les reflets glissent, font des étoiles. Peut-être qu’elle écoute la radio à cet instant, la musique des Bee Gees, ou bien une chanson brésilienne qui dit : Mulher rendeira !
Mais il y a le bruit du vent qui souffle contre le pare-brise, qui siffle dans les trous de la voiture. Parfois il y a un poids lourd qui peine le long de la côte, et l’auto le double sans difficulté. La lumière est plus chaude maintenant, à l’ouest, quand les virages permettent de les voir, les montagnes font des silhouettes d’ombre immobiles au-dessus de la mer gris de fer.
C’est le crépuscule bientôt. Le jour a glissé vite vers l’autre côté de l’horizon, sans un nuage, sans rien qui freine le temps. Le jour a glissé comme vers le passé, entraînant ceux qui vivent vers ceux qui sont morts. Aujourd’hui, c’est le même jour qu’il y a un an. L’auto vert sombre roule sur la route chaude, suspendue entre la mer et le ciel. La lumière fait une ouverture immense, ou bien étend son dôme étincelant, pareil à deux ailes d’ange.
Il ne peut plus rien y avoir de violent, de cruel. Elle l’a décidé ainsi, pour toujours, et elle tient serrée très fort la main de l’homme qu’elle aime. Lui sent son cœur battre dans sa paume, il sent le goût de ses lèvres, l’odeur obsédante de ses cheveux, odeur d’herbe, odeur de chair. Les larmes salées coulent lentement, sans douleur, humectant le coin de ses lèvres.
Alors la lumière devient plus douce, trouble un peu, comme à l’approche du crépuscule. Le vent siffle sur le pare-brise, dans les roues, en faisant sa musique lointaine. La route conduit vers le grand virage, d’où l’on voit la côte de l’Italie, au loin, pareille à une île de hautes montagnes sous l’aile d’un avion.
La voiture vert sombre d’Anne roule vite vers la courbe, sans la voir, parce qu’à cet instant il y a une explosion de lumière sur la carrosserie d’un poids lourd ; elle ferme les yeux, longtemps, les mains accrochées désespérément au volant, tandis que dans un bruit de tôle qui se déchire, l’auto arrache la balustrade de ciment et plonge vers le ravin. Plus tard, le chauffeur du poids lourd dit, il répète sans s’arrêter, sans comprendre : « Elle est tombée comme une pierre et elle a explosé en bas ; comme une boule de feu. Comme une boule de feu. »
Mais il n’y a plus de violence maintenant. Il n’y a plus de destin qui mord, qui ronge le centre du corps, qui hante les jours et les nuits. La mort ne peut plus briller dans les cheveux trop blancs de sa mère, ni sur les visages figés des passants. Rien ne subsiste, ne résiste. C’est une musique, qui est dans le vent, la lumière, le ciel, qui murmure à l’intérieur de l’oreille. Elle dit : « Viens, viens aussi… » Elle trace ses signes sur les routes, des flèches, des chiffres, des dessins qui indiquent le trésor.
Au milieu du virage, on ne peut pas se tromper. Il y a un an, jour pour jour. La balustrade de ciment n’a même pas été réparée. On a mis un grillage de poulailler, fixé par des poteaux de fer. L’auto noire frappe l’un des poteaux à cent kilomètres à l’heure, elle souffle le grillage comme si c’était un simple rideau de gaze. Un instant elle reste suspendue en l’air, planant, brûlée de reflets, avec le ciel droit devant elle et grand ouvert. Puis elle retombe, elle tombe vers le fond du ravin, elle tombe comme une pierre, et en touchant la terre, elle explose, tout à fait comme une boule de feu.
Читать дальше