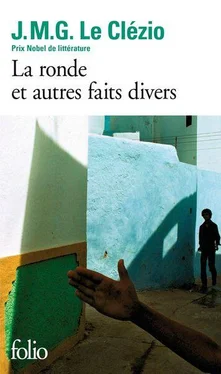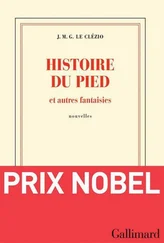Où était la belle lumière d’autrefois, celle que j’apercevais sur le fronton du faux temple, entre les feuilles ? Même l’ombre n’était plus pareille, à présent : grands lacs sombres au pied des résidences, ombres géométriques des réverbères et des grillages, ombres dures des voitures arrêtées. Je pensais alors à l’ombre légère qui dansait entre les feuilles, l’ombre des arbres enchevêtrés, des vieux lauriers, des palmiers. Tout d’un coup je me souvenais des taches rondes que faisait le soleil en traversant les feuilles d’arbre, et aux nuages gris des moustiques. C’était cela que je cherchais maintenant sur le sol nu, et mes yeux brûlaient à cause de la lumière. Cela qui était resté au fond de moi, durant toutes ces années, et qui, à présent, dans la nudité terrible, dans la brûlure de la lumière du présent, faisait comme un voile devant mes yeux, un vertige, un brouillard : l’ombre du jardin, l’ombre douce des arbres, qui préparait l’apparition éclatante de la belle maison couleur de nacre, entourée de ses jardins, de ses mystères et de ses chats.
Je n’ai sonné qu’une fois, brièvement, souhaitant peut-être au fond de moi que personne ne vienne. Mais au bout d’un instant, la porte de la villa s’est ouverte, et j’ai vu une vieille femme, vêtue comme une paysanne, ou comme une jardinière ; elle se tenait devant la porte, les yeux plissés à cause de la réverbération de la lumière, et elle cherchait à me voir. Elle ne me demandait pas ce que je voulais, ni qui j’étais, alors, entre les barreaux de la grille, je le lui ai dit, en parlant fort :
« Je suis Gérard Estève, je vous ai écrit, pour l’annonce, pour la chambre… »
La vieille femme continuait à me regarder sans répondre ; puis elle a un peu souri, et elle a dit :
« Attendez, je vais prendre la clé, j’arrive… »
Avec sa voix douce et fatiguée, et j’ai compris que je n’avais pas besoin de crier.
Je n’avais jamais vu la dame de la villa Aurore et pourtant, maintenant, je savais bien que c’était ainsi que j’avais toujours dû l’imaginer. Une vieille femme au visage cuit par le soleil, avec des cheveux blancs coupés court, et des habits qui avaient vieilli avec elle, des habits de pauvresse ou de paysanne, fanés par le soleil et par le temps. C’était comme son beau nom, Marie Doucet.
Avec elle je suis entré dans la villa Aurore. J’étais intimidé, mais aussi inquiet, parce que tout était si vieux, si fragile. J’avançais lentement dans la maison, précédé de la vieille dame, sans dire un mot, retenant presque mon souffle. Je longeais un corridor obscur, puis s’ouvrait la porte du salon éclatant de lumière dorée, et, à travers les vitres des portes-fenêtres, je voyais les feuilles des arbres et les palmes immobiles dans la belle lumière, comme si le soleil ne devait jamais disparaître. Et tandis que j’entrais dans la grande salle vétuste, il me semblait que les murs s’écartaient à l’infini, et que la maison grandissait, s’étendait sur toute la colline, effaçant tout ce qui était alentour, les immeubles, les routes, les parkings déserts, les gouffres de béton. Alors je retrouvais ma taille ancienne, celle que je n’aurais jamais dû perdre, ma stature d’enfant, et la vieille dame de la villa Aurore grandissait, éclairée par les murs de sa demeure.
Le vertige était si fort que je devais m’appuyer contre un fauteuil.
« Qu’avez-vous ? » dit Marie Doucet. « Vous êtes fatigué ? Voulez-vous boire du thé ? »
Je secouais la tête, un peu honteux de ma faiblesse, mais la vieille dame s’en allait tout de suite, en répondant elle-même :
« Si, si, justement, j’ai de l’eau sur le feu, je reviens tout de suite, asseyez-vous là… »
Puis nous bûmes le thé en silence. L’étourdissement m’avait quitté, mais le vide était resté en moi, et je ne pouvais rien dire. Seulement j’écoutais la vieille dame qui parlait, qui racontait l’aventure de la maison, la dernière aventure qu’elle était en train de vivre, sans doute.
« Ils sont venus, ils reviendront, je le sais, c’est pour cela que je voulais une aide, enfin, quelqu’un comme vous, pour m’aider à — Je voulais une jeune fille, je pensais que ça serait mieux, pour elle et pour moi, mais enfin, vous savez, il y en a deux qui sont venues ici, elles ont regardé la maison, elles m’ont dit poliment au revoir, et je ne les ai jamais revues. Elles avaient peur, elles ne voulaient pas rester ici. Je les comprends, même si tout a l’air tranquille maintenant, moi je sais qu’ils reviendront, ils viendront la nuit, et ils taperont sur les volets avec leurs barres de fer, et ils lanceront des cailloux, et ils pousseront leurs cris sauvages. Depuis des années, ils font cela pour me faire peur, comprenez-vous, pour que je m’en aille d’ici, mais où est-ce que j’irais ? J’ai toujours vécu dans cette maison, je ne saurais pas où aller, je ne pourrais pas. Et puis ensuite, il y a l’entrepreneur qui vient, le lendemain même, il sonne à ma porte, comme vous. Mais c’est vous qui le recevrez, vous lui direz que vous êtes mon secrétaire, vous lui direz… Mais non, au fond, ce n’est pas la peine, je sais bien ce qu’il veut, et lui il sait bien comment l’obtenir, ça ne changera rien. Ils ont pris le terrain pour la route, pour l’école, et puis ils ont loti ce qui était en trop, ils ont construit les immeubles. Mais il y a encore cette maison, c’est cela qu’ils veulent maintenant, ils ne me laisseront pas en repos tant qu’ils n’auront pas eu la maison, pour quoi faire ? Pour construire encore, encore. Alors, je sais qu’ils reviendront, la nuit. Ils disent que ce sont les enfants de la maison de redressement, ils disent cela. Mais je sais ce n’est pas vrai. Ce sont eux, eux tous, l’architecte, l’entrepreneur, le maire et les adjoints, eux tous, il y a si longtemps qu’ils guignent ces terres, ils en ont envie depuis si longtemps. Ils ont construit la route juste là, derrière, ils pensaient que j’allais partir à cause de cela, mais j’ai fermé les volets, je ne les ouvre plus, je reste du côté du jardin… Je suis si fatiguée, quelquefois je pense que je devrais m’en aller vraiment, partir, leur laisser la maison, pour qu’ils finissent leurs immeubles, pour que tout soit fini. Mais je ne peux pas, je ne saurais pas où aller, vous voyez, il y a si longtemps que je vis ici je ne connais plus rien d’autre… »
Elle parlait comme cela, avec sa voix douce qu’on entendait à peine, et moi je regardais la belle lumière qui bougeait imperceptiblement dans la grande chambre aux meubles anciens, parce que le soleil descendait le long de sa courbe, dans le ciel vide. Je pensais aux journées d’autrefois, là, caché dans les broussailles du jardin, quand la ville n’était encore qu’une rumeur étouffée par les arbres au pied de la colline. Plusieurs fois, j’ai été tenté de lui dire ce qui s’était passé autrefois, quand je jouais dans le jardin, en entrant par la brèche du mur, et que les chats sauvages détalaient dans les taillis. Je voulais lui parler de la grande tache claire qui jaillissait entre les palmiers, soudain, éblouissante, pareille à un nuage, pareille à une plume. J’ai même commencé à lui dire :
« Je me souviens, madame, je… »
Mais la phrase est restée en suspens, et la vieille dame m’a regardé tranquillement, avec ses yeux clairs, et je ne sais pourquoi, je n’ai pas osé continuer. Et puis mes souvenirs d’enfance semblaient dérisoires, maintenant que la ville moderne avait rongé la villa Aurore, car rien ne pouvait cacher la plaie, la douleur, l’angoisse qui régnaient maintenant ici.
Alors, tout d’un coup, j’ai compris que je ne pourrais pas rester dans la maison. J’ai compris cela comme un frisson, c’est venu en moi d’un seul coup. Les forces destructrices de la ville, les autos, les autocars, les camions, les bétonneuses, les grues, les marteaux pneumatiques, les pulvérisateurs, tout cela viendrait ici, tôt ou tard, entrerait dans le jardin endormi, et puis dans les murs de la villa, feraient éclater les vitres, ouvriraient des trous dans les plafonds de plâtre, feraient écrouler les canisses, renverseraient les murs jaunes, les planchers, les chambranles des portes.
Читать дальше