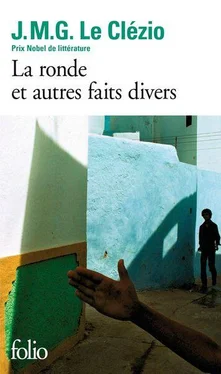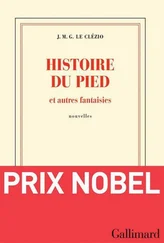Alors à ce moment-là, le type qui étudiait le grec, un jour me disait comme cela, en passant, que ça voulait dire « ciel », et ça n’avait plus aucune importance. C’était tout juste devenu un sujet de conversation, si vous voyez ce que je veux dire. Un sujet de conversation, du vent, du vide.
J’ai quand même recherché à tout revoir, un samedi après-midi, peu de temps avant les examens (c’était l’époque où je commençais des études de droit). Il y avait si longtemps que j’avais quitté le quartier que j’ai eu du mal à retrouver la rue, celle qui grimpait tout en haut de la colline, jusqu’au mur de la villa Aurore. Les grands immeubles étaient maintenant partout, ils avaient poussé en désordre sur la colline, jusqu’au sommet, serrés les uns contre les autres sur leurs grandes plates-formes de goudron. Les arbres avaient presque tous disparu, sauf un ou deux par-ci par-là, oubliés sans doute par le ravage qui était passé sur la terre : des oliviers, des eucalyptus, quelques orangers qui, maintenant perdus dans cette mer de goudron et de béton, semblaient chétifs, ternes, vieillis, près de leur mort.
Je marchais dans les rues inconnues, et peu à peu mon cœur se serrait. Il y avait une drôle d’impression qui venait de tout, comme de l’angoisse, ou bien une peur très sourde, sans motif réel, l’impression de la mort. Le soleil ruisselait sur les façades des immeubles, sur les balcons, allumait des étincelles sur les grands panneaux vitrés. Le vent tiède de l’automne agitait les feuilles des haies, et le feuillage des plantes d’agrément dans les jardins des résidences, car c’étaient maintenant des plantes sages aux couleurs voyantes, aux noms bizarres que je connaissais depuis peu, poinséttias, bégonias, strelitzias, jacarandas. Il y avait bien, de temps en temps, comme autrefois, des merles moqueurs qui criaient sur mon passage, qui sautillaient dans le gazon des ronds-points, et des cris d’enfants, et des aboiements de chiens. Mais la mort était derrière tout cela, et je sentais qu’on ne pouvait pas l’éviter.
Elle venait de tous les côtés à la fois, elle montait du sol, elle traînait le long des rues trop larges, sur les carrefours vides, dans les jardins nus, elle se balançait dans les palmes grises des vieux palmiers. C’était une ombre, un reflet, une odeur peut-être, un vide qui était maintenant dans les choses.
Alors je me suis arrêté un moment pour comprendre. Tout était tellement différent ! Les villas avaient disparu, ou bien elles avaient été repeintes, agrandies, transformées. Là où il y avait autrefois des jardins protégés par de hauts murs décrépis, maintenant s’élevaient les immeubles très blancs de dix, huit, douze étages, immenses sur leurs parkings tachés de cambouis. Ce qui était inquiétant surtout, c’est que je ne parvenais plus à retrouver mes souvenirs à présent. Ce qui existait aujourd’hui avait effacé d’un seul coup tous mes souvenirs d’enfance, laissant seulement la sensation douloureuse d’un vide, d’une mutilation, un malaise vague, aveugle, qui empêchait mes sentiments d’autrefois de se rejoindre avec ceux du présent. Dépossédé, exilé, trahi, ou peut-être seulement exclu, alors il y avait pour moi ce goût de mort, ce goût de néant. Le béton et le goudron, les hauts murs, les terre-pleins de gazon et de soucis, les murettes au grillage nickelé, tout cela avait une forme, était plein d’une lueur d’angoisse, chargé d’un sens mauvais. Je venais de comprendre qu’en m’éloignant, en cessant de garder mon regard fixé sur mon monde, c’était moi qui l’avais trahi, qui l’avais abandonné à ses mutations. J’avais regardé ailleurs, j’avais été ailleurs, et pendant ce temps, les choses avaient pu changer.
Où était Aurore, maintenant ? Avec hâte, je marchais le long des rues vides, vers le sommet de la colline. Je voyais les noms des immeubles, écrits en lettres dorées sur leurs frontons de marbre, des noms prétentieux et vides, qui étaient pareils à leurs façades, à leurs fenêtres, à leurs balcons :
« La Perle »
« L’Age d’or »
« Soleil d’or »
« Les Résédas »
« Les Terrasses de l’Adret »
Je pensais alors au mot magique, au mot que je ne prononçais jamais, ni personne, au mot qu’on pouvait seulement voir, gravé au sommet du faux temple grec en stuc, le mot qui emportait dans la lumière, dans le ciel cru, au-delà de tout, jusqu’à un lieu qui n’existait pas encore. Peut-être que c’était lui qui m’avait manqué, pendant toutes ces années d’adolescence, quand j’étais resté loin du jardin, loin de la maison d’Aurore, loin de tous ces sentiers. Maintenant, mon cœur battait plus vite, et je sentais quelque chose m’oppresser, appuyer au centre de moi-même, une douleur, une inquiétude, parce que je savais que je n’allais pas retrouver ce que je cherchais, que je ne le retrouverais jamais plus, que cela avait été détruit, dévoré.
Partout, il y avait ces jardins éventrés, ces ruines, ces plaies béantes creusées dans la terre, en haut de la colline. Sur les chantiers les hautes grues étaient immobiles, menaçantes, et les camions avaient laissé des traînées de boue sur la chaussée. Les immeubles n’avaient pas encore fini de pousser, ils grandissaient encore, mordant dans les vieux murs, abrasant la terre, étendant autour d’eux ces nappes de goudron, ces aires nues de ciment éblouissant.
Je fermais à demi les yeux, luttant contre la réverbération du soleil couchant sur toutes les façades blanches. Il n’y avait plus d’ombres à présent, plus de secrets. Rien que les garages souterrains des immeubles, ouvrant leurs larges portes noires, montrant les couloirs brumeux de leurs fondations.
Par instants, je croyais reconnaître une maison, un mur, ou bien même un arbre, un vieux laurier qui avait survécu à la destruction. Mais c’était pareil à un reflet, cela s’allumait et s’éteignait aussitôt, avant même que j’aie pu le savoir, et il ne restait plus rien alors que la surface vide de l’asphalte, et les hauts murs qui interdisaient le ciel.
J’ai erré longtemps au sommet de la colline, à la recherche de quelque trace, d’un indice. Le soir commençait à tomber, la lumière devenait trouble et faible, les merles volaient lourdement entre les immeubles, à la recherche d’un lieu pour dormir. Ce sont eux qui m’ont guidé jusqu’à la villa Aurore. Tout d’un coup je l’ai vue. Je ne l’avais pas reconnue, parce qu’elle était en contrebas de la grande route circulaire, tellement enfoncée sous le mur de soutènement, au creux du virage, que je ne voyais que son toit-terrasse et ses cheminées. Comment avais-je pu l’oublier pareillement ? Le cœur battant, j’ai traversé la route, en courant entre deux voitures, je me suis approché du grillage. C’était bien elle. Je ne l’avais jamais vue de si près, et surtout, je n’avais jamais imaginé à quoi elle pouvait ressembler, vue d’en haut, comme d’un pont. Alors elle m’est apparue, triste, grise, abandonnée, avec ses hautes fenêtres aux volets fermés, et le plâtre taché de rouille et de suie, les stucs rongés par la vieillesse et le malheur. Elle n’avait plus cette couleur légère, nacrée, qui la faisait paraître irréelle autrefois, quand je la guettais entre les branches basses des lauriers. Elle n’avait plus sa couleur d’aurore. Maintenant, elle était d’un blanc-gris sinistre, couleur de maladie et de mort, couleur de bois de cave, et même la lueur douce du crépuscule ne parvenait pas à l’éclairer.
Pourtant, il n’y avait plus rien qui la cachait, qui la protégeait. Les arbres avaient disparu autour d’elle, sauf deux ou trois troncs d’oliviers, déjetés et tordus, grimaçants, qui poussaient en contrebas de la route, de chaque côté de la vieille maison. En regardant avec attention, je découvrais peu à peu chaque arbre ancien, les palmiers, les eucalyptus, les lauriers, les citronniers, les rhododendrons, chaque arbre que j’avais connu, qui avait été pour moi aussi proche qu’une personne, dans le genre d’un ami géant que je n’aurais pas approché. Oui, ils étaient là, encore, c’était vrai, ils existaient.
Читать дальше