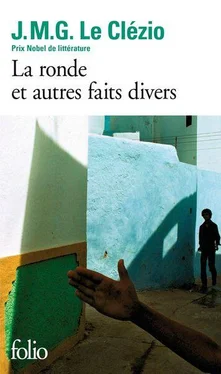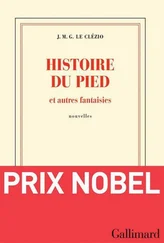Elle ne veut pas entrer chez ses parents, pas encore. Elle veut rester là, immobile, le dos appuyé contre le mur froid, à regarder la nuit, le ciel gris et vague, les grands murs blancs où les centaines de fenêtres sont éclairées. Et les autos immobiles dans le parking, sous les taches des réverbères, les camions arrêtés dans la rue, les lumières de la ville qui s’allument comme des étoiles ternes. Elle veut écouter les bruits confus de la vie dans les appartements, les écouter tous à la fois, et sentir le froid de la nuit. Elle reste longtemps comme cela, immobile contre le mur, jusqu’à ce que le froid ankylose ses jambes, ses bras, ses épaules. Les gouttes d’humidité luisent sur sa veste de plastique blanc, sur ses bottes.
Alors elle recommence à marcher, dans les rues vides, en faisant le tour des blocs d’immeubles. Elle ne sait pas trop où elle va. D’abord vers le bâtiment de l’école, puis elle traverse le petit jardin d’enfants en contrebas de la route, et elle remonte les ruelles où il y a les petites maisons délabrées dans leurs jardins pelés. Elle fait aboyer les roquets contre les grilles, et il y a des chats noirs qui courent sous les voitures arrêtées, devant elle.
Quand elle retrouve les blocs des immeubles, pareils à des géants debout au milieu des terrains et des parkings, elle sent de nouveau la lumière froide et humide des réverbères, et ça la fait frissonner.
Alors le bruit des motocyclettes vient très vite vers elle. Elle l’entend éclater entre les immeubles, sans savoir d’où il vient exactement. Où aller ? Christine voudrait se cacher, parce qu’elle est debout au milieu de la grande rue, et que la lumière des réverbères l’éclaire brutalement. Elle se met à courir vers l’immeuble le plus proche, et elle se plaque le dos au mur à l’instant où le groupe des motards passe à toute allure dans la rue. Ils sont six ou sept, masqués par leurs casques, vêtus de vinyle noir, avec des motos Trial pleines de boue. Christine les regarde tourner au carrefour, elle écoute le bruit des moteurs qui s’éloigne, qui s’éteint.
Tout à coup, elle sent la peur. Elle ne sait pas bien de quoi elle a peur, mais c’est là, en elle, comme un frisson, et aussi autour d’elle, dans le silence des grandes rues vides, des immeubles géants aux centaines, aux milliers de fenêtres, dans la lumière orangée des réverbères, dans le vent froid qui remonte le long de la vallée en portant l’odeur âcre des fumées et la rumeur de l’autoroute. C’est une peur étrange, imprécise, qui serre la gorge de Christine et mouille de sueur son dos et ses paumes, malgré le froid.
Elle marche vite maintenant, en essayant de ne penser à rien. Pourtant, soudain, elle se souvient du regard aigu du patron du Milk Bar, et son cœur se met à battre plus vite, comme si elle sentait encore ce regard sur elle, en train de l’épier, dans l’ombre. Peut-être est-il là, vraiment. Elle se souvient qu’il allait fermer sa boutique, et il l’a regardée après qu’elle est sortie du Milk Bar, quand elle était debout dans la rue.
Et tout d’un coup, à nouveau, les motards sont là. Cette fois, elle ne les a pas entendus venir, ils sont arrivés en même temps que le bruit de leurs motos. Peut-être qu’ils sont venus à petite vitesse, en tournant et en zigzaguant à l’intérieur du parking de l’immeuble, en se faufilant entre les autos arrêtées, pour la surprendre.
Maintenant, Christine est immobile dans le parking, sous la lumière jaune du réverbère qui brille sur ses cheveux blonds, sur sa veste de plastique blanc et sur ses bottes, tandis que les motos tournent lentement autour d’elle. Les motards ont leurs visages masqués par la visière de leurs casques, et aucun d’eux ne semble la regarder, mais simplement ils tournent autour d’elle, en donnant de petits coups d’accélérateur qui font tressauter leurs motos, et bouger la lumière de leurs phares et de leurs feux rouges. À mesure qu’ils tournent, ils rétrécissent leur cercle, et maintenant, ils passent si près d’elle qu’elle peut sentir le souffle chaud des pots d’échappement. Christine reste figée sur place, le cœur battant, les jambes toutes faibles. Elle regarde autour d’elle, vers les grands immeubles, mais les murs sont si hauts, et il y a tellement de fenêtres éclairées, et sur le grand parking, il y a tellement d’autos arrêtées, aux carrosseries pleines de reflets ! Le bruit lent et profond des motos qui tournent fait vibrer le sol, fait vibrer tout son corps, emplit sa tête. Elle sent ses jambes trembler sous elle, et une sorte de vertige s’empare d’elle. Alors, soudain, avec un cri, elle s’élance en avant et elle se met à courir aussi vite qu’elle peut, droit devant elle, à travers le parking.
Mais les motos sont toujours derrière elle, puis tournent autour des autos arrêtées, et reviennent vers elle, en l’aveuglant avec leurs phares, en donnant des coups d’accélérateur qui font retentir les rugissements des moteurs.
Christine ne s’arrête pas. Elle traverse un parking puis elle court le long des grandes avenues, elle longe les murs des immeubles, elle traverse les terre-pleins couverts d’herbe rase. Elle court si vite qu’elle ne peut presque plus respirer, et que le vent froid fait couler des larmes sur ses joues. À force de courir, elle ne sait plus où elle est, elle ne voit autour d’elle, à perte de vue, que les grandes murailles blanches des immeubles tous pareils, les centaines, les milliers de fenêtres identiques, les parkings qui s’ouvrent, avec leurs autos arrêtées, les rues éclairées par les réverbères orange, les terre-pleins d’herbe sale. Puis, comme ils sont venus, les motards ont disparu. À nouveau, le silence lourd, le froid, le vide s’emparent de la cité des H.L.M. et Christine peut entendre à nouveau la rumeur lointaine des autos qui roulent là-bas, sur le grand pont qui traverse le fleuve.
Elle voit où elle est. Sans savoir comment, ses jambes en courant l’ont conduite jusque devant l’immeuble où elle habite. Elle lève les yeux, elle cherche les fenêtres de l’appartement où il y a son père, sa mère et sa petite sœur. Il y a déjà cinq mois qu’ils habitent là, mais elle doit toujours regarder aussi longtemps avant de reconnaître les trois fenêtres, à côté de celles où il y a des pots de géraniums. Les deux fenêtres de la grande chambre sont éclairées, parce que c’est là que son père est assis dans son fauteuil, en train de regarder la télévision en mangeant. Maintenant, Christine est bien fatiguée, et elle est presque contente à l’idée de rentrer dans l’appartement étroit, de sentir l’odeur lourde de la nourriture, d’entendre la voix nasillarde du poste de télévision.
Elle monte les marches de l’escalier, elle pousse la porte d’entrée de l’immeuble, elle met la main sur le bouton de la minuterie. Alors elle les voit. Ils sont là qui l’attendent, tous, avec leurs blousons de vinyle noir et leurs casques aux visières rabattues qui luisent ! dans la lumière de l’escalier.
Elle ne peut pas crier, parce que quelque chose se bloque dans sa gorge, et ses jambes ne peuvent plus bouger. Ils se sont approchés. L’un d’eux, un grand qui a un blouson d’aviateur, et un casque orange avec une visière en plexiglas fume, s’approche tout près d’elle, il la prend par le bras. Elle cherche à se dégager, elle ouvre la bouche, elle va crier. Alors il la frappe, de toutes ses forces, avec son poing, dans le ventre, là où le corps se plie en deux, et la respiration s’arrête. Ils l’entraînent vers la porte qui est à côté de l’ascenseur, et ils descendent l’escalier de ciment qui résonne. On entend les bruits des téléviseurs au rez-de-chaussée, les bruits de la vaisselle, les cris des enfants. Sous terre, la lumière est grise, elle vient de deux ou trois ampoules au milieu des tuyaux et des conduits d’égout. Les motards avancent vite, ils tirent le corps de Christine, ils la portent presque. Ils ne disent rien. IL ouvrent une porte. C’est une cave, à peine quatre ou cinq mètres carrés, du ciment gris, des caisses, et par terre, il y a un vieux matelas. Ils jettent Christine par terre, et l’un des motards allume une bougie, au fond de la cave, en équilibre sur une vieille assiette. La cave est si petite qu’ils sont debout les uns contre les autres. Dehors, la lumière de la minuterie s’éteint, et il n’y a plus que la lueur de la bougie qui vacille. Christine reprend son souffle. Les larmes coulent sur ses joues, barbouillent le rimmel et le fond de teint. Elle claque des dents.
Читать дальше