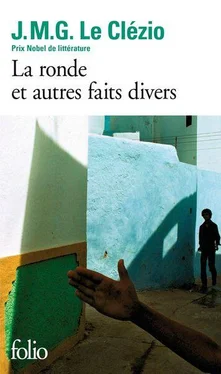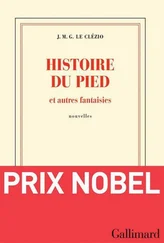Tandis qu’elle marche, de temps en temps elle cherche à se voir, dans les vitres des camionnettes arrêtées, ou bien dans les rétroviseurs extérieurs des gros camions. Elle cherche à se voir, avec un peu d’anxiété, en penchant un peu la tête, les yeux plissés. Dans les petits miroirs convexes, comme au milieu d’une brume bleue, elle voit alors sa silhouette noire et blanche qui avance comme en dansant, longues jambes, longs bras, corps évasé aux hanches, et petit visage en tête d’épingle entouré par ses cheveux couleur d’or. Puis le visage grandit, grossit, jusqu’à se déformer un peu, long nez, yeux noirs écartés comme ceux d’un poisson, bouche couleur cerise qui sourit et montre ses dents très blanches. Autrefois, Christine aurait ri à chaque fois, devant son reflet déformé. Mais maintenant l’anxiété est trop forte, et elle cherche à refaire son vrai visage, son vrai corps, à partir de l’image grotesque, tout en fermant les yeux, lorsqu’elle a dépassé le miroir.
Elle ne sait pas pourquoi elle a tellement besoin de se voir. C’est au-dedans d’elle, cela poigne et fait mal presque, et quand elle a marché longtemps dans la rue sans rien trouver d’autre que son reflet gris dans les vitrines, ou son visage déformé dans les rétroviseurs des autos, elle cherche un miroir, un vrai miroir, n’importe où, dans une entrée d’immeuble, dans les toilettes d’un bar, devant un salon de coiffure. Elle va à lui, elle s’arrête, et elle se regarde longuement, avidement, sans bouger, presque sans respirer, ses yeux fixés dans les yeux de l’autre, jusqu’au vertige.
On ne voit pas le soleil à cause des nuages gris, mais Christine sent qu’il doit être tard. La nuit va venir maintenant, pas trop vite, en remontant le long de la vallée du fleuve, avec le vent. Mais Christine ne veut pas rentrer chez elle. Chez elle, c’est l’appartement aux murs étroits tachés, avec l’odeur lourde de la cuisine qui l’écœure, avec le bruit du poste de télévision, avec les cris des voisins, avec les bruits de la vaisselle, les bruits qui résonnent dans les escaliers de ciment, la porte de l’ascenseur qui grince et cogne, d’étage en étage. Christine pense à son père aussi, à son père assis devant le poste de télévision, les joues mal rasées, les cheveux hirsutes ; elle pense à sa sœur cadette, à son visage pâle aux yeux cernés, à son regard sournois de petite fille de dix ans. Elle pense à elle si fort qu’elle fronce les sourcils et qu’elle murmure quelques mots, sans bien savoir quoi, une insulte peut-être, ou bien seulement, comme cela, « Va-t’en ! » Elle pense aussi à sa mère, avec son visage fatigué, ses cheveux teints, ses membres et son ventre lourd, son silence lourd aussi, comme s’il y avait des tas de choses qui s’y étaient accumulées comme une mauvaise graisse.
Christine ne pense pas vraiment à tout cela, mais elle le perçoit, très vite, images, odeurs, sons qui se bousculent avec tellement de force et de précipitation que cela occulte un instant le paysage des grands parkings et des murs aux trois cents fenêtres identiques. Alors elle s’arrête, elle ferme les yeux, devant ce pays de trop grande blancheur, cette nappe de sel, de neige.
Le vent froid la reprend. Devant elle, en bas de l’immeuble géant, il y a le Milk Bar. C’est là que Christine aime bien aller, pour faire passer le temps, quand elle sort de l’école, avant de rentrer dans l’appartement étroit où il y a son père, sa mère silencieuse, et le regard sournois de sa sœur. Elle monte les marches gaiement, elle pousse la porte de verre, et elle sent avec plaisir l’odeur qu’elle aime, l’odeur de vanille, de café, de cigarette. Aujourd’hui, il n’y a personne dans le Milk Bar. Tout le monde est allé se promener en ville, au bord de la mer, ou bien en moto dans la montagne. Il n’y a que le patron du Milk Bar, un gros homme avec des lunettes, qui est assis derrière le comptoir et qui lit le journal. Il est penché sur le journal, et il lit chaque ligne avec tellement d’attention qu’il ne prête même pas garde à Christine quand elle entre, et qu’elle s’assoit près de la fenêtre à une table de matière plastique.
Qu’est-ce qu’il peut lire avec une pareille attention ? Mais Christine n’y pense même pas, ça lui est égal. Elle aime bien être assise là, les deux coudes sur la table de plastique, à regarder dehors, à travers la vitre.
Maintenant, la nuit est en train de tomber. Dans la rue vide, sous le ciel gris, l’ombre avance lentement, s’installe. De temps en temps, il y a quelqu’un qui passe, à pied, et qui regarde vers l’intérieur du Milk Bar, puis continue sa route. Christine voudrait bien savoir l’heure, mais elle n’ose pas la demander au patron qui continue à lire son journal mot par mot, comme s’il n’arrivait pas à comprendre ce qu’il lisait.
Et puis Cathie est passée devant le Milk Bar, et elle a reconnu Christine. Elle a fait de grands gestes, et elle est entrée en trombe dans le café, en parlant si fort que le patron s’est même réveillé. Cathie est plus grande et plus forte que Christine, avec un visage plein de taches de rousseur et des cheveux noirs frisés. Elle est plus âgée aussi, elle doit avoir seize ou dix-sept ans, mais Christine réussit à avoir l’air d’être du même âge, à cause de ses vêtements, des talons hauts, et du fard. Le patron du Milk Bar s’est levé de son tabouret et il est venu devant les deux filles.
« Qu’est-ce que vous prenez ? »
« Un café noir », dit Cathie.
« Et un crème pour moi », dit Christine.
Le patron les a regardées encore, attendant qu’elles disent autre chose. Puis il a grommelé :
« Bon, mais je vais fermer dans dix minutes. » Cathie est toujours comme ça : elle parle trop, trop vite, en faisant trop de gestes, et ça saoule un peu Christine, surtout qu’elle n’a pas mangé depuis ce matin, et qu’elle a marché toute la journée dehors, dans les rues vides, le long des places, au bord de la mer. Et puis Cathie dit du mal de tout le monde, c’est une véritable langue de vipère, et ça aussi, ça fait tourner la tête, comme un manège qui va trop vite.
Heureusement qu’il fait nuit dehors, maintenant. En dépit de son avertissement, le patron du Milk Bar ne semble pas avoir envie de fermer tout de suite. Il lit toujours son journal, mais avec moins d’attention, en relevant souvent la tête pour regarder les filles. Christine jette un coup d’œil de son côté, et elle surprend son regard brillant attaché sur elle. Elle rougit, et elle tourne la tête brusquement vers la vitre.
« Viens ! » dit-elle soudain à Cathie. « On s’en va ! »
Et sans attendre, elle paie le café-crème sur la table de plastique, et elle sort. Cathie la rejoint au bas de l’escalier.
« Qu’est-ce que tu as ? Tu veux rentrer ? »
« Non, rien », dit Christine. Mais maintenant qu’elle est dehors, elle se rend compte qu’il faut penser à nouveau à l’appartement au mur taché, à la télévision qui parle toute seule, au visage buté de son père, au corps fatigué de sa mère, au regard de sa sœur.
« Bon, allez, salut, moi je vais rentrer », dit Cathie. Elle a l’air de s’ennuyer tout à coup. Christine voudrait bien la retenir, elle fait un geste.
« Écoute, est-ce que — »
Mais elle ne sait pas quoi dire. La nuit est froide, le vent souffle. Cathie relève le col de sa veste bleue, et elle fait un geste de la main, et elle s’en va en courant. Christine la regarde entrer dans l’immeuble en face, allumer la minuterie. Elle attend un instant devant une porte du rez-de-chaussée, puis la porte s’ouvre, se referme. Cathie a disparu.
Christine fait quelques pas dans la rue, jusqu’à l’angle du parking. Elle s’abrite contre le mur, dans une tache d’ombre. Le froid de la nuit la fait frissonner, après la chaleur parfumée du Milk Bar. Devant elle, le ciel gris est devenu rose et luminescent du côté de la ville, avec la barre lourde qui traîne encore au-dessus des cheminées de l’usine de crémation. Il n’y a pas de bruit, c’est-à-dire, pas de bruit signifiant. Seulement le grondement sourd des autos et des camions, là-bas, sur le pont de l’autoroute, et les bruits des hommes et des enfants dans les appartements, ou les voix nasillardes des postes de télévision.
Читать дальше