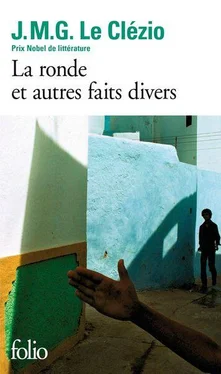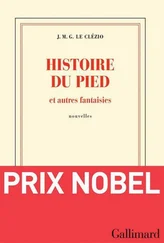« Déshabille-toi. »
La voix du grand a résonné dans la cave étroite, une voix dure et rauque que Christine ne connaît pas. Comme elle ne bouge pas, il se penche sur elle, et il tire sur sa veste, déchire le col. Alors Christine a peur, et clic pense à ses habits qui vont être déchirés. Elle enlève sa veste, la pose par terre. Elle va à l’autre bout de la cave, tout près de la bougie, et elle ôte son tricot rayé, elle défait la fermeture des bottes, elle fait glisser son pantalon, puis son slip et son soutien-gorge. Elle grelotte nue dans le froid de la cave, l’air efflanquée et maigrichonne, ses dents claquent si fort qu’elle sait qu’elle ne pourrait même pas crier ; elle pleure un peu, en geignant, et les larmes continuent à souiller ses joues de rimmel et de fard. Puis le garçon s’approche d’elle, il défait sa ceinture. Il la pousse sur le matelas et s’étend sur elle, sans ôter son casque. Les autres s’approchent et elle voit leurs visages penchés sur elle, elle sent leur haleine sur sa peau. Interminablement, l’un après l’autre, ils l’ouvrent, ils la déchirent, et la douleur est si grande qu’elle ne sent plus la peur ni le froid, mais seulement le vertige qui se creuse en elle, qui l’écrase plus loin que son ventre, plus bas, comme si le matelas mouillé tombait au fond d’un puits glacé et noir brisant ses reins. Cela dure si longtemps qu’elle ne sait plus ce qui s’est passé. Chaque fois qu’un garçon entre en elle, en forçant, la douleur grandit dans son corps et l’entraîne au fond du puits. Les mains écrasent ses poignets contre le sol, écartent ses jambes. Les bouches s’appliquent sur sa bouche. | mordent ses seins, étouffent sa respiration.
Puis la bougie tremble un peu plus et se noie dans sa cire. Alors tout s’arrête. Il y a un silence, et le froid est si terrible que Christine se roule en boule sur le matelas, elle s’évanouit.
Quand la lumière électrique revient, elle voit la porte de la cave ouverte, et les motards sont debout dans le couloir. Elle sait que c’est fini. Elle se lève, elle s’habille, elle sort de la cave en titubant. Son ventre brûle et saigne, ses lèvres sont gonflées, tuméfiées. Les larmes ont séché sur ses joues avec le rimmel et le fard.
Ils la poussent devant eux dans l’escalier de ciment. Dans l’entrée, seul reste le grand, avec son casque et son blouson d’aviateur. Avant de s’en aller, il se penche sur Christine, sa main se pose sur son cou.
« Salaud ! » dit Christine, et sa voix tremble de rage et de peur. Mais lui fait peser sa main sur son épaule.
« Si tu parles, on te tue. »
Christine s’assoit dehors, sur les marches de l’escalier. Elle reste longtemps là, sans bouger, pour que le froid la rende insensible, pour que le noir de la nuit l’enveloppe et calme la douleur de son ventre et les meurtrissures de ses lèvres. Puis elle cherche, dans le parking, une voiture arrêtée avec un grand rétroviseur extérieur, et lentement, avec une application de petite fille, elle essuie le rimmel de ses yeux, et elle étale le fond de teint de ses joues bleuies.
Depuis toujours, Aurore existait, là, au sommet de la colline, à demi perdue dans les fouillis de la végétation, mais visible tout de même entre les hauts fûts des palmiers et des lataniers, grand palais blanc couleur de nuage qui tremblait au milieu des ombres des feuillages. On l’appelait la villa Aurore, bien qu’il n’y ait jamais eu de nom sur les piliers de l’entrée, seulement un chiffre gravé sur une plaque de marbre, qui a disparu bien avant que j’aie pu me souvenir de lui. Peut-être qu’elle portait ce surnom à cause de sa couleur de nuage justement, cette teinte légère et nacrée pareille au ciel du premier matin. Mais tout le monde la connaissait, et elle a été la première maison dont je me souvienne, la première maison étrangère qu’on m’ait montrée.
C’est aussi à cette époque-là que j’ai entendu parler de la dame de la villa Aurore, et on a dû me la montrer peut-être, parfois, en train de se promener dans les allées de son jardin, coiffée de son grand chapeau de jardinier, ou bien en train de tailler les rosiers, près du mur d’entrée. Mais je garde d’elle un souvenir imprécis, fugitif, à peine perceptible, tel que je ne peux être tout à fait sûr de l’avoir réellement vue, et que je me demande parfois si je ne l’ai pas plutôt imaginée. J’entendais souvent parler d’elle, dans des conversations (entre ma grand-mère et ses amies, principalement) que j’écoutais distraitement, mais où elle ne tardait pas à faire figure d’une personne étrange, une sorte de fée peut-être, dont le nom même me semblait plein de mystères et de promesses : la dame de la villa Aurore. À cause de son nom, à cause de la couleur nacrée de sa maison entraperçue au milieu des broussailles, à cause du jardin aussi, si grand, si abandonné, où vivaient des multitudes d’oiseaux et de chats errants, chaque fois que je pensais à elle, chaque fois que j’approchais de son domaine, je ressentais un peu le frisson de l’aventure.
Plus tard, j’appris avec d’autres garnements la possibilité d’entrer dans son domaine, par une brèche dans le vieux mur, du côté du ravin, à l’ubac de la colline. Mais à cette époque-là, nous ne disions plus la dame de la villa Aurore, ni même la villa Aurore. Nous en parlions avec une périphrase qui avait été certainement inventée pour exorciser le mystère de la première enfance, et pour justifier notre entrée : nous disions : « Aller au jardin des chats errants », ou bien « passer par le trou du mur ». Mais nous restions prudemment dans la partie abandonnée du jardin, celle où vivaient les chats, et leurs portées miraculeuses de chatons aveugles, et deux ou trois statues de plâtre abandonnées à la végétation. C’est à peine si, lors de ces jeux de cache-cache et ces expéditions de reconnaissance à travers la jungle des acanthes et des lauriers-sauces, j’apercevais parfois, très loin, comme irréelle, la grande maison blanche aux escaliers en éventail entourée des fûts des palmiers. Mais pas une fois je n’entendis la voix de la propriétaire, pas une fois je ne la vis sur les marches de l’escalier, dans les allées de gravier, ni même derrière le carreau d’une fenêtre.
Pourtant, c’est une chose étrange aussi quand je pense à cette époque, c’est comme si nous savions tous que la dame était là, qu’elle habitait dans cette maison, qu’elle y régnait. Sans jamais la voir, sans la connaître, sans même savoir quel était son vrai nom, nous étions conscients de sa présence, nous étions ses familiers, ses voisins. Quelque chose d’elle vivait alors dans ce quartier, en haut de la colline, quelque chose que nous ne pouvions pas voir vraiment, mais qui existait dans les arbres, dans les palmiers, dans la silhouette de la maison blanche, dans les deux piliers de pierre de l’entrée et dans la grande grille rouillée fermée par une chaîne. C’était un peu comme la présence de quelque chose de très ancien, de très doux et de lointain, la présence des vieux oliviers gris, du cèdre géant marqué par la foudre, des vieux murs qui entouraient le domaine comme des remparts. C’était aussi dans l’odeur chaude des lauriers poussiéreux, dans les massifs de pittospores et d’orangers, dans les haies sombres de cyprès. Jour après jour, tout cela était là, sans bouger, sans changer, et on était heureux sans le savoir, sans le vouloir, à cause de la présence de la dame qui était au cœur du domaine.
Les chats aussi, on les aimait bien. Quelquefois il y avait des garnements qui les chassaient devant eux à coups de pierres, mais quand ils franchissaient la brèche du mur, ils cessaient leur poursuite. Là, dans le jardin, à l’intérieur des murs, les chats errants étaient chez eux, et ils le savaient. Ils vivaient par meutes de centaines, accrochés aux rochers de l’ubac, ou bien à demi cachés dans les creux du vieux mur, se chauffant au soleil pâle de l’hiver.
Читать дальше