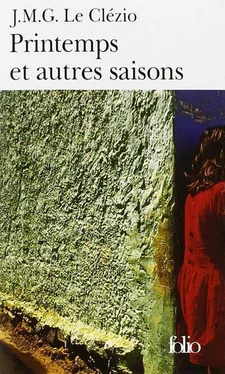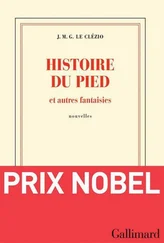« Tu te souviens ? » Mais je ne savais plus de quoi il fallait se souvenir. Il y avait tant de choses, et peut-être qu’aucune n’était vraiment vraie.
Je suis partie. Je suis allée jusqu’à la maison de Monsieur Herschel, en haut de la colline des Baumettes, je me suis assise sur les marches de l’escalier. J’aimais bien ce jardin. La maison s’appelle la Roseraie, mais le Colonel dit toujours qu’on devrait bien l’appeler la maison des acanthes, parce qu’il y en a tellement, et si belles, avec leurs tiges bien droites au-dessus des feuilles en plateau, et toutes ces fleurs épineuses blanches et mauves comme des fleurs de chardon.
L’année où on a quitté Nightingale, c’était à la fin de l’été, je m’en souviens bien. Au printemps, il y avait tant de fleurs d’anthurium dans les serres. Tous les cartons étaient prêts dans les hangars, avec le dessin du rossignol fait par Amie. Monsieur Herschel allait à chaque instant voir les fleurs coupées, il vérifiait les emballages dans le papier de soie. On attendait son ami Monsieur Buisson. Il devait venir avec son camion pour emporter les fleurs jusqu’à l’aéroport. Il avait passé un accord avec une compagnie d’avions-cargos. Les fleurs avaient leur place pour Paris, pour Bruxelles, pour Francfort. C’était la première fois. Bientôt il y aurait des cartons avec le dessin d’Amie dans toutes les boutiques de fleuristes du monde. Je serais l’ambassadrice des fleurs, j’irais partout pour en parler. Avec Amie, nous irions dans les beaux hôtels, dans les restaurants. Les fleurs ouvriraient leurs calices couleur de corail dans les plus belles maisons du monde.
Mais Monsieur Buisson n’est pas venu avec son camion, ni ce jour-là, ni les autres jours. Le Colonel a téléphoné, il a cherché d’autres camions, il a pris sa voiture avec une dizaine de cartons sur la banquette arrière. Il n’a rien trouvé. Il n’y avait pas d’avion-cargo réservé. Tout était faux, inventé. Monsieur Buisson était parti avec la provision que lui avait donnée le Colonel. C’était un traître. Il avait vendu tout ce qu’il possédait, et il avait levé le camp. Les fleurs sont mortes dans leurs cartons, comme dans de petits cercueils. Celles qui n’avaient pas été coupées ont flétri sur leurs tiges, parce qu’il faisait trop chaud dans les serres. Alors le Colonel a fait un grand tas avec les fleurs et les cartons, et il a tout brûlé. Ça a fait une grande fumée grise qui sentait mauvais, comme quand les champs de blé brûlaient, à cause des pinces à linge des insurgés. C’était plus que jamais l’été des incendiaires.
Nous avons quitté Nightingale. Je ne savais pas où j’allais. J’étais à nouveau une Zayane. Je ne pouvais pas avoir de maison.
Le soir, il y a les cris angoissés des merles dans les jardins. Ils volent de plante en plante, à la recherche d’un endroit où passer la nuit. Mais peut-être que ce n’est pas cela qui les inquiète. C’est la nuit qui vient, l’ombre qui grandit, le soleil qui s’éteint derrière la terre. Ils sentent le froid de l’espace, ils voient la lumière bleue de la lune, ou bien quelque chose se déchire en eux, leur fait mal.
Le ciel devient jaune. Les fenêtres de la maison aux acanthes s’allument dans le soleil couchant. Le faîte des palmiers est encore dans la lumière, et en bas, la nuit unit les feuilles des acanthes comme sur l’eau d’un lac. Il y a des sortes de moustiques tigrés qui se posent sur moi, piquent mes bras, mes chevilles.
Je sais ce qui me manque ici. C’est peut-être pour cela que les cris des merles me font tressaillir. Quand la nuit arrivait à Mehdia, je m’en souviens, avec Amie nous marchions jusqu’à l’estuaire du fleuve, jusqu’aux murs de la ville. Nous passions par la porte de la mer, et nous entrions dans le palais en ruine qui ressemblait à la demeure des génies. Nous marchions entre les murs effondrés, couverts de ronces. Nous entendions les cris des oiseaux.
C’était un soir, peut-être le dernier soir que nous avons passé dans ce pays, je ne me rappelle plus. L’air était doux et léger, le ciel était jaune comme maintenant, avec des bandes de nuages. Je ferme les yeux à demi, il me semble y être encore. Amie me tenait par la main. Sa main était douce et tiède, je la serrais très fort, il me semblait que nous nous parlions ainsi. Avec elle je regardais le ciel, la mer, le fleuve qui semblait arrêté par la marée. Il y avait des bateaux de pêche qui entraient lentement dans l’estuaire, leurs longues voiles effilées penchées comme des ailes. Je savais que je ne verrais plus jamais cela. Je savais que même si je le voulais très fort, même si je revenais, je ne le verrais plus. J’avais des larmes dans les yeux, et en même temps je voulais tout voir, tout prendre, comme si je devais passer le restant de ma vie à m’en souvenir.
À un moment, Amie a dit : « Ecoute ! » Par la porte de la mer, dans le vent léger, j’ai entendu la voix du muezzin qui appelait. Très loin, pareille à un mince fil se déroulant dans l’air, on l’entendait sans l’entendre, je veux dire, pas seulement avec les oreilles, mais aussi avec les yeux, avec le visage, avec la respiration, c’était léger et précis, c’était un regard, une couleur, un frisson.
Maintenant, ici, dans le jardin abandonné, où Amie ne vient plus, j’entends cette voix, elle m’unit à l’autre côté du monde, à l’autre versant de ma vie.
J’ai redescendu la colline des Baumettes, par les escaliers et les ruelles qui vont tous vers les grandes avenues, comme les ruisseaux vers les fleuves. La nuit brillait de tous les côtés. Je me souviens, au début, quand j’allais m’asseoir sur le pas des portes, et que je regardais les lumières des cafés, les hommes, les filles fardées, en attendant que l’amant de ma mère s’en aille de chez elle. À présent, tout cela me paraît si loin, si différent. Peut-être que je suis vraiment devenue quelqu’un d’autre.
J’ai commencé à marcher dans les rues de la vieille ville. Il y avait beaucoup de monde dehors. Des vieux, des jeunes, des gens d’ici et d’ailleurs. Dans les bistros, la musique arabe gémissait. Il y avait des odeurs de restaurants italiens, de la friture, du café. Il y avait de vieilles femmes habillées en noir assises sur leurs chaises devant leur porte, des enfants qui couraient en criant. À un moment, j’ai été reconnue par des enfants. Ils m’entouraient, ils criaient : « Saba ! Saba ! » C’était bizarre, ça me faisait quelque chose d’entendre mon nom. Il y en a un qui m’a accompagnée jusqu’à la Loge. Il était très brun, avec de grands yeux de velours. « Toi, comment tu t’appelles ? » Je lui ai demandé cela. Il m’a dit : « Moi, je m’appelle Rachid. » Il marchait un peu en retrait, sans me quitter des yeux. Il avait un pantalon taché, et de vieux baskets trop grands. « Il y a longtemps que tu es ici ? » Quand je lui parlais, il se rapprochait un instant. « Moi ? Hier soir. » En passant, il m’a montré une porte. « J’habite ici. »
Un peu plus loin, la boulangerie était ouverte. La belle dame italienne était sur le pas de la porte. Quand je suis passée, elle m’a souri, elle a dit : « Attendez. » Elle est revenue avec une miche. « Elle m’est restée de cet après-midi. »
On est arrivés devant la porte de ma maison. J’ai donné la miche à Rachid. « Bon. Au revoir, Rachid. » Il a dit seulement merci, et il est reparti en courant vers la place.
Dans l’escalier, en passant, j’ai dit bonsoir à Semmana, comme chaque soir. Elle avait l’air fatigué, elle avait un pansement sur la tempe, là où son mari l’avait frappée. Mais ses beaux yeux verts brillaient de la lumière que j’aime. Elle m’a dit, comme elle dit toujours : « C’est bien, ma fille. C’est bien. »
Читать дальше