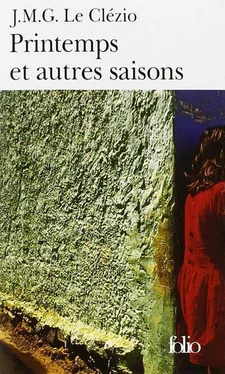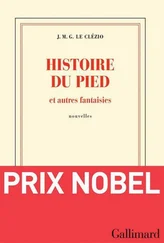Dans cette ville, entre midi et deux heures, les gens mangent. C’est bizarre comme ils mangent. Si on leur disait que midi est à deux heures, ils mangeraient entre deux et trois. Je marche dans les rues vides. Il n’y a personne, les autos sont rangées le long des trottoirs (et quelquefois sur les trottoirs). Il n’y a que quelques vieilles, quelques pigeons, deux ou trois paumés qui ont perdu l’heure. Je marche en chantonnant tout ce qui me passe par la tête, One potato, two potatoes, et la chanson de Gershwin, Wadoo wadoo, Zimbanbaddledoo Zimbanbaddledoo, Bee Bee Bee Bee, Bee Bee Bee, Scatty wy, Scatty wy yeah !
Comme je ne savais plus où aller, je suis allée au bord de la mer, sur la plage. Je me suis assise contre le mur de soutènement, à l’abri du vent, pour essayer de fumer encore une de ces fameuses cigarettes américaines. Je n’aime pas la fumée des cigarettes quand je suis enfermée. Ce que j’aime, c’est voir la fumée tourbillonner dans le vent, au soleil. Comme je n’ai pratiquement rien mangé depuis hier, la cigarette me fait tourner la tête. Quand je ferme les yeux, il me semble que la terre bascule en arrière et que l’horizon se redresse comme un mur. C’est une impression étrange, pas vraiment désagréable. J’aime bien penser à la mer comme à un mur, et à tout ce qui se trouve de l’autre côté.
Il y a quand même quelques gens qui marchent sur cette plage. Ils sont dégingandés, ils trébuchent sur les cailloux, ils ressemblent à de grands échassiers. Il y a aussi des pêcheurs immobiles, et des clochards qui dorment. Maintenant le bruit des autos a recommencé, il emplit de nouveau les rues. Les gens ont fini de manger. Au lycée, les enfants sont assis sur leurs chaises, ils écoutent parler les professeurs. Si on y pense, ça aussi c’est une chose bizarre, tous ces gens assis, partout. Assis pour écouter, pour manger, pour écrire, pour conduire les autos. Moi, ce que j’aime, à part marcher, c’est être couchée. Je pense que ma mère non plus ne devait pas aimer être assise. Elle marchait sur les routes de poussière, comme mon père, elle marchait devant son ombre, ou bien sur les routes, en Allemagne, en Hollande, ou dans les rues de Paris. Quand ma mère revient de l’atelier Atlas, elle se met dans l’alcôve, et elle se couche. Quand mon père a quitté ma mère, l’année de ma naissance, il a dû s’engager comme marin sur un chalutier qui voyageait le long de la côte d’Afrique, pour pêcher les homards en Mauritanie. Je suis sûre que c’est comme ça qu’il a débarqué un jour à Marseille, et qu’il est mort. Peut-être qu’il est tombé du haut d’un de ces immeubles vertigineux qui sont comme des falaises grises au bord des routes. Ou bien il a été poignardé sur la Canebière, pour une question d’argent, pour un mot, pour rien, et il est mort par terre pendant que les gens faisaient un détour.
C’est pour cela que j’ai voulu m’en aller, je crois, pour savoir qui était cet homme. Pour faire comme lui. J’ai dit à ma mère, sans crier, avec une voix dure, je lui ai dit : « Je ne veux plus qu’il vienne. » Elle m’a regardée. « Qui ? De qui tu parles ? » Elle savait ce que je voulais dire. J’ai dit : « Gianni. L’Italien. S’il revient ici, c’est moi qui m’en irai. » Elle s’est mise en colère. Elle a crié, avec son drôle d’accent d’Afrique qui déforme tout : « Si tu continues, je te ferai enfermer. Je te mettrai en maison de correction. »
Mais le soir, quand je suis revenue, et que j’ai tourné la clef dans la serrure, j’ai compris que Gianni ne reviendrait pas. Dans l’appartement, il n’y avait plus ses affaires, la petite valise avec son imprimé pied-de-poule, et son poste de radio à transistors et antenne avait disparu aussi. Ça m’a fait un drôle d’effet. C’était la première fois que ma mère faisait quelque chose pour moi.
Quand elle est arrivée, j’avais préparé à manger. J’ai été gentille avec elle, je l’ai embrassée, j’ai versé de l’eau dans son verre. Je parlais avec elle, gaiement, comme si nous étions de vieilles amies. Je lui posais des questions, je lui racontais ma journée, les copines de classe, les bêtises qu’elles disaient. Je lui ai dit que j’avais trouvé cette personne qui avait besoin de moi pour garder son fils en fin de semaine, une parfumeuse avec un drôle d’accent, Morgane dit qu’elle est libanaise. Mais je ne lui ai pas parlé de Morgane. Je sais qu’elle ne l’aimerait pas. Elle ne voudrait pas qu’on se voie.
Ce que je voulais, c’était lui poser des questions, sur mon père. Qu’elle me parle de lui, comment il s’appelait, comment elle l’a connu, comment elle est partie avec lui. Elle avait seize ans, et tout de suite j’ai été dans son ventre. Quand je suis née, il est parti. Il n’a rien dit, il n’a pas écrit, il n’a pas envoyé d’argent. Puis il est mort.
Je suis retournée dans le petit jardin qui tourne le dos à la mer. Naturellement, Green n’y est pas. Il travaille à son journal, il fait des reportages. Les nuages passent devant le soleil, il fait froid, et je me sens très seule. Je pense que si je mourais, ou si je partais pour la Belgique, il n’y aurait rien de changé pour les autres. Le Colonel continuerait à remuer ses souvenirs dans la grande chambre de la maison aux acanthes, Amie continuerait sa vie dans la chambre de la clinique, à côté de la vieille dame sourde. Ma mère dormirait dans l’alcôve, chaque nuit, après son travail aux ateliers Atlas. Elle mettrait toujours la vieille bouilloire cabossée sur le camping-gaz, pour préparer son thé amer. Peut-être que Gianni recommencerait à venir, il ramènerait sa petite valise pied-de-poule et son fameux poste de radio à antenne, pour écouter les ondes du monde entier, le matin, à l’heure du café.
Rien ne bougerait, rien ne changerait. Même Semmana continuerait sa vie dans le petit appartement obscur du premier, sans jamais voir le soleil, douce et résignée comme une tourterelle en cage. Peut-être qu’elle serait la seule qui penserait à moi quand je n’y serais plus. Je me souviens comme elle me parlait, rien qu’avec son regard, quand j’étais malade. J’ai très envie de la voir, de monter l’escalier et de frapper à sa porte, pour voir son visage encore une fois.
Mais je ne suis plus seule tout à coup. À côté de moi, sur le banc, il y a un homme d’un certain âge, avec des cheveux gris. Il n’a pas la peau très nette, plutôt fripée comme du vieux papier, et ses habits sont chiffonnés aussi. Il a posé son journal sur le banc, à côté de moi. J’ai vu les titres : Mitsouko, la belle Eurasienne et L’Homme a vaincu l’espace ! Je veux penser à autre chose. J’essaie d’écrire une lettre. Dans mon sac Liberty j’ai pris le cahier de littérature de Mademoiselle Risso, et j’ai arraché une double feuille. À qui vais-je écrire ? Au début, j’ai cru que j’allais écrire à Morgane, et puis au bout d’un instant, c’était plutôt à Green. J’ai même mis, quelque part : « voyez-vous, cher Monsieur… » Maintenant, je ne sais plus. D’ailleurs, j’ai bien trop froid pour écrire. Ça doit être parce que je n’ai rien pris depuis hier, juste un café noir ce matin. Et puis, il devient difficile de se concentrer avec cet étrange bonhomme à côté de moi, qui s’agite et toussote sans arrêt.
Il a poussé son journal, et maintenant il est assis tout près, je sens sa jambe qui touche la mienne, et son odeur, pas très nette non plus. Je le regarde avec étonnement, et lui penche un peu sa figure vers moi, il a de drôles d’yeux vides et tristes comme ceux d’un chien. Il dit quelque chose, j’ai du mal à comprendre. Je dis : « Quoi ? Qu’est-ce que vous dites ? »
Читать дальше