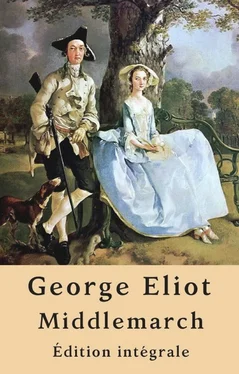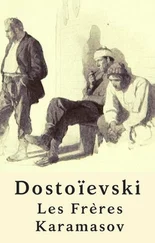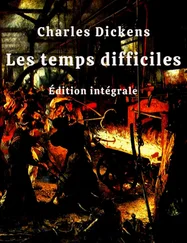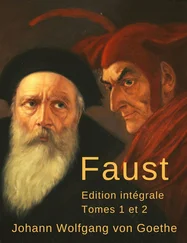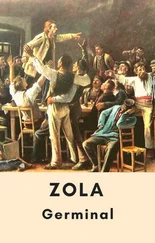L’orgueil de Lydgate avait de l’arrogance, il n’était jamais impertinent, jamais niaisement satisfait de lui-même, mais entier dans ses prétentions, et dédaigneux avec bienveillance. Il était tout disposé à rendre service aux imbéciles, en les plaignant et avec le sentiment qu’ils ne pourraient jamais rien sur lui : pendant son séjour à Paris, il avait songé un moment à se joindre aux saints-simoniens, à seule fin de les mettre en contradiction avec certaines de leurs doctrines. Tous ses défauts portaient l’empreinte distincte de la famille dont il descendait, c’étaient les défauts d’un homme qui a une belle voix de baryton, qui porte bien l’habit, et dont les mouvements les plus indifférents ont toujours un air de distinction native. Où sont donc les petits côtés de cet homme-là, demandera une jeune personne éprise de cette grâce aisée de gentilhomme ? Comment pourrait-on trouver quelque chose de vulgaire chez un homme si bien né, animé d’une si noble ambition, si généreux et si particulier dans sa manière de comprendre les devoirs sociaux ? Tout aussi facilement qu’on peut rencontrer de la stupidité chez un homme de génie, abordé à l’improviste sur un sujet qui lui est étranger ; tout de même qu’un homme animé du désir d’avancer par de généreuses réformes le millénaire social pourra être assez mal inspiré dans le choix des distractions et des plaisirs qu’il compte y introduire ; il peut être incapable de s’élever au-dessus de la musique d’Offenbach, ou des bouffonneries de la farce à la mode. Les petits côtés du caractère de Lydgate se trouvaient précisément dans la nature de ses préjugés, qui, en dépit de la noblesse et de la bienveillance de ses intentions, étaient, pour la plupart, semblables à ceux qu’on rencontre ordinairement chez les hommes du monde : la distinction d’esprit qui appartenait à son ardeur intellectuelle ne pénétrait pas toujours ses sentiments ou son jugement, en matière de mobilier par exemple, ou à propos des femmes ; elle ne l’empêchait pas de souhaiter que l’on sût à Middlemarch, sans qu’il eût à le dire, qu’il était d’une naissance plus relevée que les autres médecins de campagne. Il était loin, quant à présent, de se préoccuper d’un mobilier pour lui-même ; mais, s’il avait un jour à y songer, ni la biologie ni ses projets de réforme ne suffiraient sans doute à l’élever au-dessus de ce sentiment vulgaire qui lui aurait fait voir une choquante inconvenance dans le choix d’un mobilier qui ne fût pas d’une suprême distinction.
Quant aux femmes, il avait été emporté une fois par une folle et impétueuse passion qu’il pensait bien devoir être la dernière, le mariage, à un âge plus mûr, ne pouvant plus avoir cette impétuosité. Pour qui veut connaître Lydgate, il sera bon de savoir ce qu’avait été cette impétueuse folie, exemple de la passion irrésistible et désespérée, alliée chez lui à cette bonté chevaleresque, qui faisait aimer son être moral. L’histoire peut être contée en peu de mots. C’était pendant qu’il faisait ses études à Paris et précisément à une époque où il s’occupait, à côté de son travail, d’expériences de galvanisme. Un soir, fatigué de ses expériences, il laissa ses grenouilles et ses lapins se reposer des chocs mystérieux auxquels il les soumettait, et alla finir sa soirée au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Ce n’était pas le mélodrame qui l’attirait, il l’avait déjà vu plusieurs fois, mais une actrice dont le rôle était de poignarder son amant. Lydgate était amoureux d’elle, comme un homme peut l’être d’une femme à laquelle il n’espère pas pouvoir jamais parler. C’était une Provençale aux yeux noirs, au profil grec, avec des formes pleines et majestueuses, dont la voix était un mélodieux roucoulement. Elle n’était arrivée que depuis peu à Paris et s’y était fait une réputation de vertu, c’était son mari qui jouait avec elle le rôle de l’amant infortuné.
Le seul délassement de Lydgate était alors d’aller de temps à autre se plonger dans la contemplation de cette femme, comme il aurait été se jeter sur un banc de violettes, pour y respirer la douce brise du sud. Mais, ce soir-là, une catastrophe nouvelle vint s’ajouter au drame. Au moment où l’héroïne devait tuer son amant, et celui-ci s’affaisser avec grâce, l’actrice poignarda réellement son mari, qui tomba comme frappé à mort. Un cri sauvage traversa la salle, et la Provençale tomba évanouie : son rôle demandait un cri et un évanouissement, mais cette fois l’évanouissement n’était pas simulé. Lydgate s’élança et grimpa sur la scène, sachant à peine ce qu’il faisait, s’empressant de porter secours. C’est ainsi qu’il fit la connaissance de son héroïne. Tout Paris retentit de l’histoire de cette mort. Était-ce un assassinat ? Quelques-uns des plus chauds admirateurs de l’actrice inclinaient à la croire coupable et ne l’en aimaient que davantage ; mais Lydgate n’était pas de ceux-là. Il protesta énergiquement de son innocence, et l’espèce de passion impersonnelle que lui avait d’abord inspirée sa beauté se transforma en un sentiment de dévouement et de tendre intérêt à son sort. L’idée d’un crime était absurde ; on n’y pouvait découvrir de motif, le jeune couple paraissait s’adorer ; et il n’était pas sans précédents qu’un faux mouvement eût amené un malheur de ce genre. L’enquête légale se termina par la mise en liberté de madame Laure.
Lydgate avait eu, dans l’intervalle, de fréquentes entrevues avec elle, et il la trouvait de plus en plus adorable. Elle parlait peu, mais ce n’était qu’un charme de plus ajouté à sa beauté ; elle était mélancolique et paraissait reconnaissante ; c’était assez de sa seule présence, comme de celle de la lumière du couchant. Lydgate était anxieux, jusqu’à la folie, de posséder son affection, et sa jalousie redoutait qu’un autre ne la gagnât avant lui et ne lui offrît de l’épouser.
Mais, au lieu de rentrer à la Porte-Saint-Martin, où son fatal accident aurait encore accru sa popularité, elle quitta Paris, abandonnant, sans avertir personne, sa petite cour d’admirateurs.
Lydgate, pour qui la science cessa d’exister dès qu’il se représenta l’infortunée Laure traînant en tous lieux sa douleur, sans rencontrer nulle part d’appui fidèle, Lydgate parvint cependant à savoir que Laure avait pris la route de Lyon. Il la retrouva enfin à Avignon, jouant avec grand succès, et plus majestueuse que jamais, le rôle d’une femme abandonnée. Quand il alla lui parler après la représentation, elle l’accueillit avec sa tranquillité habituelle, qui apparaissait à Lydgate belle et pure comme les profondeurs limpides des eaux, et lui permit de revenir la voir le lendemain. Il était décidé à lui dire alors à quel point il l’adorait et à lui demander de devenir sa femme.
– Vous avez fait ce long voyage, de Paris ici, pour me rejoindre ? lui dit-elle, assise en face de lui, les bras croisés, et le regardant avec de grands yeux étonnés. Tous les Anglais sont-ils comme vous ?
– Je suis venu parce que je ne pouvais vivre sans essayer de vous retrouver. Vous êtes seule, je vous aime ; je viens vous demander de consentir à devenir ma femme. J’attendrai, mais je voudrais de vous la promesse que vous m’épouserez, que vous n’en épouserez pas un autre !
Laure le regarda en silence et avec un rayonnement mélancolique sous ses longues paupières, jusqu’à ce qu’elle le vît rempli d’une certitude enivrante, agenouillé à ses pieds.
– J’ai quelque chose à vous dire, fit-elle de sa voix roucoulante, les bras toujours croisés. Mon pied a réellement glissé.
– Je le sais, je le sais, dit Lydgate. Ç’a été un accident, un coup terrible, une calamité imprévue, mais qui n’a fait que m’attacher davantage à vous.
Читать дальше