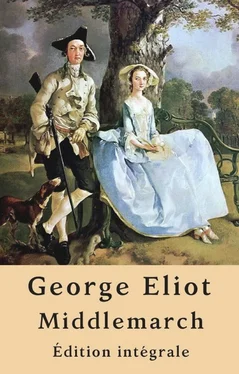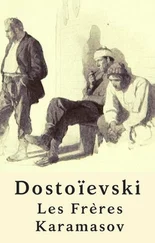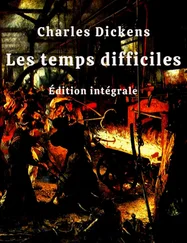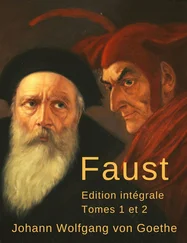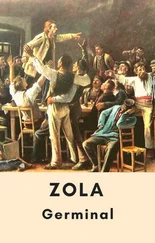Nous avons maintenant à faire connaître à quiconque s’intéresse à lui, le nouveau venu Lydgate, et plus à fond que ne le connaissent ceux mêmes qui l’ont le plus fréquenté depuis son arrivée à Middlemarch. On peut louer, encenser un homme ou le tourner en ridicule, ne voir en lui qu’un instrument, on peut s’éprendre de lui, le choisir comme époux sans qu’il cesse de rester virtuellement inconnu. On avait pourtant l’impression générale que Lydgate n’était pas un médecin de province ordinaire, et, à cette époque, à Middlemarch, une telle impression signifiait qu’on attendait de lui de grandes choses. Chaque famille avait de son médecin une très haute idée et lui supposait une habileté sans bornes dans le traitement des maladies les plus perfides et les plus capricieuses. L’évidence de cette habileté appartenait à l’ordre intuitif le plus élevé. La clientèle féminine, notamment, restait immuablement attachée à son opinion, que la vérité même de la médecine fût d’ailleurs représentée, pour les unes, par le praticien Wrench et son traitement tonique, et, pour les autres, par Toller et le système débilitant. Les temps héroïques des saignées abondantes et des vésicatoires n’étaient pas encore passés, encore moins les temps des théories absolues où, dès qu’une maladie quelconque était baptisée, il ne pouvait plus y avoir d’hésitation dans la manière de la traiter. Pas une imagination ne s’était avancée jusqu’à admettre que M. Lydgate pût être aussi savant que le docteur Sprague ou le docteur Minchin, les deux seuls médecins capables de donner quelque espoir dans les cas extrêmes, alors que le plus faible espoir ne valait pas plus d’une guinée. Pourtant, je le répète, l’impression générale était qu’il y avait en Lydgate quelque chose de plus que chez les autres praticiens ordinaires de Middlemarch.
C’était la vérité. Il n’avait que vingt-sept ans, cet âge auquel on voit des hommes sortir du rang pleins d’espoir dans le succès, fermes dans leur résolution, sûrs que Mammon ne leur mettra jamais un mors à la bouche et ne leur montera jamais à califourchon sur le dos pour les stimuler, mais plutôt que Mammon, s’ils ont affaire à lui, les aidera à pousser leur char. Il était resté orphelin au moment où il sortait du collège. Son père n’avait amassé au service militaire que bien peu de chose pour ses trois enfants, et, quand le jeune Tertius voulut faire ses études de médecine, ses tuteurs jugèrent plus simple d’accéder à ses vœux en le mettant en apprentissage chez un médecin de province que de s’y opposer en invoquant la dignité de la famille. C’était un de ces rares jeunes gens qui choisissent de bonne heure une voie définie, convaincus qu’il y a pour eux dans la vie une chose spéciale à faire, parce qu’ils se sentent appelés à la faire et non parce que leurs pères l’ont faite avant eux. Ceux d’entre nous qui ont embrassé une carrière par vocation doivent se souvenir de certain matin ou de certain soir où ils ont grimpé sur un escabeau pour atteindre un livre inconnu, ou sont restés assis, les lèvres entr’ouvertes, à écouter la conversation d’un étranger, ou enfin ont commencé, à défaut de livres, à écouter parler les voix intérieures de leur âme, y trouvant le premier germe appréciable de leur vocation. Quelque chose de semblable était arrivé à Lydgate. Il avait l’esprit prompt ; et souvent, encore tout animé au sortir d’un jeu bruyant, on le voyait se mettre dans un coin et bientôt s’absorber profondément dans le premier livre qui lui tombait sous la main. Tant mieux si c’était Rasselas ou Gulliver ; mais le Dictionnaire de Bailey ou la Bible avec les livres Apocryphes faisaient également son affaire. Il lui fallait absolument quelque chose à lire, quand il n’était pas en train de monter le poney, de courir, de chasser ou d’écouter la conversation des hommes mûrs.
Quand il eut achevé ses classes et ses mathématiques, sans s’y distinguer réellement, on disait de lui qu’avec de la volonté il pourrait arriver à tout, mais il n’avait certainement pas voulu jusque-là. C’était un jeune animal vigoureux, d’une intelligence rapide ; mais nulle étincelle n’avait encore allumé en lui une passion intellectuelle, le savoir lui semblait chose superficielle, facile à acquérir : à en juger par les conversations de ses aînés, il avait déjà plus d’expérience qu’il n’en faudrait pour la conduite de sa vie. Mais, au temps de ses vacances, il entra un jour de pluie dans la petite bibliothèque paternelle, à la recherche d’un livre nouveau ; il avisa enfin une rangée de volumes couverts de poussière, à dos de papier gris et à étiquettes sombres : les volumes d’une vieille encyclopédie auxquels il n’avait jamais touché. Ils se trouvaient sur le rayon le plus élevé et Lydgate était monté sur une chaise pour les atteindre. Mais, ayant ouvert le premier volume, il resta à lire ainsi tout debout dans cette position incommode. Il était tombé sur une page portant le titre d’Anatomie, et le premier passage qui attira ses yeux traitait des valvules du cœur. Lydgate n’était très familier avec aucune sorte de valvules, mais il savait que les valvæ désignaient des portes à battants, et de cette réflexion jaillit une lumière soudaine, qui éveilla en lui la première notion d’un mécanisme artistement combiné, placé au milieu de la charpente humaine. Tout ce qu’il en savait, c’est que sa cervelle était renfermée dans de petits sacs à l’endroit des tempes, et il n’avait pas plus l’idée de la circulation du sang que de la façon dont la papier pouvait remplacer l’or dans la circulation. Mais l’heure de la vocation était arrivée. Avant d’être descendu de sa chaise, un nouveau monde s’était révélé à lui par le pressentiment de travaux et de progrès successifs, remplissant les vastes espaces qu’avait jusque-là dérobés à sa vue une sorte d’ignorant pédantisme qu’il prenait pour la science. À partir de ce moment, Lydgate sentit germer en lui une passion intellectuelle.
Nous n’avons pas de scrupule à raconter et à raconter toujours comment un homme peut devenir amoureux d’une femme, parvenir à l’épouser ou se voir fatalement séparé d’elle à jamais. Est-ce un excès de poésie ou un excès de sottise qui veut que nous ne nous lassions pas de décrire ce que le roi Jacques appelait le « charme souverain » et la beauté de la femme, que nous ne soyons jamais fatigués d’entendre résonner les cordes grêles du vieux troubadour, et que nous nous intéressions comparativement fort peu à cet autre genre de beauté et de « charme souverain » dont le tissu est fait du travail de la pensée et du patient sacrifice de tous nos mesquins désirs ? Dans l’histoire de cette passion-là, le dénouement varie aussi : quelquefois c’est un glorieux mariage, d’autres fois une complète déception et une rupture finale. Et il n’est pas rare non plus que cette catastrophe se rattache à l’autre passion, à celle que chantent les troubadours. Dans la foule des hommes d’âge mûr qui, au cours de la vie quotidienne, remplissent leur vocation à peu près comme ils font le nœud de leur cravate, il n’en manque pas dont la jeunesse avait rêvé de plus nobles efforts, et, qui sait, de changer le monde peut-être. L’histoire de ce rêve et de la manière dont le plus souvent il arrive à prendre corps, cette histoire est bien rarement menée à terme ; à peine même si elle existe jamais clairement dans l’esprit de ces hommes ! Peut-être leur ardeur pour un travail généreux et désintéressé, s’est-elle peu à peu, imperceptiblement, refroidie, comme l’ardeur de toutes les autres passions de jeunesse, jusqu’au jour où la première nature revient, comme un fantôme, visiter son ancienne demeure et jeter sur tout ce qui l’a meublée depuis, comme une lueur spectrale. Il n’y a rien dans le monde de plus subtil que l’histoire de ce changement graduel dans le cœur des hommes. Il s’est, au commencement, insinué en eux à leur insu : c’est vous et moi, avec tant d’autres, qui avons peut-être infecté de notre souffle leurs aspirations de jeunesse, par l’expression de nos sentiments faux ou la sottise de nos axiomes ; ou peut-être encore ce seront les vibrations du regard d’une femme qui auront fait le changement.
Читать дальше