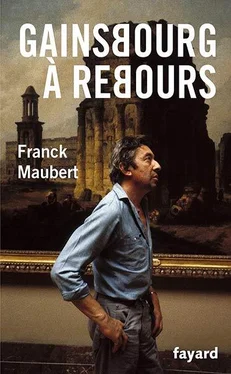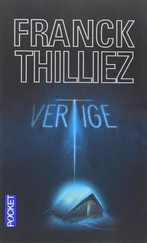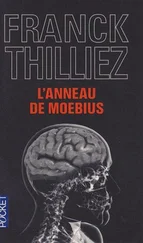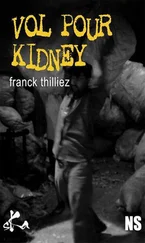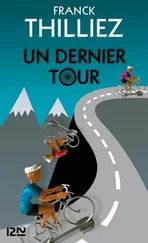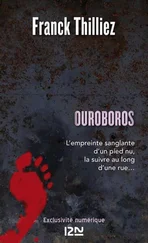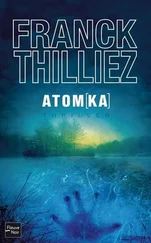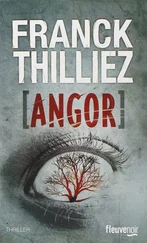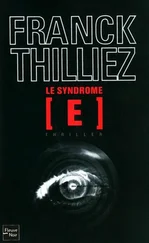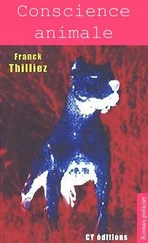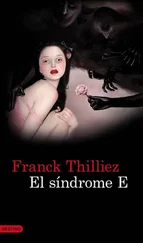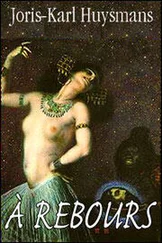Mai explose. Grimblat attend juin pour lancer son Slogan . Début de tournage tendu entre les deux acteurs. Jane pleure dans sa loge, trouve son partenaire exécrable, égoïste et épouvantable avec elle sur le plateau. Le metteur en scène craint que cette tension ne pèse sur son film. Il les invite à dîner chez Maxim’s afin de dédramatiser. Sciemment ou pas, il « oublie » de s’y rendre. Le face-à-face se transforme en un jeu de séduction. Elle comprend que derrière les agressions de Serge se dissimule un grand timide, un romantique et un hypersensible. Lui aussi tombe sous le charme de la ravissante fille en minijupe… L’idylle se poursuit à Venise, comme il se doit, mais toujours pour le tournage du film.
Entre-temps, Jacques Deray la choisit pour le deuxième rôle féminin de La Piscine , aux côtés de deux grands séducteurs du cinéma français, Alain Delon et Maurice Ronet… et de Romy Schneider. Gainsbourg, jaloux de Delon, rivalise dans la démesure et dans l’humour. Il loue une immense Cadillac, où s’entasse la nouvelle famille. Jane est avec sa petite Kate âgée d’un an, nurse, landau ficelé sur le toit… Serge se moque de lui-même : « Ma limousine ressemble à une caravane arabe. » Derrière le masque du cynisme, Jane découvre l’humour et l’entrain de Serge, ciment de leur relation. Avec lui rien ne paraît sérieux. La vie semble facile comme des après-midi d’adolescents faits d’insouciance. « Il était plus âgé que moi et me faisait sentir si jeune ; il m’a redonné une nouvelle vie, une nouvelle enfance », dit-elle.
Cette enfance semée d’éclats de rire et partagée avec Kate, puis avec Charlotte (née en 1971), fait dire à Serge qu’il a trois filles. Gainsbourg, doué dans le rôle de Pygmalion, modèle Jane, qui se prête au jeu avec plaisir. Avec elle, il a trouvé la petite fille — un peu plus âgée que prévu — qu’il cherchait pour la transformer en un personnage provocant. Minirobe transparente, panier en osier, attitude décadente, déclarations sulfureuses sur le mode érotique soft , le couple qui écume les boîtes de nuit jusqu’au matin blême fait fureur. Désormais, le grand public a adopté Jane l’Anglaise et son accent savamment entretenu. Serge s’est chargé des présentations :
Signalement
Yeux bleus
Cheveux châtains
Jane B.
Anglaise
De sexe féminin
Âge : entre vingt et vingt et un…
Il fait directement allusion à Dolorès Haze, la Lolita de Nabokov dont il prenait plaisir à citer des extraits par cœur à ses visiteurs. Quant à la musique de cette chanson, il s’inspire sans vergogne d’un prélude de Chopin… Et signe paroles et musique : Gainsbourg. Là aussi réside un certain génie. Du post-modernisme en quelque sorte. Ce sera la face B d’un 45-tours vendu, depuis sa création, à près de 8 millions d’exemplaires. Le titre de la face A est Je t’aime… moi non plus . La lucidité gainsbourienne y éclate : « L’amour physique est sans issue. » Malgré certaines critiques (« bluette lascive en soupirs majeurs écrite pour Brigitte Bardot, mais récupérée avec une exquise ingénuité érotique par Birkin… »), le duo s’arrache et devient un succès mondial enregistré en une dizaine de langues. L’ère Gainsbourg-Birkin est lancée. G. le Maudit sort de la marginalité. Enfin !
Fort de sa fortune, il s’offre un joyau, une des perles rares de toute sa carrière. Le diamant se nomme Histoire de Melody Nelson . C’est un hommage à Jane et à Nabokov. Le lancement paraît assuré. Un de ces coups de pub dont Gainsbourg a le secret. Des affichettes noires recouvrent les sens interdits des rues de Paris. Elles disent : « Melody Nelson, qu’est-ce que c’est ? De la pub, toujours de la pub. Pour qui ? Une rouquine de quatorze ans, une petite fille pubère, née dans les brouillards de Londres, sortie vivante de l’imagination de Serge Gainsbourg. Qui emprunte sur la pochette le visage, le corps un peu nu de Jane Birkin, sa femme… »
Voilà, tout est dit. C’est le premier « concept-album » français. Une histoire, une seule, presque un conte fantastique, un souffle à la Heredia. Quant à la musique, sans concession sinon une valse et une ballade « pour aider à la programmation musicale », elle est arrangée et dirigée par l’excellent Jean-Claude Vannier… sans qui l’album ne serait pas ce qu’il est. Melody Nelson , si somptueux et original soit-il, est un échec commercial : seulement 22 000 exemplaires vendus. Mais, aux yeux des experts, Gainsbourg le créateur a regagné ses galons. Aujourd’hui encore Melody demeure l’album culte, référence absolue de plusieurs générations de pop-singers .
Deux ans après, en 1973, Jane chante Di-doo-dah , et c’est un tube. Elle y déclare : « J’ai je n’sais quoi d’un garçon manqué… » Avant de creuser ce filon au cinéma, Serge lui signe un autre succès, Ex-fan des Sixties , où elle exerce son timbre acidulé en égrenant les destins brisés de l’histoire du rock’n’roll.
Elle grandit une nouvelle fois grâce à son Pygmalion. Le terrain de cette métamorphose est le tournage du film Je t’aime… moi non plus (1975), premier film underground français, premier (et meilleur) long métrage de Gainsbourg, porté sur les fonts baptismaux du septième art par François Truffaut en personne, inspiré de l’avant-garde new-yorkaise (Warhol et Morrissey). C’est l’amour impossible et la passion d’un jeune homosexuel pour une fille, serveuse dans un snack-bar perdu au milieu de nulle part. Ainsi naît le « concept » de l’être androgyne incarné par Johnny-Jane. Silhouette et allure sublimées jusqu’à aujourd’hui, notamment à travers la panoplie jean-tee-shirt-baskets, plus que jamais de mise. Le film provoque, la critique fait grise mine et le public boude. Je t’aime… moi non plus entre dans la légende, Les Cahiers du cinéma et les cinémathèques s’en emparent.
Serge rêve de refaire le coup de Je t’aime… moi non plus , la chanson, en inventant une nouvelle danse érotique. Ce sera La Décadanse : le couple danse enlacé, la fille tournant le dos à son partenaire. Il s’agit d’un slow lancinant sur un mode quasi liturgique. Si une fille accepte cette « décadanse », vous pouvez penser qu’elle est déjà dans votre lit. C’est, en tout cas, ce que je croyais à l’époque, mais ça ne marchait pas forcément… C’est aussi un fiasco pour Serge. Le public et la critique y voient un coup de mauvais goût. Raté.
Au fil des douze années de bonheur familial passées rue de Verneuil, Serge a composé et écrit le répertoire de Jane, notamment Baby Alone in Babylone , une merveille qui compte onze titres, dont des petits chefs-d’œuvre : Les Dessous chics et Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve , titre emprunté à Francis Picabia.
Au terme de ces douze années, c’est Jane qui se sauve, emportant avec elle enfants, larmes et bagages et abandonnant son Pygmalion, lasse de la tournée des grands ducs et des cuites de celui qui se proclame désormais Gainsbarre. La chambre aux poupées, son refuge lors des coups de gueule, lui semble trop étroite. Après son départ, il conserve la pièce en l’état, la fait visiter, des trémolos dans la voix, et c’est lui qui vient désormais y noyer son chagrin. Il m’a avoué que, certaines nuits, il se projetait Slogan sur le plafond de la chambre. La nostalgie, camarade… En 1987, il lui offre Lost Song :
De nos amours éperdues
Notre émotion s’est perdue.
Читать дальше