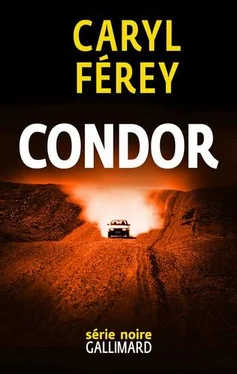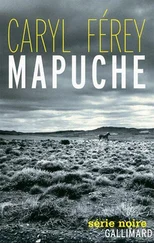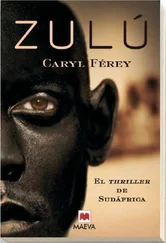L’association autochtone n’avait aucune personnalité juridique ni aucun rapport concerté avec l’administration qui la chapeautait : elle se contentait surtout de faire entrer les cotisations et d’organiser les « prises d’eau ». Interrogée sur le sujet, Eugenia expliqua la situation, critique. Les communautés paysannes se regroupaient dans des ayllos , oasis d’altitude où s’écoulait l’eau des Andes, mais la pénurie avait créé des quotas. En l’absence de régulateurs et de surveillance — les ingénieurs et les technocrates qui édictaient les lois vivaient loin d’ici —, certains chefs de village s’octroyaient des débits d’eau supérieurs aux règles établies, vendaient leurs terres ou leurs vieilles mines à des sociétés privées qui, elles-mêmes voraces en eau, asséchaient les terres des petits exploitants locaux.
— Les nappes phréatiques ont été tellement pompées qu’il n’y a pas eu de fleurs ce printemps dans le désert, déclara l’Atacamène.
Gabriela soupira, les problèmes autochtones étaient les mêmes partout.
— Salar SA fait partie de ces sociétés privées ? demanda Esteban.
L’employée acquiesça.
— Je pourrais jeter un œil aux documents dont vous disposez ?
— C’est que… je ne suis que la secrétaire du bureau, dit-elle. Il faudrait demander l’autorisation à mon chef.
— C’est l’affaire de quelques minutes.
— Peut-être, mais…
— Je ne travaille pas pour les sociétés privées, précisa l’avocat, je défends au contraire des petits paysans qu’on essaie de spolier.
Eugenia croisa le sourire amical de la jeune Mapuche. Après tout… Les roulettes de sa chaise étaient voilées mais l’ordinateur en état de marche ; la secrétaire consulta sa machine sans un mot, tira plusieurs feuillets de l’imprimante qu’elle tendit à l’avocat de Santiago. D’après le document, des parcelles de trois à dix hectares avaient été vendues récemment à Salar SA, les premières quatre mois plus tôt, la dernière la veille : nom du vendeur, un certain Juan Pedro Alvillar… La signature de Schober figurait sur les actes de vente, comme gérant de la société acquéreuse.
— M. Schober est venu hier signer ces papiers, ici même ?
— Oui… Les gens d’ici aiment savoir à qui ils ont affaire, répondit-elle. On fait plus confiance à une poignée de main qu’à un fondé de pouvoir.
— Hum… Vous savez si Schober est toujours en ville ?
— Sans doute, fit Eugenia. Mon patron est parti à Calama pour une histoire de papiers manquants.
— Quels papiers ?
— M. Schober doit acheter les terres d’un de nos administrés…
— Quand ?
La secrétaire du bureau indigène pianota sur son clavier d’ordinateur.
— Aujourd’hui, normalement, dit-elle en prenant l’écran plat à témoin. Enfin, dès que les papiers seront arrivés de Calama…
Esteban bascula par-dessus le comptoir pour visualiser l’écran informatique : une parcelle de douze hectares achetée par Salar SA dans la zone du salar de Tara. Nom du vendeur : Elizardo Muñez. Il croisa le regard irisé de Stefano : Schober aurait besoin de la signature du dénommé Muñez pour officialiser la vente.
Esteban déplia la carte de la région sur le comptoir.
— Vous pouvez localiser les terres acquises par la société de Schober ?
Eugenia dessina bientôt des cercles rouges sur la carte. Les parcelles en question se situaient dans les hauts plateaux, autour du salar de Tara, bijou minéral dont les terres étaient inconcessibles… Pourquoi Schober avait-il acheté les terres qui ceinturaient le site protégé ?
— Il y a des mines ou des gisements là-haut ?
— Pas à ma connaissance, répondit la secrétaire.
— Vous connaissez M. Muñez ?
— C’est un mineur à la retraite qui ne descend plus de sa montagne, expliqua Eugenia. Il n’y a plus grand monde là-haut…
— Pourquoi, le manque d’eau ?
— Non… Au contraire, il y a une nappe phréatique sous ses terres, une des rares qu’on trouve si haut… Non, ajouta l’Atacamène, le problème de Muñez, ce serait plutôt l’alcool. L’alcool et tous les produits chimiques qui lui ont déglingué la santé…
* * *
Une route goudronnée grimpait vers les hauts plateaux de l’Atacama, succession de collines d’herbes rases et touffues dont les couleurs douces tempéraient mal leur nervosité. D’après les indications d’Eugenia, Elizardo Muñez habitait un hameau au bout d’une piste, quelque part en bordure du salar … Gabriela conduisait la Mercedes, un œil sur Esteban qui somnolait à l’arrière, shooté par les antalgiques. Il ne s’était pas plaint une seule fois depuis leur départ de Lota. Ses doigts fracturés devaient pourtant lui faire mal, songeait-elle en surveillant le rétroviseur central… Stefano se tenait à ses côtés, l’esprit vagabondant par la vitre de la voiture. Il pensait toujours à Manuela, à ce qu’ils avaient vécu l’autre nuit dans la villa. Il avait d’abord été dur avec elle, lui reprochant des faits survenus à une époque où tout était différent. Qu’elle ait aimé sincèrement ou non l’officier de la DINA n’y changeait rien. En se mettant au vert sans prévenir Schober de leur traque, c’est lui aujourd’hui qu’elle trahissait. Payait-elle ses dettes envers son passé ou sauvait-elle sa peau, encore une fois ? Une pensée l’effleura, absurde : et si elle le faisait pour lui ?
Les montagnes crevaient les cieux quand ils quittèrent la portion d’asphalte. Un chemin caillouteux filait entre les gigantesques créations minérales. Ils croisèrent un troupeau d’alpagas en plein vent qui s’enfuirent à leur passage, traversèrent des vallons lumineux aux lacs endormis, dévalèrent des collines abruptes où gisaient des carcasses rouillées de camions, des bouts de pneus, de plastique… des détritus laissés par les humains. La Mercedes gravit quelques pitons, navigua entre les sculptures de roche qui jaillissaient de terre, beautés brutes esseulées au milieu du désert. La route grimpait encore. Eux mâchaient des feuilles de coca, silencieux devant le spectacle nu de la nature. L’horizon soudain s’élargit, vert et bleu à perte de vue. Ils ne croisèrent plus que de rares fermes, petits points perdus dans les herbes, des arbustes jaunes fouettés par le vent et des aigles souverains.
Quatre mille huit cents mètres d’altitude : l’air était si pur qu’il semblait redessiner les contours.
— On ne devrait plus être très loin, dit Stefano, penché sur la carte.
Les volcans surveillaient le vide, titans anthracite au calme apparent — l’un d’eux était toujours en activité. Gabriela ralentit bientôt, puis roula au pas sans cesser de scruter l’immensité vierge.
— Qu’est-ce qui se passe ? fit Stefano.
Ils étaient au milieu d’une ligne droite, pour ainsi dire seuls au monde.
— Là-bas, fit l’Indienne en désignant la plaine, il y a quelque chose…
Trois petits plots, alignés comme des soldats de plomb… Muñez habitait à quelques centaines de mètres, le hameau qu’on apercevait sur les contreforts du volcan.
— Allons jeter un œil, dit Esteban à l’arrière.
La Mercedes garée sur le bas-côté, ils foulèrent la steppe en direction des monticules. Dévalant les sommets des Andes, un vent glacé les cueillit à mi-chemin. Gabriela colla son sac à main sur sa poitrine pour se protéger du froid, Esteban marchait devant, les pans de sa veste malmenés par les bourrasques, Stefano fermait la marche. Ils arrivèrent gelés. Les trois monticules aperçus de loin étaient en fait des cylindres de canalisation fixés dans un socle de béton : trois puits, ou sondes de prospection d’eau souterraine, qui n’étaient pas l’œuvre d’un fermier.
Читать дальше