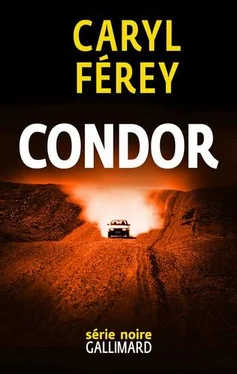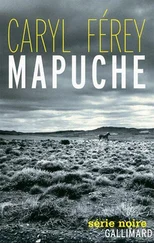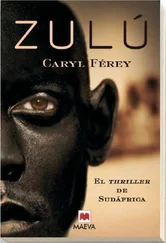Difficile à imaginer après les vingt-quatre heures qu’ils venaient de passer… On nettoyait les pavés des halles désertées à grande eau sous les regards chapardeurs des chiens errants. Esteban finit son déjeuner avant d’appeler le capitaine Popper depuis son nouveau portable. Après une brève attente au standard, le chef des carabiniers prit la communication.
— Vous me pompez l’air, Roz-Tagle, commença-t-il, de sale humeur. J’ai des affaires par-dessus la tête et pas le temps d’écouter vos doléances.
— Vous avez interrogé la bande d’El Chuque ?
— La sienne et deux ou trois autres, répondit Popper. Sauf qu’aucun de ceux à qui on a secoué les puces ne sait qui a pu refourguer de la cocaïne aux jeunes du quartier. J’ai douze hommes sous mes ordres, pas une armée de rats pour faire les poubelles.
— Il vous a dit quoi, El Chuque, que sa cocaïne poussait dans les choux ?
— Il ne m’a rien dit du tout pour la bonne raison qu’il s’est fait la malle. Grâce à qui, d’après vous ?
— Comment ça, disparu ?
— Il a dû se mettre au vert après que vous l’avez alpagué. El Chuque savait que mes hommes viendraient l’interroger, alors il s’est envolé… Écoutez, se radoucit le policier, vous n’aiderez pas les parents des victimes en nous mettant des bâtons dans les roues. Nous sommes tous dans le même bateau, qu’ils le croient ou non.
Une Péruvienne en blouse de plastique passait le jet sur le sol grumeleux du marché couvert.
— Il n’empêche qu’El Chuque se promène avec de la dynamite dans les poches. Dès lors, deux hypothèses : ou il refourgue sciemment une drogue pure au risque de tuer certains de ses clients, ou il n’est pas au courant. Je pencherais plutôt pour cette dernière.
Il y eut un blanc au téléphone.
— Comment ça, pure ?
— Vous avez fait analyser la cocaïne d’El Chuque, non ?
— Vous voulez dire que vous avez analysé la drogue dans mon dos ?
— J’ai eu raison, non ?
— Cette affaire regarde la police ! gronda Popper.
— J’essaie de faire mon métier, capitaine, lequel consiste à défendre les parents des victimes.
— Vous comptez vous porter partie civile ?
— Oui.
— Ça ne servira à rien, Roz-Tagle.
— Prouvez-moi le contraire. Cette coke a semé la mort et peut en provoquer d’autres si on ne fait rien.
Popper prit un ton compréhensif.
— Écoutez… J’ai hérité d’un des quartiers les plus difficiles de la capitale : mon rôle se limite à ce qu’il n’empire pas pendant que d’autres font leurs affaires. Ce n’est pas moi qui fais les lois mais je m’y plie par devoir, que ça me plaise ou non. Je ne tiens pas à ce qu’une histoire de trafic dégénère en révolte : La Victoria souffre déjà suffisamment comme ça. Mes hommes ont interrogé les dealers du quartier, leurs copains et les épaves qui jonchent les rues, sans résultat : personne ne sait d’où sort cette cocaïne, comment El Chuque a pu se fournir, ni où il s’est mis au vert… Je sais que la police n’a pas bonne presse à La Victoria, concéda-t-il, mais dites à vos clients que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nos indics sont sur le coup, les sursitaires qu’on fait chanter, ceux en probation… Laissez la police faire son travail, Roz-Tagle, c’est tout ce qu’on vous demande.
Un silence ponctua le monologue du chef des carabiniers.
Esteban aspira le fond de pisco sour : la mousse en suspension était presque verte.
La rétrospective Kubrick se concluait ce soir-là par Eyes Wide Shut , dernier, testamentaire et selon Stefano l’un des meilleurs films du réalisateur américain, mais aujourd’hui le projectionniste du Ciné Brazil n’avait pas la tête à ce qu’il faisait.
L’enterrement d’Enrique aurait lieu le surlendemain au cimetière de La Victoria, avec ses copains d’école, rameutés par Patricio pour rendre un dernier hommage à leur camarade. Une saine initiative qui ne consolerait personne. La télé communautaire n’émettait plus depuis le dimanche, Cristián n’avait pas parlé de la rouvrir un jour et la police semblait incapable d’enrayer le fléau… Cocaïne ? C’est ce que pensait l’avocat, mais Stefano n’avait pas eu de nouvelles depuis que lui et Gabriela s’étaient rendus chez le flic des narcotiques.
C’était la première fois que l’étudiante découchait depuis sa rupture avec Camila, avant l’été. Il était deux heures de l’après-midi et Stefano commençait à se tracasser : où s’était-elle fourrée ? Le transfert était ridicule, quarante ans séparaient les deux femmes, mais avec sa ferveur et son franc-parler, Gabriela lui rappelait parfois tant Manuela qu’il ne savait plus quoi penser. Vivait-il à ce point dans le passé ? Était-ce ça, la vieillesse ? Ressasser les mêmes histoires, comme si le compteur un jour s’était bloqué — en l’occurrence le 11 septembre 1973 ?
Stefano n’avait pas cherché à bâtir de famille en France, comme beaucoup d’exilés chiliens. Il avait appris le métier de projectionniste, à ravaler ses illusions. Il avait cru à un monde plus généreux : aujourd’hui, l’idée même de partage semblait obsolète. Les gens ne connaissaient plus le nom des arbres, des fleurs ou des écrivains, mais pouvaient citer des centaines de marques de vêtements, de sportifs, de sodas… L’être ou l’avoir, un vieux débat qu’il n’en finissait plus de perdre.
Son père déjà comptait parmi les deux mille cinq cents réfugiés du Winnipeg , le bateau que Pablo Neruda, alors consul en France, avait affrété pour sauver les derniers lambeaux de la République espagnole. Né onze ans plus tard à Santiago, Stefano avait hérité une haine particulière pour les fascistes d’Europe ou d’ailleurs : le radicalisme du MIR avait fait l’affaire… Stefano avait vingt ans à l’arrivée au pouvoir de l’Unité populaire d’Allende, en 1970. Che Guevara avait été tué dans la jungle bolivienne trois ans plus tôt mais le mythe du foco faisait encore tourner les têtes brûlées comme lui. Spécialisés dans les braquages de banques qualifiés alors d’« expropriations », Stefano et ses camarades du MIR comptaient allumer des foyers d’insurrection à travers le Chili pour renverser le capitalisme et l’impérialisme yankee, mais en prenant le pouvoir par les urnes, Allende avait créé une situation inédite pour tout marxiste de l’époque : installer le socialisme en utilisant les seules ressources de la légalité bourgeoise.
Galvanisé malgré l’embargo, le peuple s’était rangé derrière le président élu, mais pour Stefano et ses camarades gauchistes, Allende était un tiède qui, un jour ou l’autre, se ferait destituer par ceux dont il respectait si bien la légalité. Nationalisations, suffrage universel, retraite pour tous, bourses étudiantes, distribution de vivres pour les plus pauvres : Allende n’allant selon eux pas assez loin dans ses réformes, le MIR avait créé une scission pour défier ces socialistes qui refusaient d’armer le peuple… tout en assurant la sécurité du président.
Miguel Enríquez, le secrétaire général du MIR, avait dépêché ses meilleurs cadres pour former le GAP, le « Groupe des amis personnels du président », chargé de sa protection. Stefano faisait partie de ces hommes d’élite : il savait manier les armes et n’avait pas froid aux yeux. C’est lors d’une de ces missions du GAP qu’il avait rencontré Manuela. Brunette tonique au corps athlétique, Manuela suivait Allende dans ses déplacements et n’avait pas la langue dans sa poche. Ils s’étaient plu tout de suite. Chatte au sourire triangulaire, Manuela pouvait flâner dans un parc si le temps s’y prêtait, moins dans les bras d’un homme : ils s’aimèrent en coup de vent, dès que l’occasion se présentait, juraient de se revoir aussi vite qu’ils se quittaient dans l’excitation d’une situation qu’ils savaient révolutionnaire. Le présent était trop dense pour parler d’avenir qui, il est vrai, n’en finissait plus de s’obscurcir.
Читать дальше