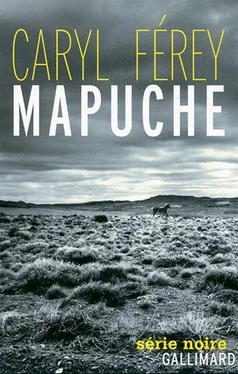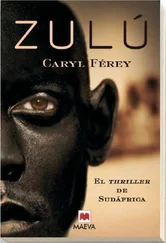Rubén bâtit un premier scénario d’après les éléments dont il disposait. Ossario avait contacté Maria Victoria pour lui montrer la fiche d’internement qui accablait ses parents adoptifs dans le but de la faire témoigner à son « Grand Procès », mais la photographe n’avait pas suivi les instructions du paranoïaque : elle avait retrouvé la trace de la blanchisseuse à qui était échu son frère biologique, une copie du document pour preuve. Miguel absent, sa mère avait gardé la copie en promettant sans doute de la montrer à son fils, de se confesser à lui, seul à seul. Maria avait dû douter de la parole de la vieille folle : poursuivant ses recherches en interrogeant les gens du quartier, on l’avait envoyée sur les docks de La Boca, où le fils travesti de la blanchisseuse tapinait depuis des années. Maria était alors tombée sur Luz/Orlando, et l’avait emmenée ou lui avait donné rendez-vous au club de tango sans savoir que les tueurs la pistaient. On les avait enlevés à leur sortie…
Rubén gambergeait devant les fragments du puzzle reconstitué. Il y avait des trous, des noms, des dates ou des lieux caviardés par le séjour dans l’estomac, mais on y trouvait l’organigramme des militaires impliqués dans l’enlèvement et la séquestration des parents de Maria Victoria. Leur nom était lisible : Samuel et Gabriella Verón. Celui d’Eduardo Campallo aussi figurait sur le document : on lui avait confié les enfants le 21/09/1976… Le détective resta un moment penché sur la lumière du bureau, troublé. Malgré son état, jamais il n’avait vu une fiche d’internement aussi précise : noms, dates, mouvements, tout y était soigneusement consigné. Il lui faudrait des heures pour en faire l’inventaire, répertorier l’identité des coupables et de leurs complices, les comparer à ses fichiers… Non, cette fois-ci, il ne s’en sortirait pas seul. Il lui fallait de l’aide. Carlos, Anita, les Grands-Mères…
De vieux fantômes rôdaient dans l’agence quand il releva la tête. Jana s’était endormie sur le canapé rouge du salon. Elle était là, à deux mètres à peine, shootée par le cachet. La courbe de ses jambes brunes luisait à l’ombre de la lampe Art déco, l’amorce de son visage, ses cheveux répandus sur l’accoudoir… Ses pieds nus glissèrent sans bruit jusqu’au sofa où elle cuvait son malheur. La Mapuche, recroquevillée en chien de fusil, tenait les bras serrés sur sa poitrine, mais son visage endormi était celui d’une enfant. Une boue de larmes perla à ses paupières, remontée de l’inframonde. Rubén s’agenouilla au chevet du petit ange et, du bout des doigts, caressa son front.
Ma douce… ma douce petite sœur…
DEUXIÈME PARTIE
LE CAHIER TRISTE
Franco Diaz eut les larmes aux yeux en voyant les majestueux ombus s’élever dans le ciel argentin — des arbres que la botanique classait parmi les herbes géantes, typiques de la pampa. Le retraité de Colonia ne les avait pas revus depuis combien : quinze ans ?
Fervent catholique, patriote, Franco Diaz était un homme de principes — ne pas regretter, ne pas trahir. Pendant près de trente ans l’armée argentine avait été sa maîtresse exclusive, exigeante, fidèle. Une famille, c’était bon pour les civils. Mais avec l’âge, sa retraite anticipée lui assurant une pension confortable, Franco avait commis l’idée de vieillir avec une femme — une femme douce et soumise, comme sa mère, qui n’aurait qu’à respecter l’ordre des choses pour suffire à son bonheur. Rien de compliqué, croyait-il. Il s’était retiré à Colonia del Sacramento, le port uruguayen qui faisait face à Buenos Aires, espérant trouver chaussure à son pied. Il avait dû déchanter. L’ancienne ville coloniale recevant essentiellement des touristes ou des familles en short et avec appareils numériques, les femmes libres dans ses âges étaient rares ou surveillées, voire athées, si bien que, le temps succédant aux expériences épisodiques ou malheureuses, Franco Diaz avait fini par oublier l’idée de vieillir à deux.
Peut-être aurait-il dû y penser plus tôt. Peut-être aussi avait-il vu trop de choses laides — et les femmes devaient le sentir. Franco n’avait pas de regrets : ce qui avait été fait devait être fait, et puis surtout il avait trouvé dans les fleurs l’altérité qui manquait à sa vie de caserne.
Il pensait au début que la botanique l’aiderait à combattre la solitude, l’oisiveté : mieux qu’un hobby, il avait découvert avec les fleurs un autre temps. Celui de la pousse… Iris sauvages des marécages, glaïeuls rutilants, roses altières ou azalées, les fleurs seraient sa rédemption.
Car Franco Diaz voulait mourir en paix.
Le cancer du foie qui le rongeait se généralisait. Les médecins consultés à Montevideo lui donnaient à peine six mois d’espérance de vie. Personne ne le savait. Pas même ses anciens supérieurs. La maladie évoluait par crises successives, de plus en plus violentes, et rien ne pourrait bientôt plus l’endiguer. Franco était seul avec la Mort, ses métastases et son Secret qui, peut-être mieux que le cancer, le gangrenait.
« Parle, et Dieu t’aidera », lui disait son ami et confesseur de l’époque.
Ses derniers mois de vie s’épuisant, Franco Diaz était devenu mystique. Il L’entendait parfois, à force de prières et d’appels extatiques, quand sa raison flanchait ou quand la douleur de ses entrailles devenait trop intolérable. La Voix alors le conseillait, omnisciente et pourtant si proche, plus réconfortante que les cachets de morphine : c’est Elle qui lui avait donné l’idée de cacher son Secret, de laisser le temps au temps. Il avait planté le ceibo , l’arbre national argentin, comme une stèle, un mausolée. Le monde n’était pas encore prêt : sa génération, d’abord, devait disparaître… Ironie du sort, c’est au moment où Franco Diaz s’apprêtait à tirer sa révérence que son passé le rattrapait.
Tout avait commencé la semaine précédente, quand le retraité avait noté des mouvements inhabituels dans sa rue : une voiture grise et des silhouettes qui rôdaient autour de la maison de son voisin. Un homme était venu lui poser des questions le lendemain, un grand costaud au fort accent argentin qui prétendait être un ami d’Ossario de passage dans la région. Ce dernier n’avait pas ouvert ses volets depuis trois jours et sa voiture n’était pas là : tout laissait croire qu’il était parti. Le grand type se voulait aimable, mais Franco avait deviné qu’il mentait. Ossario ne recevait jamais d’amis, et sa maison semblait bel et bien sous surveillance. L’agent d’assurances débarqué de Buenos Aires lui aussi mentait sur son identité. Pourquoi en voulaient-ils tous à Ossario ? Franco Diaz avait senti le danger. Quelque chose avait filtré, forcément, quelque chose qui le concernait. Chantage, extorsion d’argent, mise aux enchères de « révélations », l’ancien paparazzi était capable de tout : il avait pu mener une enquête, apprendre par un traître ou un repenti qui il était. Rompu aux interrogatoires, Diaz savait que les hommes venus lui rendre visite étaient des professionnels, flics ou barbouzes appartenant à une quelconque officine. Si les hommes qui rôdaient autour de sa maison étaient envoyés par les siens, ils le lui auraient dit … Le retour impromptu d’Ossario et l’attaque de la maison avaient tout précipité.
Contrairement à ces anciens militaires débusqués qui vendaient leur maison de Floride for a quick sale , Diaz avait fui en abandonnant tout derrière lui : ses biens, sa posada au bord du río , les plantes précieuses qu’il avait mis tant d’années à élever et qui faneraient sans lui, dans son jardin secret. Il avait passé la frontière le soir même à bord de l’Audi et dormi en Argentine, son pays bien-aimé, dans un petit hôtel où il avait rempli le registre sous un faux nom. Il roulait maintenant le long d’une route ombragée, l’esprit taraudé, en fuite. « Parle, et Dieu t’aidera », lui répétait son confident. Oui, mais parler à qui ? Camps, Viola, Galtieri, Bignone, la plupart des généraux impliqués dans le Processus étaient morts. Qui d’autre savait ? Qui avait trahi ? Dans ce jeu de dupes, à qui faire confiance ?
Читать дальше