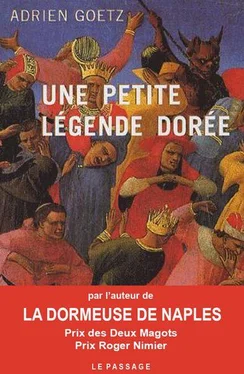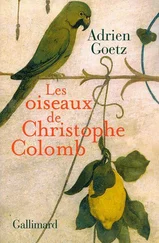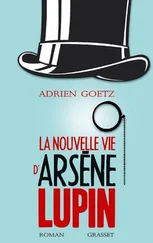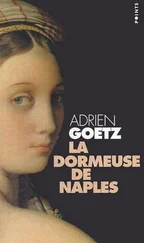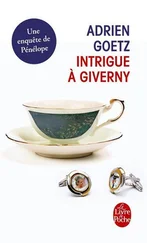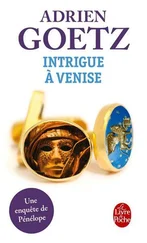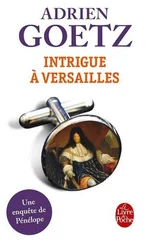Jan d’abord s’était défié de Carlo. C’était naturel. Européen, Jan ne voyait aucun Européen. Mais son amitié avec le groupe des cavaliers lui fit vite oublier ce que Carlo pouvait savoir de lui. L’équipe de polo les avait soudés. Carlo lui cacha d’instinct qu’il avait même été présenté, quand il avait douze ou treize ans, à son grand-père. Enfant, il en avait vu défiler quelques-unes, à la maison, de ces altesses et de ces vedettes en tout genre. Ses parents, ceux qui l’avaient adopté — Carlo disait « mes seconds parents » — recevaient à longueur d’année. Sa seconde mère allait épouser un triste traducteur trilingue et son second père refaire sa vie avec un chanteur rock à la veille de leur mort, ensemble, dans cet accident de voiture. Décidément.
Carlo chassa ce souvenir, d’autres venaient. Jan était allé chercher un de ses petits cahiers bleus pour le lui offrir. Carlo devait l’avoir encore dans les tas de papiers de l’appartement de Washington. Il avait écrit sur la couverture, en majuscules ornées entourées de guirlandes comme sur un orgue de barbarie : « Résumé de quelques lois qui gouvernent la vie humaine et font la civilisation. »
Il expliquait avec fatuité, sur le ton d’un petit-maître d’Oxford d’il y a un siècle :
« Je compte sur ton émotion, j’ai fait cela dans le style d’un étudiant désœuvré qui écrit ses mémoires histoire de se désennuyer. »
Carlo, après sa lecture, expliqua que c’était, selon lui, plus l’œuvre d’un prisonnier politique au fond d’une geôle, privé de livres et qui se serait fabriqué un compendium de bric et de broc. Cela ne vexa pas l’auteur ; ils étaient allés tous deux vider des pichets de bière chez « Naples Pizza » et déclamer quelques passages de ce carnet.
En secret, Carlo comparait le petit-fils à l’aïeul. Deux discrètes détresses. Le grand-père de Jan, le prince Paul, aussi usé que s’il venait de régner cinquante ans. L’air d’être au bout d’une course qu’il avait fait semblant de disputer, ce vieil homme s’était obligé à rester, sa vie durant, impeccable dans sa position d’athlète sur la ligne de départ. Mais que faire d’autre ? Une vie passée à se préparer à vivre.
Carlo, en pensée, cessait de se prendre pour Jan, devenait Paul ; la vie des autres était la sienne, comme la musique de ses disques. Les rues de Yale. Sa jeunesse. Il rejouait tous les rôles. Lui, n’était personne.
Paul devait se reprocher d’avoir toujours su qu’il ne vivrait jamais cette existence de souverain. Avec tous ses actes faits pour signifier qu’il s’y était tenu prêt. Il avait de la grandeur. Mais aussi sans doute beaucoup de lassitude, de tristesse. Il ne pouvait en vouloir à personne. Ni s’en prendre à lui-même. Ni à ses parents, qui eux non plus n’avaient rien eu à choisir. C’était ainsi. Il pouvait à la rigueur s’en prendre à sa femme, dire que c’était par une vanité de petite couturière qu’elle avait voulu l’épouser, comme si elle avait cru un instant qu’elle allait pouvoir être reine. Mais s’il déversait ses aigreurs de vieillard sur la malheureuse princesse, c’était faute d’autres victimes. À la vérité, c’était surtout lui qui avait voulu l’épouser. Paul se souvenait encore de son sourire si beau, au retour de cette partie de chasse quand il avait demandé sa main dans la montagne, aux environs de Cetinje. Elle n’y était pour rien. À quoi servait même de se retourner contre les enfants. Bêtes, prétentieux, serviles, innocents, qu’y pouvait-on ? Il fallait bien que les conséquences de tous les mariages consanguins se fassent un peu sentir. Lui, s’il passait pour intelligent dans sa jeunesse, c’était peut-être grâce au sang neuf qui, au dire des mauvaises langues, lui coulait dans les veines. Il avait regardé maintes fois, scrutant la ressemblance, la photographie de ce comte de je-ne-sais-quoi, le grand amour de sa mère. De toute manière, du point de vue dynastique, comme il disait, cela restait sans incidence. Les petits-enfants étaient mieux : Jan, Thomas, Nicolas, Karl, Léopoldine-Jeanne, on pouvait espérer, non qu’ils soient un jour souverains, mais qu’ils arrivent à être heureux. C’était si drôle cette idée du bonheur. Il avait toujours fait comme si cela n’existait pas. Dans son vieil âge, il s’y mettait, avec le cynisme d’un vieillard revenu de tout sans qu’on l’ait laissé aller nulle part.
Il marmonnait la liste des malheurs de sa vie. Mais depuis ses soixante ans, à tout hasard, vaille que vaille, il essayait aussi de composer une liste de bonheurs. Certains n’étaient plus de son âge. Il les avait voulus quand même. Assez tristes échecs, surtout que cela s’était su.
Il sentait bien que tout ce qui, depuis si longtemps, pesait sur ses épaules ne devait pas entraver Jan dans sa marche. Il se disait que le petit enfant aux cheveux blancs se passerait bien de ses autorisations. Il se demandait ce que sa chimère apprivoisée pouvait bien représenter pour ce petit-fils en train de grandir aux Etats-Unis. Parfois il avait envie de lui écrire, ou mieux de téléphoner : il n’en resterait pas de traces. Lui dire de tout abandonner, s’il voulait. Qu’il pouvait demander la naturalisation sous le nom de M r Smith, et qu’on n’en parlerait plus. Comme la principauté, on n’en parlait plus… La capitale, la cathédrale, le sacre, le serment. De la métaphysique de boy-scout. Mais avait-il le droit de dire cela à Jan ? Mais Jan avait-il besoin qu’il le lui permette ? S’il avait envie de tout abandonner…
Peut-être Jan ne comprenait-il pas encore tout ce que cela représentait, l’ambition sacrifiée, les amours gâchées, la vie sans but, la solitude, les inconvénients du pouvoir, sans le pouvoir, tous les devoirs, aucun des droits qui vont avec. Jan tenait de lui, intelligent, enfin toujours plus que sa pauvre mère, il allait bien se rendre compte. Il allait comprendre de lui-même qu’il n’y avait aucune raison de s’interdire de gagner de l’argent, de séduire les femmes, de s’exposer au grand jour. Ses aïeux d’ailleurs, ceux qui étaient rois, ne s’en étaient pas privés. Bah ! Ce n’était que depuis qu’ils ne régnaient plus qu’il avait fallu s’interdire tout, poser aux modèles, tomber dans la bigoterie, mourir pour de bon à la guerre, donner l’exemple. Jan devait comprendre qu’il avait retrouvé le droit d’être lâche, amoureux, infidèle, assassin, fumeur d’opium, champion cycliste, camelot même s’il voulait, qu’il pouvait écrire son nom sur des façades. Jan régnerait innocemment.
Carlo entrait dans la peau de Jan, puis dans celle du prince son grand-père. Il entendait chanter en lui l’air de Philippe II, seul dans son palais, et le plus beau solo de contrebasse écrit par Verdi. Le vieux Paul n’avait eu aucune chance, enfermé dans un caveau au seuil de la vallée des rois. Il n’avait rien voulu faire pour sortir de cette route si bien tracée où il s’était trouvé engagé en naissant, voie royale qui mène au sépulcre. La crypte des Capucins, Saint-Denis, Westminster, le pourrissoir de l’Escorial, Saint-Louis des Invalides, Saint-George de Windsor, Gorizia, la nouvelle sacristie de San Lorenzo, la chapelle de Dreux, l’abbaye de Hautecombe, les « chapelles imparfaites » du monastère de Batalha qui tendent leurs arcs brisés vers le ciel. Il les avait tous visités. Pour en tirer un gros album de photographies. Ses tombeaux. Carlo aussi avait les siens, dans les cimetières inconnus.
Paul s’était même dit à vingt ans qu’il pourrait s’en sortir sans rien renier — puisque c’était impossible — en allant le plus loin sur cette route, essayer de faire qu’elle mène jusqu’au trône. C’est de cet échec qu’il ne se remettait pas. À quoi bon vivre en représentation si personne ne vous regarde ? Faire attention à ce que chacun de ses actes soit irréprochable, si l’on n’intéresse plus personne ? Il faut des costumes de grand tailleur, des chaussures parfaites, s’agenouiller à la messe, prendre certains airs, ne pas se mêler d’argent. On l’avait cru naïf. Il avait bien vu venir les politiciens véreux qui saluaient en lui leur espoir, les aigrefins qui savaient que la fortune de la famille royale n’avait pas, et de loin, été tout entière aliénée par la dictature, les snobs qui affectaient de rechercher sa compagnie pour le plaisir de sa conversation, les éditeurs qui lui prenaient ses albums de photos, les femmes qui avant son mariage se précipitaient à sa rencontre, toutes celles qui depuis n’avaient pas manqué de lui faire comprendre qu’un seul mot suffirait. Il n’en souffrait pas. Cela avait été ainsi depuis sa majorité. D’abord il en plaisantait, avec des amis de son âge — quand ils avaient vingt ans, à San Remo, avec le duc de Xaintrailles et le conte Ugolini —, puis il les avait pris au sérieux, et il avait cédé tout ce qu’ils voulaient aux escrocs, en se disant qu’ils le mèneraient au pouvoir. Sa désastreuse période politique. Enfin il avait cédé aux intrigantes, sa période de lassitude.
Читать дальше