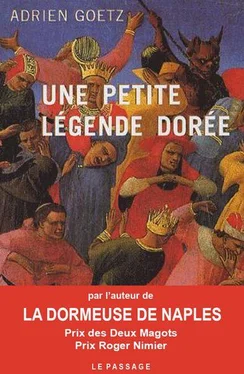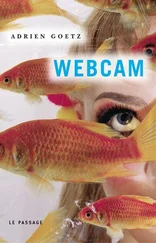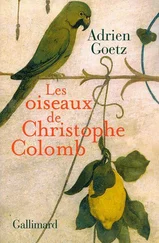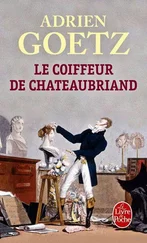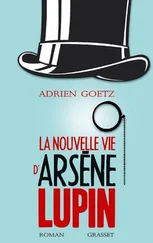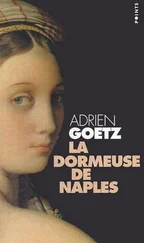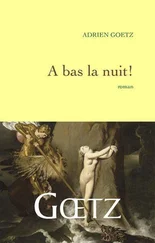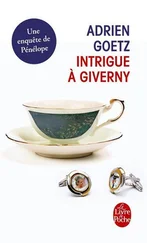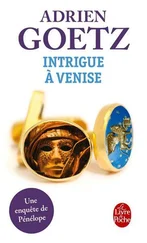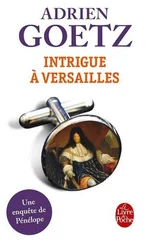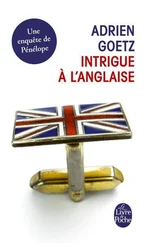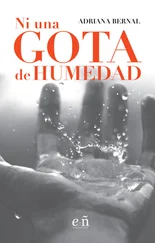— Non, pas le moins du monde. Pourquoi ?
— Vous voyant rester si longtemps devant cette peinture, je vous croyais en oraison.
— Parce que San Biagio guérit les maux de gorge ? »
Carlo prenait pour règle de répondre comme à un vieil ami à toute personne inconnue qui l’abordait. Technique parfois fructueuse dans sa profession. Comme son interlocuteur avait l’air affable et d’en savoir long, il jugea que cela méritait d’engager conversation. Il expliqua qu’il ne toussait pas pour le moment, qu’il saurait, grâce à lui, à quel saint se vouer à l’approche de l’hiver, se risqua à avouer, l’air un peu gêné et à voix basse, ce qu’il faisait ici — ce tour d’Europe impromptu pour voir des peintures, on aurait pu le prendre pour un déséquilibré ou un richissime amateur — et parla du Maître de l’Observance.
Allemand ou Suisse, visage ridé autour des yeux, mèche blanche sur le front avec quelques fils blonds, l’homme habitait Lugano et venait tous les jours à la villa. Il ne se lassait pas de visiter ces salles. Rarement Carlo avait rencontré quelqu’un qui correspondît à ce point au type du vieillard bien mis : costume croisé d’un gris on ne peut plus foncé, chemise bleutée et cravate de grenadine outremer. Rien pourtant du vieux beau, plutôt quelque confrère diplomate retraité plus avancé en âge, auprès de qui Carlo pourrait prendre des leçons, un pur espion à la retraite. L’habitude de monologuer avait formé sa conversation en une manière de dialogue entre le père noble et son ombre. « Me méfier de ne pas finir comme cela », se dit malgré tout Carlo. Assis devant la villa, comme les derniers touristes partaient, on leur servit des rafraîchissements. L’homme affirma :
« Le Maître de l’Observance n’existe pas. »
Un temps d’arrêt, il sembla humer le vent qui couchait les arbres sur les rives. Carlo, interdit, sentait qu’allait venir la suite et se garda de l’interrompre.
« Vous connaissez l’histoire ? Vous êtes allé à Sienne ? On vous le dira là-bas. Il ne porte pas de nom parce qu’il n’existe pas. Vous avez déjà entendu parler de Bernard Berenson ? Américain pourtant, comme vous. Il vivait près de Florence dans une villa suspendue au-dessus de Fiesole, sur les collines. Settignano, la villa I Tatti. C’est maintenant un musée qui appartient à Harvard. Mais vous n’êtes peut-être pas de Harvard ? Yale ? Princeton ? Il y recevait ses amis du monde entier, posant un peu trop, selon moi, au patriarche de l’esthétisme. Berenson a d’abord été un garçon pauvre, à Chicago, je crois, non, Boston. Ses parents avaient émigré d’Europe centrale, son père faisait profession de ferrailleur et chaudronnier. Juifs pieux sans sou ni maille, plutôt indésirables en Lituanie à cette époque. Le mirage de l’Amérique agit. Le jeune Bernard Berenson fit de très brillantes études à Harvard, découvrit l’art. Il s’enthousiasma pour les italiens, Giorgione d’abord, en qui il voyait toute la Renaissance réfléchie en un miroir. Le goût pour les siennois vint ensuite. Ses camarades se cotisèrent et lui offrirent son premier voyage pour venir voir ce qu’il aimait, car on ne trouvait guère de bonne peinture aux Etats-Unis à cette époque. Nul mieux que lui n’a parcouru l’Europe, avec frénésie. Vous y passez quelques jours me dites-vous, et je ne saurais me moquer de votre pèlerinage passionné sur les pas de celui que vous appelez le Maître de l’Observance. Berenson y passa sa vie. À les traquer, les Sassetta, les Botticelli, les Ghirlandaio, Cima da Conegliano ou Vincenzo Catena, qui soit dit en passant est un peu, à mes yeux, un Cima da Conegliano du pauvre. Il en fit pourtant acheter un à madame Gardner, dont il a pour ainsi dire fait la collection. Vous êtes allé au musée Gardner de Boston ? Oh, allez-y, c’est un endroit incroyable. Je m’étais échappé il y a bien des années d’une conférence qui s’était tenue là-bas pour aller le visiter. C’est un capharnaüm, l’antre de l’antiquaire de Balzac n’est rien en comparaison. Imaginez-vous une fausse villa vénitienne, avec des proportions abracadabrantes, de vos briques rouges partout, des moulures, des stucs, des frontons récupérés Dieu sait où, deux palmiers tout étonnés de pousser au milieu de la cour. Madame Gardner y faisait accrocher en désordre les tableaux dont Berenson lui conseillait l’achat. Au centre de la pièce principale, un portrait d’elle. Le tout pris dans une telle gangue de boiseries, de fautes incroyables dans le mobilier, fauteuils à capitons, abat-jour en perles et autres merveilles de cette farine. Tout au contraire d’ici. On sent que cette collection se fait avec rigueur. Vous avez vu cette petite poterie de majolique placée sous un portrait de Memling au revers duquel on voit un vase presque semblable.
— C’est un peu “esthétique”, ça ?
— Au contraire. L’esthétisme aboutit au bric-à-brac, au Fernand Léger accroché au-dessus d’une commode Boulle, mais vous savez cela aussi bien que moi (le visage de Carlo n’exprima rien). Non, tout ce qu’on pourrait reprocher aux agencements imparables du propriétaire de ces lieux, c’est que la majolique véritable rend un peu anecdotique le Memling, on ne peut pas s’empêcher de regarder l’un par rapport à l’autre. C’est diminuer l’œuvre en la mettant sur le même plan qu’une jolie cruche. Enfin, rien de comparable toutefois au Gardner Muséum. Imaginez-vous que j’ai eu besoin de le visiter deux fois. Après un premier parcours des salles, j’avais l’impression de n’avoir rien vu : les capitons, les boiseries faites à la machine, les armures astiquées, les japonaiseries m’avaient caché les Rembrandt. Ce Vermeer si beau qu’on a volé l’année dernière ! Dans un tel encombrement d’objets, les gangsters y voient plus clair que le gardien. Et le Fra Angelico accroché dans l’embrasure d’une fenêtre, il faut se pencher pour le voir, je suis sûr qu’il s’abîme. Quel crève-cœur ! Comment peut-on tolérer cela deux minutes ? Dans son testament, Isabella Stewart Gardner a interdit qu’on déplace une seule œuvre. Ce qui vaut une jolie étiquette sur un tondo de marbre blanc : “Travail italien, début du XX e siècle” ! Quand un conservateur un peu avisé a voulu bouleverser l’ordre de ces choses, devinez qui il a eu contre lui : vos ligues féministes. On osait toucher à cette construction, entièrement voulue par une femme : comme si un musée c’était une œuvre d’art. Bien sûr, on a raconté bien des choses, qu’à la fin de sa vie Berenson avait négocié, dirions-nous, quelques attributions de complaisance. Est-ce si grave ? C’était aussi un marchand de génie. »
Carlo était un peu agacé. On le prenait pour un imbécile, il était sûr que Marge et lui auraient trouvé très beau le musée Gardner. Il se demanda si ce n’était pas ce petit vieillard qui avait volé le Vermeer de Boston dans un souci de salut public et de conservation du patrimoine de l’humanité, comme disaient, à Paris, ses collègues de l’Unesco. Au doigt de son interlocuteur, Carlo remarqua deux alliances, pensa « bigame » avant de se dire « un veuf ». Cela faisait si longtemps qu’il n’avait pas écouté parler un vieillard. Il n’était entouré que de jeunes loups. Le plaisir prenait le pas sur l’impatience. L’émotion amusée d’entendre ce petit homme parler le français en des phrases si longues, décousues, qui se perdaient, qu’il retrouvait comme par inadvertance, et ponctuait de « vous savez », à son adresse, pour lui, Carlo, qui ne savait rien.
« Mais j’en reviens, si vous voulez, à Sassetta et au mystère de l’Observance. Oui, vous vous souvenez, Stefano di Giovanni, “peintre siennois de la légende franciscaine”, c’était au début du XX e siècle, dans les premiers numéros du Burlington Magazine, les temps héroïques de cette grande revue d’art. Berenson, en quelques articles, attribua magistralement un ensemble de peintures qui, selon sa démonstration, revenaient à cet artiste de la deuxième génération de l’école siennoise, un peintre qui jusqu’alors n’était plus qu’un nom dans les textes. Un nom, d’ailleurs, que l’on aurait peine à trouver mentionné avant le XVIII e siècle sous cette forme : Sassetta, “la petite pierre”. On aurait pu aussi bien dire : “le Maître de la Madone des Neiges ”, du nom d’une de ses œuvres, celle que je trouve la plus belle. Des Sassetta, on peut en voir à Sienne, à la Pinacothèque naturellement mais aussi dans la collection Chigi-Saraceni. Il en reste un dans la villa de Berenson, et il y a dans la collection Contini-Bonacossi, à Florence — sur laquelle il y aurait tant à dire, qui vous intéresserait, parce que sans Contini, vous n’auriez pas eu la collection Kress qui fait votre fonds à la National Gallery de Washington — ma Madone des Neiges, où l’on voit un ange faire une boule de neige comme un enfant, c’est à côté du palais Pitti, un bâtiment qu’il faut se faire ouvrir, vous en avez au Louvre, à Munich, à Chantilly dans la collection du duc d’Aumale — une collection qui ressemble au Gardner en ce que l’on ne peut y déplacer aucun cadre. Le duc d’Aumale, le plus jeune fils du roi Louis-Philippe, en avait fait don à l’institut de France au détriment de ses neveux qui n’avaient pas grande lueur intellectuelle. Cas de déshérence culturelle. On croise encore actuellement, paraît-il, dans les salles de Chantilly, les avocats de la famille d’Orléans qui viennent inspecter si l’on n’a touché à rien. Autrement, tout cela leur retournerait, imaginez un peu ce que cela représente aujourd’hui, l’héritage du duc d’Aumale, trois Raphaël parmi les plus beaux, et un Sassetta. Saint François d’Assise dans sa bure face à dame Pauvreté. Cela vaut une fortune. Du moins ainsi les collections du duc d’Aumale ne furent-elles pas dispersées. Lorsque la donation Contini-Bonacossi a été acquise aux Offices, Florence ne trouva rien de mieux que d’en faire vendre une partie. C’est ainsi que le beau plafond de Tiepolo, le Triomphe de la noblesse, est arrivé à Pasadena, en Californie, dans la collection d’un fabriquant de soda. Vous n’avez jamais visité cela ? »
Читать дальше