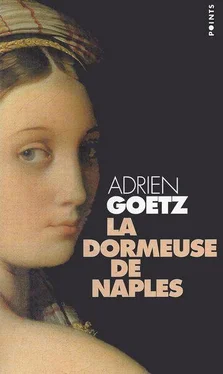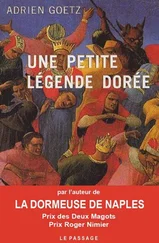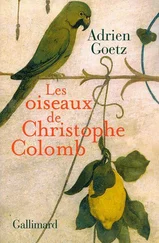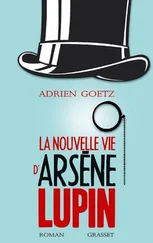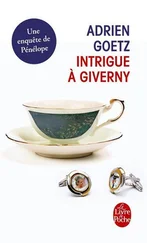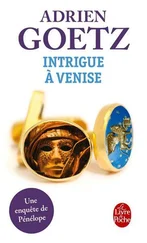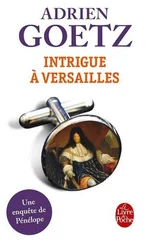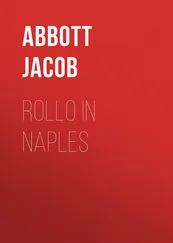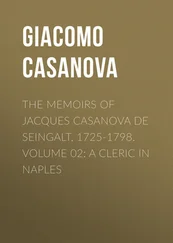ADRIEN GOETZ
La Dormeuse de Naples
I
LA DORMEUSE DE NAPLES
(Naples en 1814)
En octobre 1806, personne ne me connaissait en Italie. J’étais arrivé par Florence, que je désirais voir, et dont je ne savais rien. Je me grisais de l’odeur du foin à chaque halte de la poste. Je descendis, dès que je fus en vue du Dôme, pour arriver à pied, en pèlerin. À Santa-Maria del Carmine, les fresques de la chapelle Brancacci m’ont appris à devenir naïf, ce que mes maîtres, et David le premier, ne m’avaient pas montré. Masaccio y avait inventé la ressemblance, l’ombre portée, l’expression. C’était au XV e siècle. Ensuite, vinrent les perfectionnements, mais tout semblait déjà contenu dans cette petite chapelle. Je revois le cri d’Eve que l’ange chasse du Paradis. L’effroi sacré du Porte-Glaive et la porte qui se referme. La tête blonde de l’apôtre qui regarde prêcher le Christ. J’ai tout cela chez moi, en gravures, dans des albums. Le début de la peinture, le début de ma carrière, de ma vie, l’Italie, le voyage, la façade blanche de l’église. Ces in-folio remplis de gravures, je n’ai plus, depuis longtemps, besoin de les ouvrir. Je caresse du regard le bas de ma bibliothèque, où j’ai classé côte à côte la galerie des Offices, le Musée Pie-Clémentin de Rome, les chambres et les loges de Raphaël, les statues de la villa Albani. Je ferme les yeux devant ces reliures fatiguées, luisantes devant mon feu, sentant bon la cire. Je voyage, silencieux, dans un monde sans bruits, et dont je garde en moi les couleurs, depuis ces jours de ma jeunesse. L’hiver à Paris ne m’est supportable que comme cela. Je ne bouge pas. Je regarde les flammes qui ne sont pas assez hautes. Je devrais tisonner, j’ai froid. Avec le temps, mes adorations sont toujours Raphaël, son siècle, les Anciens, et avant tout les Grecs, mes Grecs divins. En musique, Gluck, Mozart, Haydn. Ma bibliothèque est composée d’une vingtaine de volumes que j’ai depuis toujours, chefs-d’œuvre incomparables, et avec cela, la vie a encore bien des charmes.
Je rajeunissais, déjà, en 1806, en voyant ces prodiges du temps où l’art de peindre était jeune. On m’avait trompé, avec tous ces Romains de convention. Il n’y avait pas un Salon au Louvre sans sa cohorte casquée : Léonidas, Eudamidas, Hamilcar Barca, Mucius Scaevola, Caton d’Utique. Des cuirasses et des jambières en carton bouilli, des aigrettes de théâtre qui ne faisaient plus rêver personne. L’idéal était passé de mode, en même temps que la guillotine et les dernières charrettes de la Terreur. Je décidai de reprendre le chemin des vrais maîtres, de renouer, par-delà David, avec Raphaël, le dieu du dessin et de la forme, et avec Titien, le roi de la lumière. Les grands peintres, comme Raphaël et Michel-Ange, ont insisté sur le trait en finissant leur vie. Ils l’ont redit avec un pinceau fin, ils ont ranimé le contour, ils ont imprimé à leur dessin le nerf et la rage.
Je traversais la Toscane, la naïveté capturée au vol. J’étais un barbare que son butin n’empêchait pas d’avancer à toute allure. J’en gardais des images pâles, des idées sans ombre. Je faisais des dessins sans nombre. Un simple contour, comme une ébauche, à remplir ensuite. J’attendais Rome. Je ne savais pas que j’irais plus au sud. Dans mon esprit, je ne pensais pas dépasser le Vatican, sauf peut-être pour quelques jours à Herculanum afin d’étudier les immortelles antiques. Grâce aux gravures, je connaissais les découvertes faites sous les cendres du Vésuve. J’avais envie d’en déterrer encore.
L’étude ou la contemplation des chefs-d’œuvre de l’art ne doit servir qu’à rendre celle de la nature plus fructueuse et plus facile : elle ne doit pas tendre à la faire rejeter car la nature est ce dont toutes les perfections émanent et tirent leur origine. Quand vous manquez au respect que vous devez à la nature, quand vous osez l’offenser dans votre ouvrage, vous donnez un coup de pied dans le ventre de votre mère.
Mon seul ami était alors François-Marius Granet, que j’avais connu dans l’atelier de David, du temps où nous nous efforcions encore de faire revivre le classicisme, et qui avait travaillé à côté de moi quand je m’étais installé, vaille que vaille, dans l’ancien couvent des Capucines, où peignaient aussi Gros et Girodet. Nous nous soutenions tous, nous inventions des sujets et des postures, posant les uns pour les autres et échangeant nos têtes. J’avais pendant deux heures, maintenu, pour eux trois, le rictus de la terreur. On me paya d’un souper. C’est le seul moment de ma vie où j’ai aimé rire. Il y avait un grand jardin, que personne n’entretenait, qui me rappelait Montauban. J’étais heureux de voir Granet en Italie. Avec lui, je pourrai parler. Bel homme, hâlé par le soleil à faire peur dans Paris, Granet plaisait aux Italiennes et ne se privait pas de me le faire savoir. Grand nez, joues creuses, quelque chose de Bonaparte à Arcole. Je n’en étais pas jaloux, rêvant de succès plus durables et de passions. Il voulait m’entraîner dans ses sorties nocturnes, cela ne m’amusait guère. Je lui laissais les belles faciles du Trastevere. Nous bavardions de peinture des après-midi durant, en aquarellant sur le Pincio ou dans les jardins Farnèse. J’imaginais ici la vie de Raphaël. J’avais sous les yeux la vue qu’avait eue Michel-Ange. Je jubilais. J’exultais. Je fatiguais tout le monde.
Le Colisée surtout dépassait mon attente. C’est en parlant avec François-Marius, le pauvre, que j’ai contracté mes habitudes pontificatoires. Plus tard, j’ai surpris mes élèves à recopier, dans leurs carnets de croquis, des sentences et maximes sur l’art que j’étais censé avoir dites. Pontifex maximus. Je ne voulais que leur apprendre à faire des lignes, les brosses à la main, sans adages ni théories. On ne m’a pas compris.
J’allais chaque jour voir les Raphaël du Vatican. Je les aime encore d’amour. Jamais rien ne m’avait paru plus beau, et je me disais que cet homme divin l’emportait sur tous les autres. Je suis convaincu qu’il travaillait de génie et qu’il portait toute la nature dans sa tête ou plutôt dans son cœur. Lorsqu’on en est là, on est comme un second Créateur.
Ce que je raconte ici date de mon premier voyage d’Italie. Je n’y régnais pas encore. Rien ne laissait présager l’accueil que me fit la villa Médicis en 1835, quand j’arrivai avec le prestige de l’ancien pensionnaire devenu directeur. Ce palais convient mieux à des vieillards qu’à des jeunes gens. Il offre ses lauriers à la vie qui s’allonge, il ne les promet pas toujours à l’enthousiasme de nos prix de Rome.
« Nos prix de Rome », voilà que je commence à écrire comme si je discourais dans mon habit de l’institut. Mieux vaut arrêter dès l’abord. À l’Académie, l’épée au côté, je finis toujours par bafouiller, par ne plus savoir lire. L’Empereur vient de me nommer sénateur. L’Impératrice Eugénie m’a l’autre jour parlé en souriant et je n’ai pas su quoi répondre. Je ne serai pas plus éloquent au milieu de ces gâteux, mes pairs. Du moins, c’est clair, on me dira conservateur. Aussi conservateur que le Sénat. On l’a si souvent répété. Qu’on ne me juge pas sans m’avoir entendu.
Rome a cessé de me plaire. J’y pensais en finissant mon tableau de Stratonice. La fièvre m’a saisi. Que le destin la patafiole et la Ville éternelle aussi, dans laquelle on ne peut vivre, avec son climat, et qui n’est plus la Rome que j’ai connue autrefois. Tout y est insupportable. Là-bas, il y a tant de choses que je n’ai pu vaincre, malgré ma patience, en art et partout, et une force de volonté dont, j’ose le dire, j’ai souvent fait preuve : je ne suis pas de bois, au contraire, je suis nerveux en diable. Et elle, bégueule et chaste, ma Stratonice.
Читать дальше