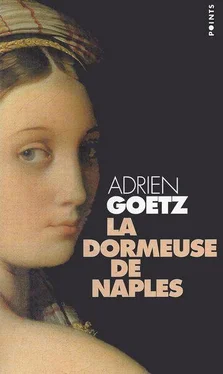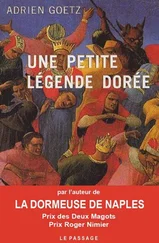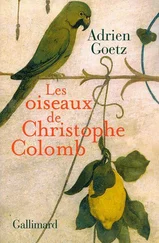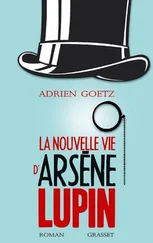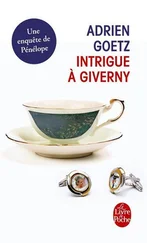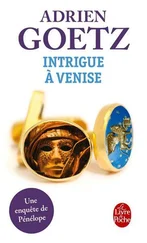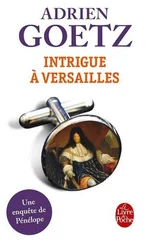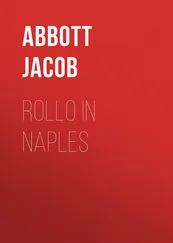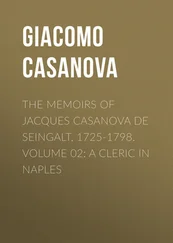C’est un privilège, que les anciens eussent pris pour divin, de voir s’incarner le plus secret de ses rêves. « Nous sommes de la même étoffe que nos songes » : Eugène Delacroix n’a pas le monopole des citations de Shakespeare, un écrivain que je me cache d’aimer — même si je l’ai fait figurer, avec Malherbe et Raphaël, parmi les grands hommes de mon Apothéose d’Homère, mon Panthéon d’admirations que les persifleurs ont pris pour un cabinet de figures de cire. La phrase de Shakespeare se trouve, je crois, dans La Tempête, qui est sa dernière pièce, comme Le Déluge est le dernier tableau achevé du Poussin.
Avec ma Napolitaine, j’aurais dû aller très vite. Comme d’habitude, je m’y suis repris à cent fois. J’aurais dû la posséder le premier soir, la prendre dans mes bras, dès qu’elle est entrée à l’atelier et qu’elle s’est déshabillée. Elle a fermé les yeux comme si elle dormait, ce que les modèles ne font jamais. Elle était si calme. Le calme est la première beauté du corps — de même que, dans la vie, la sagesse est la plus haute expression de l’âme. Voilà que je recommence à parler par maximes. Je me fais pitié. Ce soir-là, quand elle a remis sa robe et qu’elle est sortie, je lui ai baisé la main, et je n’ai même pas osé la raccompagner. Je n’avais pas assez d’argent pour commander une voiture. J’avais honte. Je l’ai regardée partir, à pas égaux, dans l’ombre de la petite rue. Je suis rentré.
J’ai fini la nuit en la dessinant, cent nouvelles fois, de souvenir.
J’étais sûr qu’elle reviendrait le lendemain. Je ne parvenais pas à croire à ma chance. Elle serait à nouveau sur le socle de bois qui servait à la pose.
Si j’avais fait l’amour, le premier jour, avec la belle dormeuse de Naples, aurais-je continué de peindre ? Sans doute, mais moins, et pas ainsi. Je n’aurais pas recommencé tant d’Odalisques et d’Angéliques, de Stratonices et de Vierges à l’Hostie. Je n’aurais pas cherché, ma vie entière, ce que j’aurais, en une nuit, trouvé et possédé. J’ai pour exemple le grand Poussin qui a souvent répété les mêmes sujets. Les femmes qui ont ensuite été mes maîtresses ne furent si nombreuses que pour me laisser vivre dans mes souvenirs de Naples. Celles que j’ai peintes depuis et qui n’ont été que des modèles — que je regardais comme un chirurgien qui dissèque — je ne suis jamais, si belles fussent-elles, parvenu à les désirer.
Débordant d’elle, j’ai inventé mes baigneuses, ma Jeanne d’Arc et ma baronne de Rothschild, j’ai changé les visages, mais je peux dire, devant certains dos, certaines hanches, certaines mains, que j’ai partout mis des carrés de chair qui lui appartiennent et que je pourrais désigner. Certains yeux sont les siens. Les vertèbres de l ’Odalisque qui ont tant inspiré les sots. L’ Odalisque, celle de Naples, que Murât n’eut pas le temps de m’acheter, que je remportais à Paris, non sans l’avoir retouchée, pour lui donner quelque chose de La Dormeuse de Naples, qui était du même format. J’inventais les formes pour qu’elles parlent d’elle. Si j’avais dû apprendre l’anatomie, je ne me serais pas fait peintre. Même quand Madeleine posait, elle qui n’aimait pas bien cela, je lui ajoutais sans rien dire une couleur au ventre, un pli sur le cou, qui appartenaient à sa rivale. Madeleine triompha toujours. Car je l’aimais ainsi, peinte avec le ventre de l’autre. Et je l’embrassais mieux ensuite, pour la remercier d’avoir posé. Je l’étreignais en la voyant telle que je venais de la peindre, belle comme l’autre et comme mon œuvre. Je déformais, on me crut fou. On dit que je pratiquais l’originalité comme une manière. Personne ne chercha à comprendre. Si l’on m’avait posé des questions, peut-être aurais-je répondu.
Le cou d’une femme n’est jamais assez long, ni son dos, ni ses doigts.
Je me prenais pour Raphaël, si jeune, si élégant, qui sans cesse peignait sa maîtresse. J’avais copié un portrait de Raphaël et il trônait à l’atelier ; j’avais mis des lauriers d’or au-dessus du cadre. Moi, vieux avant l’âge, nabot au nez pointu, amoureux inlassable de tout ce qui est beau. J’étais Raphaël pour elle, et elle ma Fornarina, ma donna velata. Mais Raphaël était mort à trente ans d’avoir trop aimé la Fornarina. Il signait ses portraits sur les rubans qu’il lui mettait, un nom au collier d’un chien. La Fornarina parut à ses funérailles, comme une Eurydice à l’enterrement d’Orphée. J’aime l’histoire d’Orphée, sans toutefois oser m’y confronter : Gluck l’a mise en musique, Poussin en tableau. Je me contente d’admirer leurs œuvres en rêvant que je vais chercher chez les morts, en jouant un air de violon, la femme qui a disparu. Orphée fut le dieu des artistes, je ne l’imite qu’avec la modestie feinte qui me va si bien. Moi, Ingres, je survis à mes amours, je n’emporte rien avec moi. Mais je me retourne souvent.
À Naples, une sorte d’intimité charmante s’établit entre nous. J’écris « charmante », je n’en pense rien. Les souvenirs d’alors me brûlent au fer rouge. Je savais ce qu’elle faisait à chaque heure du jour. Elle parlait en posant, elle racontait peu de chose d’elle-même. Certains jours elle boudait sans me dire pourquoi, faisait la capricieuse. Je lui aurais ouvert le crâne pour lire ce qu’il contenait. Que voulait-elle de moi ? Aurais-je droit à de l’amour ? Etais-je devenu un protecteur à la mode du pays, l’illustre étranger que l’on présente à sa famille, un grand frère, un sigisbée français ? Se moquait-elle, voulait-elle m’utiliser ? Si c’était ainsi, j’avais la satisfaction de ne pas être dupe — mais au fond, je m’en moquais. Tout cela me répugnait. Je voulais tout savoir d’elle, la comprendre. Pourquoi, jour après jour, elle revenait chez moi. Je connaissais sa famille, leurs amis. Tous m’aimaient, peu m’importait ; je connaissais chaque ligne de son corps, je pouvais dessiner de mémoire la petite tache qu’elle avait sur le mollet droit, placer le grain de beauté qui est sous la commissure de ses lèvres, du côté gauche, seules imperfections d’un corps qui, sans cela, n’eût pas appartenu à la Terre. Je savais comment étaient rangées ses dents et tous les autres détails ridicules que le premier amour inspire aux jeunes gens. Cinquante ans plus tard, je dessinerais son profil de mémoire, je trouverais dans ma palette la couleur, si rare, de ses cheveux. Toute cette science que j’avais acquise d’elle, je l’eusse échangée contre une heure de vraie intimité qui ne fût pas « charmante ». L’intimité que j’aurais pu avoir avec elle si je m’étais rué le premier jour. Jamais je n’avais aimé comme cela.
Le plus cruel, c’est que nous jouions les amoureux. C’était pour moi la pire des tortures, ces encouragements de badinage qui ne menaient à rien. Savait-elle que j’en souffrais ? Cela dura plusieurs mois. Pour peindre, j’enlevais mon alliance, qui alourdit la main. Non que je peigne de la main gauche, mais il me faut l’équilibre en tout quand je travaille. Elle me prit l’anneau d’or, le mit :
« Attends de m’avoir épousé, lui dis-je.
— C’est un peu cela déjà, non ? »
Je ne me passais plus d’elle. Mes journées s’écoulaient à la regarder. Souvent, je ne peignais plus. Elle s’en apercevait sans m’en faire la remarque. Elle me tournait en ridicule pour des riens, je ne savais pas jusqu’à quel point elle me permettait d’être familier. Elle fermait les yeux. Je me considérais déjà assez heureux.
Elle se laissait caresser. Je lui passais, tout en parlant, la main sur la nuque, je la décoiffais. Elle jouait à ne pas s’en apercevoir. Cela me mortifiait. Elle se laissait faire, mais ne m’encourageait pas. Si elle avait saisi ma main, quand je la passais dans ses cheveux, je l’aurais embrassée tout de suite. J’aurais voulu que quelque chose vienne d’elle. Elle me laissait faire seul tout le chemin de l’amour. Et je n’osais pas. Quand elle était nue, je ne la caressais pas, j’étais derrière mon chevalet comme un artiste à la torture. Je lui aurais donné tout.
Читать дальше