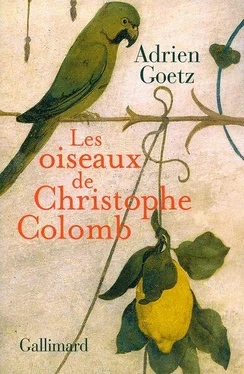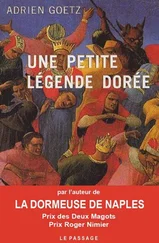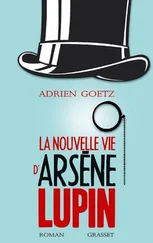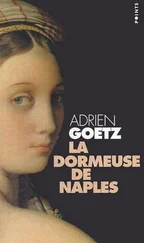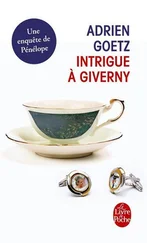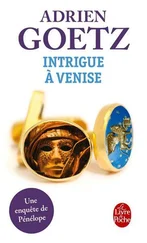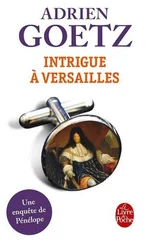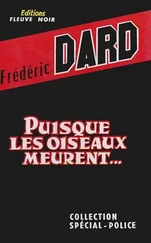ADRIEN GOETZ
Les oiseaux de Christophe Colomb
Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est…
MARCEL PROUST,
La Prisonnière
UNE PETITE FILLE ASTURIENNE
Alina a envie de rester au soleil. Ce matin, elle découvre qu’à côté de la maison de son oncle et de sa tante se trouve un jardin en désordre, avec des herbes folles et des coins tranquilles où les enfants viennent jouer. Elle a suivi les indications données par son oncle Juan : un peu avant onze heures, elle s’est faufilée pour passer entre une classe de première et un groupe de dames à cheveux blanc et bleu, devant le musée, sur le quai Branly, sans s’attendre à cette nature sauvage, à cet étang, à ces arbres. Elle regarde une grande affiche, sur laquelle il est écrit : « Le musée du quai Branly a dix ans » avec une petite fille, très bien dessinée, qui ajoute : « Comme moi ! » Alina trouve que la petite fille lui ressemble un peu, sauf que, elle, elle a treize ans. Sa tante a dit à une de ses amies, en la présentant : « Voici notre Alina, qui est en vacances à la maison, nous l’aimons beaucoup, c’est une petite fille asturienne. » Sa tante veut toujours faire l’intéressante : elle n’est plus une petite fille, elle est une jeune fille, et elle n’est pas en vacances, elle travaille, elle est à Paris pour trois mois. Elle se dit aussi que ce musée est un peu jeune, et elle espère surtout que son oncle ne la prend pas lui aussi pour un bébé et ne lui a pas conseillé un musée pour enfants.
Elle s’attendait à un musée comme le Prado, avec une entrée majestueuse et un grand vestibule à colonnes. Elle a cru d’abord qu’elle l’avait dépassé, qu’elle s’était perdue. Pourtant, c’est à deux pas de l’école. Elle est arrivée en longeant de beaux immeubles avec des grilles en fer forgé, dont celui où son grand cousin a sa chambre de bonne, qui lui ont rappelé les rues de Madrid ou de Barcelone. Puis les maisons ont été remplacées par de hauts murs de verre, qui laissaient voir un jardin, de l’autre côté.

Mur végétal du musée du quai Branly, conçu par Patrick Blanc, botaniste et chercheur au CNRS. Photo © musée du quai Branly / Cyrille Weiner.
Des amoureux faisaient des selfies devant une muraille de plantes, une prairie grimpait sur le bâtiment. Paris ressemblera peut-être à cela quand dans deux mille ans, ravagé par vingt crues de la Seine et caramélisé par le réchauffement climatique, il aura été abandonné et que la forêt commencera à pousser partout. Ce doit être drôle d’avoir sa fenêtre entourée de gazon. Qui peut bien vivre là ? Elle aura son premier téléphone, peut-être, à Noël, en rentrant à Gijón. Elle pourra elle aussi faire des selfies.
Au lieu de suivre les flèches qui indiquaient les guichets, elle a pris le temps de s’égarer un peu, parmi les roseaux. Sous le soleil, le long bâtiment rouge et ocre a l’air d’être l’ombre de la tour Eiffel. Il ressemble à un navire voguant dans les buissons. Ce jardin a été laissé en liberté. Alina se demande s’il existait avant les constructions, ou s’il est venu ensuite parce qu’il passe sous cette espèce de grand pont, au-dessus d’elle. Les allées sont des chemins de terre : elle n’est plus dans la ville, elle oublie Paris et Madrid, la tour Eiffel et son école.
Alina vient de Gijón, dans la principauté des Asturies. Elle a appris le français à l’école, elle commence à le parler plutôt bien. Dans sa « classe européenne », il n’y a que des enfants de professeurs, de médecins et d’avocats — sauf le petit Cristóbal, qui est le fils du pompiste de la station d’essence qui se trouve en face du collège, impossible de ne pas l’inscrire. Cristóbal, c’est son amoureux. Les parents d’Alina ont décidé de l’envoyer chez ses cousins, à Paris, pour le premier trimestre de sa troisième. Elle a d’abord eu un peu peur, mais très vite ce changement de monde l’a beaucoup amusée. Elle a découvert le quartier de la tour Eiffel, un salon de thé qui s’appelle Les Deux Abeilles, où les gâteaux sont délicieux, l’appartement de son oncle Juan et de sa tante Augustine qui donne d’un côté sur l’avenue Franco-Russe et de l’autre sur la rue de l’Université. Elle retrouvera Cristóbal en janvier.
Elle a un grand cousin, Arthur, qui vit heureux dans sa chambre de bonne au sommet d’une maison voisine, avenue de La Bourdonnais, et une cousine de son âge, Madeleine, qui a accepté de partager sa chambre pendant trois mois. Madeleine est parisienne : elle fume en cachette, a déjà eu trois ou quatre petits amis, écoute de la musique à fond et passe son temps sur Internet. Ses parents ont dû se dire que la cousine espagnole aurait une bonne influence sur elle.
Leur mère, tante Augustine, est toujours contrariée. Elle n’y est pour rien, c’est ainsi. Ils habitent un « appartement contrarié », comme elle le dit à chaque fois, quand elle le fait découvrir à ses amis. Elle veut dire qu’il s’agit d’un bel immeuble en pierre de taille, construit pour que les pièces de réception donnent sur l’avenue Franco-Russe, minuscule artère portant un nom d’entremets, et les pièces de service de l’autre côté, réputé plus bruyant à l’époque de la construction, parce qu’on imaginait qu’un grand bâtiment officiel s’élèverait en face, entre la Seine et la rue de l’Université. C’est un appartement de famille. Du temps des arrière-grands-parents, le salon était magnifique et sombre, et la cuisine, la buanderie, la salle de bains avaient la plus belle vue qu’on puisse imaginer. Comme tous les habitants de ce bout de rue, les grands-parents avaient eu l’idée — puisque rien ne se construisait en face — de contrarier l’architecture, de couper dans les boiseries et les stucs du salon pour installer le ballon d’eau chaude et de remplacer les petits carreaux des fenêtres des pièces du fond par des baies vitrées.
Quand on avait annoncé, voilà dix ans, qu’on allait enfin construire sur le terrain qui borde la Seine — où il n’y avait eu que des bâtisses provisoires et peu élevées — un nouveau grand musée, tante Augustine, qui avait grandi dans l’appartement contrarié et avait fini par lui trouver du charme, avait été très contrariée. Elle était devenue l’âme de l’association des riverains, très attentive aux projets d’architecture qui allaient être soumis au jury, pour qu’on ne lui cache pas le paysage.
Histoire de contrarier sa femme, l’oncle Juan, le frère du père d’Alina, s’était enthousiasmé pour ce projet d’un musée qui montrerait enfin les arts d’Afrique, d’Océanie, des Amériques… Augustine récriminait, traitait son mari de gauchiste, d’ethnologue, d’esthète, il lui répliquait que c’était un projet parfaitement gaulliste — le père de tante Augustine avait été un des compagnons du Général, toute la famille en tirait une légitime fierté — et il ressortait pour les mettre sur la table basse, dans le salon qui ne se souvenait plus qu’il avait été une cuisine cent ans plus tôt, les volumes de Malraux, avec de grandes photographies de masques africains. Il citait Michel Leiris et Marcel Griaule, elle s’abîmait dans les catalogues de rideaux, de voilages et de passementeries, et répétait à l’envi : « On se cramponne. Ils ne nous feront pas déménager. »
Читать дальше