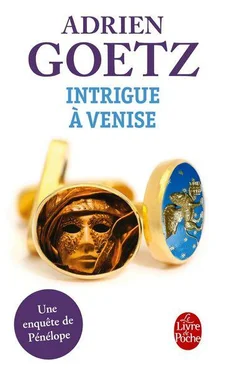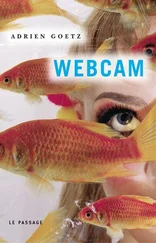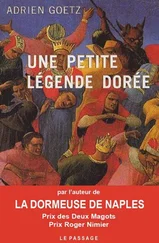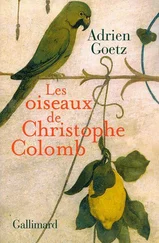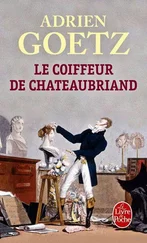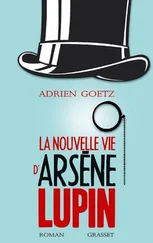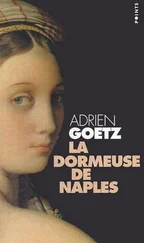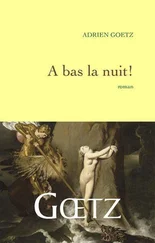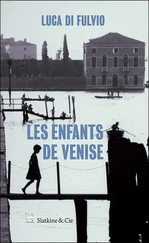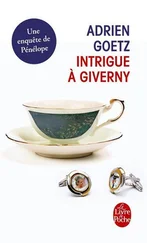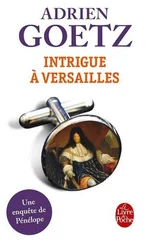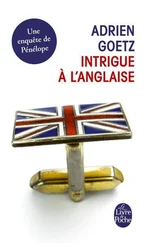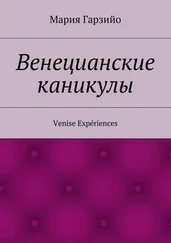Derrière la statue du condottiere, un homme se cachait. Elle a senti qu’on l’empoignait à bras-le-corps, une main sur sa bouche. Elle n’arrive pas à croire que dans deux secondes… Un coup sec, on la projette en avant, dans le canal.
Pénélope fouettée par le choc de l’eau froide s’est évanouie. Elle aspire de l’eau glacée. Elle revient à elle en un instant. Assez pour sentir sa bouche et son nez se remplir de vase saumâtre. Elle est au fond, n’arrive pas à remonter. Il faut qu’elle trouve la force de donner un coup de pied. Elle n’y arrive pas. Un courant plus fort la plaque, elle est allongée, elle se laisse entraîner. Elle sait qu’au moment où, par réflexe, sa bouche va s’ouvrir, ses poumons vont se remplir, et ce sera la mort.
DEUXIÈME INTERMÈDE
Qui se souvient du bal du siècle ?
Venise, palais Labia, 3 septembre 1951
Depuis le début de la journée, « Don Carlos » sait qu’il a eu raison de rêver cette soirée dans ses moindres détails avant qu’elle ne commence. Ceux qui disent que les amphitryons ne profitent jamais des fêtes qu’ils donnent n’y connaissent rien. Carlos se souvient de La Tempête , pas celle de Giorgione, celle de Shakespeare, et de cette phrase qui l’avait frappé dans son enfance : « Nous sommes faits de la même étoffe que nos songes. » Cette fête-ci, Carlos en profitera même après sa mort. Dommage que Winston Churchill n’ait pas pu venir ; sa femme, Lady Clementine, lui racontera. Don Carlos est habillé en patricien, avec une immense perruque blanche, une robe écarlate qui lui donne l’air d’un portrait sans cadre, le visage un peu trop plâtré et poudré, il a chaussé de petites échasses comme on le faisait au XVIII e, ses domestiques, portant des flambeaux, lui donnent du Monsieur le baron, ses amis l’appellent tous Charlie.
Don Carlos, Charles, Charlie, ancien élève d’Eton, châtelain de Groussay, Mexicain, Italien, Français, neveu d’un des plus grands donateurs du Louvre, avait décidé de rêver sa vie comme s’il était un Grand d’Espagne du Siècle d’or, habitué de l’Escurial et de la cour de Philippe II. Ce soir, il ouvrait au monde son chef-d’œuvre, son palais restauré avec une fantaisie absolue, qui échapperait dans ses détails aux mondains peu instruits qu’il avait conviés, mais qui retiendraient l’essentiel : ce soir il inventerait un style. Qui se souvient de la soirée de baptême du style Louis XV ? On se rappellera la soirée qui lança le style Beistegui, et ensuite on viendra voir le Labia depuis les extrémités les plus chic de l’Ancien et du Nouveau Monde. Carlos veut être respecté, admiré, imité. Il vole dans son manteau rouge de salon en salon, comme s’il survolait son triomphe à venir, c’était si beau ce palais, c’était si nouveau, retrouver la joie, le plaisir, le bonheur de s’éblouir soi-même. Et personne ne verrait, au milieu de cette féerie, ce qui se passera de réellement important ici, ce soir.
Le spectacle, avec les musiciens, ce sera celui des « entrées », réglées par Boris Kochno. Comme au théâtre, on verra s’avancer Orson Welles, Barbara Hutton, l’Aga Khan et la Bégum, Leonor Fini, Alexis de Redé, Arturo Lopez, jouant l’empereur de Chine, Georges Geoffroy, en oiseleur deux pas derrière lui, Paul Morand et Coco Chanel, Fulco di Verdura, Elsa Maxwell, Mimi Pecci-Blunt, le prince Jean-Louis de Faucigny-Lucinge… Il y aura Laura Bagenfeld, l’héritière des aspirateurs suisses, Jacqueline Mikhaïloff, la seule collectionneuse d’art contemporain que Peggy Guggenheim accepte de considérer comme une rivale, le peintre Gossec, toujours aussi inquiétant, heureux que Balthus ne soit pas là, et l’amiral sir Miles Messervy qui dirige, c’est un secret de polichinelle, les services d’espionnage britanniques. Les danseurs de la troupe du marquis de Cuevas se lanceront dans un rigodon du diable, les pompiers de la ville formeront une pyramide musclée copiée sur une estampe ancienne. Trois dames en robe et masque noir entreront, comme dans Don Giovanni de Mozart : Cora Caetani, Tatiana Colonna et Jacqueline de Ribes, la plus belle des trois, les épaules nues.
On a proposé à Don Carlos de filmer, il a refusé. Il a dit non aux journalistes. Si on veut créer un mythe, exclure les journalistes est une astuce assez simple. Il y aura des dessinateurs, Alexandre Serebriakoff prépare déjà ses tableaux à l’aquarelle. On a laissé entrer des photographes qui sont de grands artistes : Cecil Beaton — avec son collet d’abbé, on le prendrait pour le jeune Casanova —, Robert Doisneau, André Ostier, moins connu mais très doué. Surtout pas de caméra, il faudrait des projecteurs, cela tuerait le subtil dosage des lumières. Un film se démode, un rêve, non.
Pour devenir vraiment doge de Venise, il faut inviter les Vénitiens, leur parler, les reconnaître, les aimer sans avoir l’air de les humilier en leur jetant des piastres et des ducats. Donner une immense réception mondaine et faire défiler l’Europe élégante devant des badauds sarcastiques et exclus, c’est le secret pour se faire haïr, pour se faire traiter de Mexicain ou, pire, de Français. À Canareggio, sur la place, on lancera des danseurs, on escaladera des mâts de cocagne, ce sera une vraie fête du XVIII esiècle, les tonneaux seront en perce, on débitera des jambons et des poésies, et après deux heures du matin, on laissera sortir les farandoles d’invités déguisés. C’est son idée, faire rire les Vénitiens, les épater, les gondoliers, les vendeurs de cartes postales. Ils danseront avec Dalí, les Duff Cooper, les Dreux-Soubise — Mimi de Dreux-Soubise portera ce soir la copie du fameux collier de Marie-Antoinette qu’on se transmet dans sa famille, la monture est fausse mais les diamants sont vrais —, la jeune Natalie de Noailles, avec ses parents, Marie-Laure et Charles, qu’on n’a pas vus ensemble depuis des années, les Jacquelin de Craonne, autre couple en vue, en personnages des contes de Perrault, et même Raoul d’Andrésy, au bras de Raymonde de Saint-Véran.
Un jeune universitaire italien grimpera ce soir-là au mât de cocagne, Daniele Crespi, promis à une carrière brillante — il dirigera l’Istituto Veneto à un âge où il sera devenu moins souple. Le petit orchestre de la place et les musiciens des salons joueront ensemble, ou à peu près, car la cacophonie participe à la joie. Une chenille d’invités entraînera les Vénitiens dans ces salons sur lesquels on a fantasmé en ville depuis des mois, ce sera un joyeux cotillon, ils en parleront encore avec leurs petits-enfants. Même cette liesse spontanée, qui allait tant faire pour sa gloire, Don Carlos l’avait prévue.
Le Campo San Geremia était déjà illuminé. Carlos s’entendait bien avec le maire, et avec le curé, un cher saint homme qui se chargeait lui-même d’allumer les spots du campanile les soirs où il y avait des dîners sur la terrasse pour que le coup d’œil soit plus beau. Il passait souvent, vers minuit, boire un canarino .
Des potiches « bleu et blanc » au-dessus des portes, des dorures sans profusion, des argenteries, des épaves de grandes maisons venues de France, d’Espagne et d’Italie : pendant cinq ans, tout avait conflué vers le Labia, en bateau, en train, en camion… Les plus grands antiquaires du continent avaient mis de côté, repéré, rabattu du gibier pour le compte de « Monsieur de Beistegui » : tout avait trouvé sa juste place, comme les compléments et les subordonnées dans une phrase proustienne qui se déroulerait sur toute une page, dans un ordre parfait, comme si le palais avait déjà existé, autrefois, dans le cerveau de son créateur. Il avait disposé dans l’architecture du salon rouge de grands tableaux de Panini, peut-être pas de la main de l’artiste, mais qui savait vraiment, au XVIII esiècle déjà, ce que Panini peignait lui-même dans ses compositions colossales avec leurs cascades d’architectures imaginaires. Il avait voulu à côté, en contraste, le salon des tapisseries des Indes, la chambre de parade avec son baldaquin acheté dans un palais à Lucca, le salon des tableaux accrochés sur le décor en stuc, et le salon des jeux où nul n’avait jamais joué, le salon des soieries et, pour finir, blanc et noir, sortie d’une gravure fantastique un peu terrifiante, la salle des amiraux de la République — une invention pure dont il avait dessiné lui-même les détails, avec des obélisques, des rostres et des voiles, pour la plus grande gloire de la Sérénissime, et pour la sienne.
Читать дальше