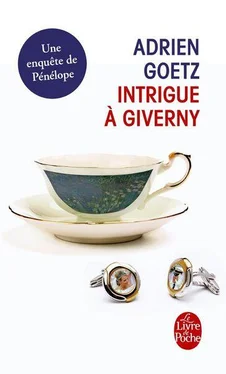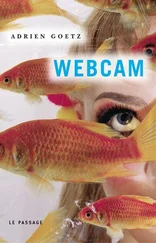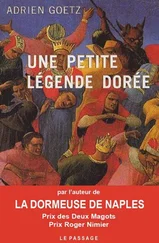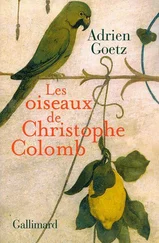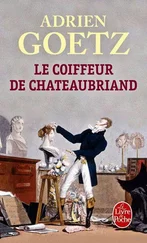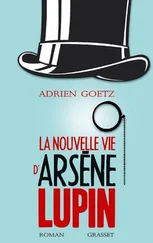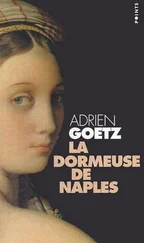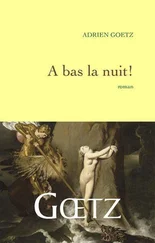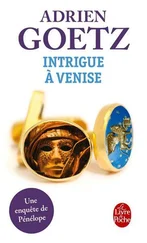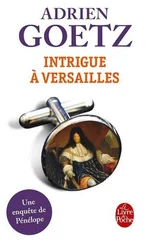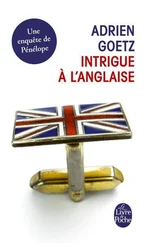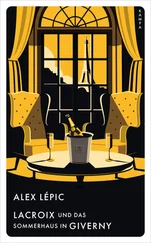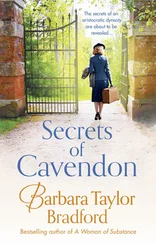Dechaume cite à Pénélope les noms de ses collègues d’Orsay : sur Claude Monet on fait les mêmes expos depuis cent ans, Monet et le paysage, Monet et les séries, les meules, les peupliers, les cathédrales, Monet et ses amis impressionnistes, on finira même par faire l’impressionnisme et la mode, avec des ombrelles et des chapeaux dans des vitrines, on n’en peut plus, il serait temps d’inventer autre chose, d’attaquer vraiment le sujet. Il en a, lui, des idées !
Son pire ennemi, c’est celui qu’il couvre de compliments : son ami Kintô, qui dirige Giverny. Comme il ne pouvait se satisfaire de la surveillance des floraisons — l’éclosion des tulipes début mai, l’arrivée progressive des nymphéas sur l’étang, à la longue, on peut se lasser —, il a décidé de faire copier par des « artistes » — à la limite de l’escroquerie prétendait Dechaume — les tableaux que Claude Monet possédait chez lui.
« Dont la plupart sont à Marmottan ! Bien sûr, le visiteur n’est pas trompé, on met à sa disposition une “feuille de salle” grâce à laquelle il est censé comprendre que les tableaux qu’il voit autour du lit ou au-dessus de la commode sont en réalité à Zurich ou à Washington. Mais qui lit vraiment ça ? »
Pénélope fait comme si elle avait vu ces nouveaux aménagements, et s’en veut un peu de ne pas avoir écouté Wandrille. Il faut vraiment qu’ils aillent à Giverny. Elle se souvient d’un article dans Le Figaro qui faisait l’éloge de cet accrochage qui restituait l’atmosphère de la maison au temps de l’artiste, quand elle était pleine de chefs-d’œuvre.
« Pour moi, concluait Dechaume, ce sont des visiteurs en moins. Quand les Japonais et les Chinois ont vu Giverny, avec ces clones de tableaux, ils croient qu’ils ont tout vu. Vous pensez qu’ils ont encore envie d’aller chez moi ? Giverny prend des visiteurs à Marmottan, je perds de l’argent… »
4
Paprika met son grain de sel
Paris, vendredi 24 juin 2011
La porte de l’atelier venait de battre, avec fracas. Second tremblement, la porte de la cuisine : une tornade entrait, en jean, ballerines Repetto, pull en cachemire bleu électrique, cheveux blancs coupés court, Paprika Dechaume — qui a l’air plus jeune qu’en robe du soir et colliers. Elle s’assied sur un tabouret, elle éclate de rire : « Alors, on picole sans moi ! »
Antonin, son mari, n’a l’air ni surpris ni même vraiment contrarié. Il se lève, va chercher un verre dans l’armoire paysanne vestige d’un goût « arts et traditions populaires » de 1975.
Pénélope se demande si elle a comme cela l’habitude d’arriver à l’improviste dans l’atelier de son mari. Elle se sent un peu soulagée de voir que la conversation va cesser d’être un tête-à-tête, et qu’elle ne va pas être obligée de finir la bouteille dont le vieux maître n’a pas cessé de la resservir.
Elle se lève, sourit, fait remarquer à cette femme qui a tout d’une épouse jalouse qu’elle a les mêmes ballerines. Parika sourit : « Oh, vous les avez en jaune, c’est original, je ne les avais jamais vues, moi je suis toujours en bleu, je n’y peux rien… »
Pénélope écoute les premiers échanges du vieux couple. Paprika a acheté les journaux.
« Rien sur le crime, dit-elle. Pauvre Carolyne ! Quand je pense qu’on lui a tranché la gorge avec une lame très fine, d’un seul coup, il paraît qu’il faut une dextérité incroyable pour faire ça. Elle ne s’est pas débattue, on a retrouvé ses bras le long du corps. Elle a dû crier, mais c’est une espèce de salle souterraine, avec deux grosses portes. Il n’y avait personne, on ne l’a pas entendue. Elle a dû tellement souffrir. Carolyne ! Elle était avec nous la veille, chez nous, vous vous rendez compte, mademoiselle, on n’a même pas pu lui dire au revoir…
— Paprika, tais-toi, je t’en prie, on cherchait justement à y voir un peu clair. Assieds-toi, ne reste pas perchée comme ça sur l’escabeau. »
Pénélope se dit qu’un Monet ça ne doit pas être si difficile à copier : plus facile de tartiner des nymphéas que de réinventer la lumière de Vermeer ou le sfumato de Léonard de Vinci.
Pénélope a sorti son carnet. Elle note. Sans se soucier vraiment de l’irruption de sa femme, Dechaume continue à énumérer ce qui l’intrigue chez son artiste.
Pénélope comprend qu’il ne veut pas parler à sa femme de ce qu’il a découvert, ou plutôt deviné, à propos de ces deux femmes, comme s’il se méfiait. Paprika doit être une pipelette. Pour le moment, elle joue la femme soumise : elle a le petit doigt sous le menton, les lunettes en diadème, elle écoute.
La logique des voyages de Monet à l’étranger par exemple, quand il commence à être un peu riche, échappe aux historiens de l’art, et Dechaume avoue que lui n’y comprend rien. Les biographes le voient uniquement comme un peintre allant chercher l’inspiration.
« Ces voyages du peintre, jamais prévisibles, jamais au moment où on les attendrait ! Pendant la guerre de 1870, il est à Londres, il décide de revenir, mais pas à Paris. On pouvait pourtant avoir besoin de lui… La France vaincue, les Prussiens, ce n’était pas l’époque idéale pour faire du tourisme. Il s’est installé dans un village perdu à une heure d’Amsterdam.
— Qu’est-ce qu’il y a fait ?
— On l’ignore, Pénélope. Clemenceau à l’époque s’engage, avec son journal, La Justice , Renoir regarde Paris qui flambe. On ne sait rien de ce séjour en Hollande, sauf qu’un jour, dans une boutique où on emballait de la porcelaine de Delft, il a découvert les estampes du Japon qu’on utilisait pour bourrer les caisses, et ce fut une révélation. Pour l’histoire de l’art, ça va, mais pour l’histoire tout court, c’est court. Il devrait se précipiter en France, sa maison de Louveciennes a été pillée, il a des œuvres détruites, Adolphe Monet, son père, vient de mourir et il faudrait s’occuper de la succession… Lui, il voyage…
— Il voulait fuir tous ces cauchemars, ne vivre que pour la peinture, ce que vous énumérez là c’est le pire de la vie réelle, on peut comprendre qu’il ait voulu s’évader…
— J’ai d’abord cru ça, Pénélope, c’est aussi ce que les biographes ont tous écrit. Mais on a dans les archives une note du commissaire de police de Zaandam, en juin 1871, qui signale au commandant des forces de police de la province l’arrivée de cet homme de trente et un ans se disant peintre. Pourquoi surveiller Monet, que personne ne connaît ? Et le commissaire de police rédige une série de notes sur ce personnage suspect, comme si on les lui avait demandées en haut lieu… On ne sait rien. Monet dessine des canaux, des bateaux hollandais dans ces carnets qui sont chez nous au musée. Paprika aime les regarder.
— Ses autres voyages sont aussi étranges ?
— Pires ! Au moment où il est encore très pauvre, où Durand-Ruel son marchand oublie de lui envoyer ses versements, où Alice est malheureuse à Giverny dont ils ne sont encore que locataires, il plaque tout pour s’installer dans l’endroit le plus cher de France, la Côte d’Azur, en 1884, où il prétend mener une vie “muette et solitaire”. Il peint des palmiers, de jolies vues des environs de Monaco, mais on ne sait pas qui il fréquente ni ce qu’il fait là. Il a peint la villa du richissime Bischoffsheim à Bordighera, grand repaire de mondains et de diplomates. On a le tableau mais on ne sait rien.
— Avait-il rencontré le prince de Monaco ? hasarde Pénélope, tentant de voir si deux morceaux du puzzle ne pourraient pas s’ajuster.
— Pas à ma connaissance, mais ce n’est pas exclu. Et il y retourne quatre ans après ! Il retrouve Maupassant, avec qui il avait sympathisé sur la plage d’Étretat. L’auteur a son yacht, le Bel-Ami , il connaît tout le monde et Monet ne connaît personne. Au même moment Renoir est à Aix, chez Cézanne, il se garde bien de signaler à ses vieux amis qu’il est à proximité. Monet envoie une curieuse lettre à Castagnary, le critique qui l’a défendu autrefois et qui vient d’être nommé directeur des Beaux-Arts, l’équivalent de ministre de la Culture, pour avoir, figurez-vous cela, le droit de s’approcher de la citadelle d’Antibes. C’est un site militaire, et toute la zone est interdite. Pourquoi veut-il précisément peindre là ?
Читать дальше