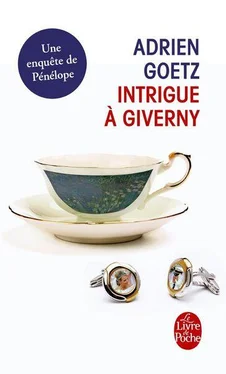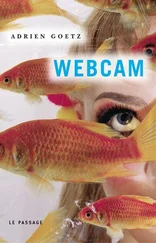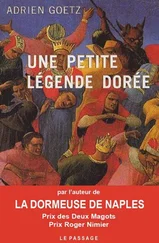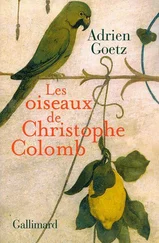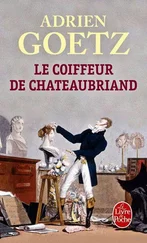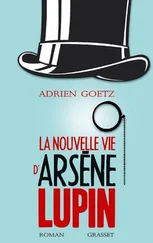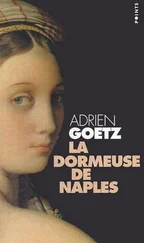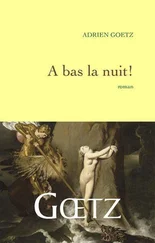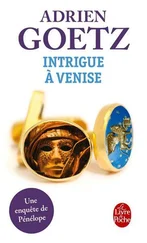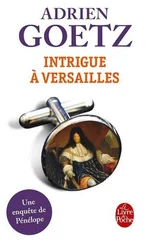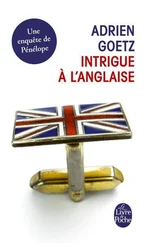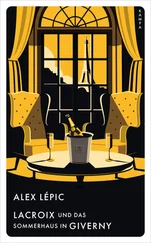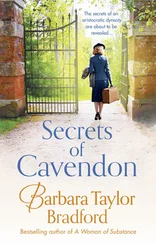— Cela ne me semble pas si étonnant. Il a d’abord une première période misérable et solitaire, à part Clemenceau avec lequel il est devenu ami, il ne connaît personne qui soit en vue. Puis, avec le succès, les bonnes relations arrivent, schéma classique…
— Pas tant que ça. Prenons l’époque où il est déjà reconnu, où il vend bien, il fait trois séjours à Londres, entre 1899 et 1904. Des voyages marquants. Il pourrait aller se délecter des verts de la campagne anglaise, ou voir si les falaises de Douvres ne seraient pas plus belles que celles d’Étretat. Eh bien, il ne bouge pas de la capitale et les gens qu’il rencontre, comme si c’était par hasard, sont stupéfiants, tout le gratin politique anglais. Je ne sais pas comment il est arrivé à peindre malgré tout autant de vues de la Tamise. »
Pénélope n’est pas venue ici pour qu’on lui raconte la vie de Monet. Et Dechaume explique, en la resservant de montrachet, comment en février 190 °Clemenceau en personne vient le retrouver là-bas. Il s’est installé au Savoy. Clemenceau l’appelle le « bon voyant », c’est drôle comme expression. Monet rencontre par exemple Mrs. Asquith, un des contacts de Clemenceau, la femme de celui qui, en 1908, devient Premier ministre. On ne sait rien de leurs rapports, le seul document qu’on possède c’est l’autorisation d’accès à la Tour de Londres qu’elle lui a procurée. Voulait-il peindre ce haut lieu de l’histoire anglaise ? Aucun tableau n’en témoigne. Avec Mrs. Asquith, il rencontre beaucoup de membres de la Chambre des lords et de celle des communes.
« Il veut peut-être séduire une clientèle susceptible de commander des portraits mondains. Renoir en tartine en quantité à cette époque, ça se vend bien.
— Pénélope, on ne connaît aucun portrait de parlementaire britannique peint par Monet…
— Il serait au cœur de la vie politique anglaise ? Cela ne cadre pas bien avec l’image du peintre des coquelicots. Et vous avez raison, j’ai feuilleté le catalogue Wallenstein, on n’a aucune vue de la Tour de Londres par Monet.
— Monet par exemple est invité à assister au convoi funèbre de la reine Victoria, morte en janvier 1901. C’est alors qu’il rencontre Henry James, qui connaît le Tout-Boston, le plus grand écrivain américain. Ils sont assis au même balcon. Au premier étage d’une maison de Buckingham Gate, chez des amis très fortunés et très influents.
— Jolie scène, racontez-moi, j’imagine toutes les maisons du parcours drapées de crêpe…
— Pas de noir pour la reine Victoria ! Elle est en robe de mariée et toutes les fleurs sont blanches, ça a dû plaire à notre Claude. Henry James parle un français impeccable, que se sont-ils dit ? On l’ignore. »
Pénélope imagine cette scène d’une parfaite invraisemblance. Quand Victoria est montée sur le trône, la peinture en était aux élèves de Jacques Louis David, on admirait les Sabines et on discutait des nouveautés apportées par M. Ingres, on s’effrayait de l’audace d’Eugène Delacroix. Elle-même avait pratiqué l’aquarelle, rempli des albums de bords de mer, collectionné les orientalistes. À sa mort, Monet est là, et ce qu’il peint est d’une modernité incroyable…
« Le plus grand peintre français et le plus grand écrivain américain sur le même balcon, c’est beau…
— Leur ami commun, Pénélope, c’est l’Américain John Singer Sargent, très grand peintre lui aussi, très “homme du monde”. Il va souvent voir Monet, au Savoy, chambre 541, qui devient leur quartier général. Or voici ce qui m’intrigue. Sargent trouve pour Monet, à la demande de celui-ci, une sorte de cache dans Londres : une petite pièce à l’arrière d’un club dont Monet dit “là au moins je ne serai vu de personne”, dans une lettre que j’ai lue. Pourtant, il n’y reste que du 5 au 10 mars 1901. Les historiens de l’art disent qu’il y aurait peint trois toiles, des nocturnes londoniens. Que faisait le peintre de la lumière dans les nuits de Londres ? Il passait des nuits à marcher. Et Alice se morfond à Giverny pendant ce temps-là, elle se querelle avec les domestiques, il s’en moque !
— Alice ne devait pas être très facile… Monet ne l’emmenait guère en voyage… Je crois qu’il n’y a rien là de mystérieux, le séjour de Londres a été très prolifique, il a énormément peint, non ?
— Il y a un peintre qui a connu Monet à cette époque, Alexander Harrison, ami de Sargent. Il dit que Monet ne peint pas dans Londres, qu’il travaille tout en atelier. Il a même osé écrire plus tard qu’il envoyait à Monet des photographies des ponts de Londres et du Parlement pour finir ses toiles de Londres à Giverny.
— Calomnies ! On a retrouvé des grains de sable dans ses scènes de plage. Monet fait tout en plein air ! C’est son credo !
— Au début, sans aucun doute, mais ensuite… Il a une méthode, il peint vite.
— Pour capter l’instant.
— Il est capable selon moi de brosser dix vues de Londres, de mémoire, en trois jours, histoire de faire croire à Alice et à ses marchands qu’il a énormément travaillé pendant son séjour. Mon idée, c’est que Monet à Londres ne consacre pas du tout son temps à peindre, et qu’il y fait bien d’autres choses, pour lesquelles il a besoin d’être absolument seul et tranquille.
— À part Londres, il a fait des sauts de puce à droite et à gauche, mais il n’entreprend pas de vrais voyages…
— Vous plaisantez ! En 1904, impromptu de Madrid : Alice cette fois est du voyage. En bon bas-bleu elle l’emmène dans les musées. C’est Greco à Tolède et Vélasquez au Prado, les grands d’Espagne leur ouvrent leurs collections, les plus riches amis de la famille royale viennent les voir, et je peux vous garantir que ce n’est ni le charme ni le sourire d’Alice Monet qui est susceptible d’attirer tout ce beau monde, elle n’a rien d’une grande dame… Elle va y prendre goût et exiger bientôt Venise. »
Pénélope se demande s’il va en arriver à lui parler du séjour de Monet sur la Côte d’Azur et à Monaco. Il semble éviter le sujet.
Les vraies raisons du départ du couple Monet pour Venise sont épouvantables, ajoute le directeur de Marmottan en baissant la voix. Il explique à Pénélope qu’il ne peut rien lui dire…
Elle insiste. Il lui révèle alors que Monet et Alice avaient eu peur des attaques des journaux. Il était devenu un personnage public, très contesté comme peintre, un homme en vue, elle voulait jouer enfin un rôle de dame convenable et chic. Coup de tonnerre : on avait assassiné sauvagement le mari d’une des sœurs d’Alice, un crime crapuleux qui avait été le feuilleton de l’année 1908.
« Sœur Marie-Jo venait de reconstituer toute l’affaire. Elle avait refait l’enquête, lu tous les journaux, épluché les archives de la préfecture de police. Elle avait eu le temps de me raconter un peu, mais nous devions nous revoir cette semaine. Elle semblait attacher beaucoup d’importance à cette aventure. Cela s’appelle dans les annales de la police “le crime de la rue de la Pépinière”, jamais éclairci. Monet s’en serait bien passé. Parce que ce n’est pas seulement un assassinat, c’est un vrai scandale, une affaire de mœurs comme on disait. Cela n’effarouchait d’ailleurs pas du tout notre religieuse. Monet veut changer les idées de sa femme, il l’emmène en Italie. »
Pénélope se promet bien de chercher à en savoir plus sur cette affaire. Un crime lié à Claude Monet, aucun des ouvrages d’histoire de l’art qu’elle a lus n’en fait mention… Qu’était-ce, cette rue de la Pépinière ? Cela ne lui dit rien.
Le soir même, elle se promet de lancer Wandrille sur cette piste : en consultant les journaux de l’époque sur le site internet de la Bibliothèque nationale, il aura vite compris toute l’affaire.
Читать дальше