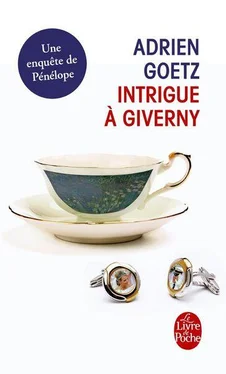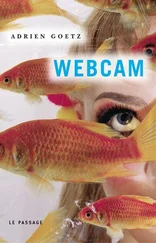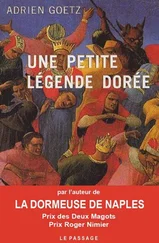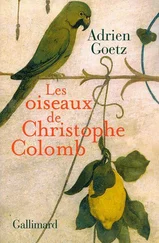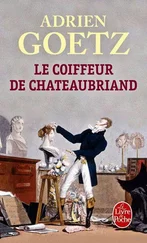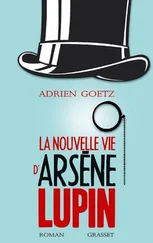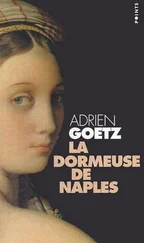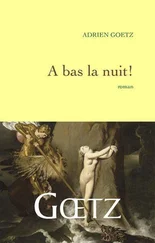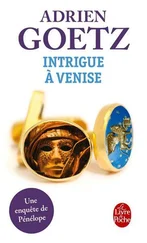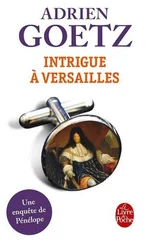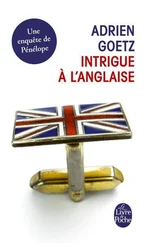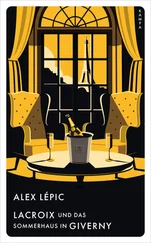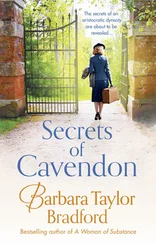« Le crime de la rue de la Pépinière, c’est le troisième mystère sur ma liste. Je ne comprends pas ce qui s’est passé. Pourquoi cela a touché les Monet de si près, Alice ne voyait pas si souvent sa sœur et son beau-frère… Pourquoi je vous raconte tout ça, Pénélope…
— Parce que cette religieuse a disparu ?
— Elle venait au musée travailler à partir des documents Monet que nous avons dans les réserves, c’était un puits de science. Elle était la parfaite petite souris grise qu’elle avait l’air d’être, autoritaire, déterminée, bûcheuse, elle ne lâchait jamais le morceau, pour la plus grande gloire de Dieu et du couvent de Picpus : les recherches de sœur Marie-Jo sur Monet lui rapportaient énormément d’argent. Elle me racontait tout, je lui donnais des idées, elle en avait aussi, qu’elle testait sur moi, elle avait beaucoup avancé depuis un an. Je voulais qu’elle écrive une biographie. Ce n’était pas moi qui la payais. Je n’aurais pas eu les moyens de l’entretenir, elle était très gourmande, les bonnes œuvres ça peut très vite devenir faramineux, mais elle venait toujours me parler, pour le plaisir, après une journée dans nos réserves… Elle remontait de la chambre forte du sous-sol, Paprika et moi nous lui faisions du thé, mais une fois sur deux elle me faisait sortir mes bouteilles de vieux whisky… C’est elle qui faisait vivre sa communauté, grâce à Monet.
— Il faut m’expliquer comment c’est possible. Pourquoi, cher maître, parlez-vous d’elle au passé ? »
2
Où Wandrille médite l’assassinat de sa voisine pianiste et imagine de devenir, enfin, écrivain
Paris, vendredi 24 juin 2011
Wandrille a filé chez lui, retrouver son appartement : sa voisine Sophie, qui avait dû s’apercevoir qu’il n’était plus là ces jours derniers, fait retentir dans la cage d’escalier des notes d’une sonate de Beethoven sur laquelle elle s’acharnait déjà la semaine passée. Wandrille aime bien sa voisine, une fille très dynamique, il n’ose rien lui dire — mais son appartement à lui est en train de devenir inhabitable… Il reconstitue toute l’histoire. Elle a dû se faire plaquer par son petit ami. Du coup la malheureuse se venge sur son piano. Impossible d’aller frapper pour lui demander d’arrêter, elle va pleurer.
Sur le meurtre de Carolyne Square, difficile de recueillir des informations. Les journaux semblent déjà passés à autre chose. Wandrille regrette un peu d’avoir quitté le monde enchanté de Monaco, d’autant qu’avec le sympathique archiviste au costume de lin il sent qu’il aurait pu apprendre bien des choses au sujet des préparatifs du mariage…
Wandrille a tout organisé pour une journée à Giverny. Ils vont y aller le lendemain. Il a aussi mené l’enquête au sujet des Wallenstein.
L’« Institut Wallenstein » est un coffre-fort en pierre de taille, rue de Tilsitt, impossible d’y entrer, c’est un mythe dans l’histoire de l’art. On dit que des centaines de tableaux dorment dans ses caves. C’est là que se trouve l’essentiel de la documentation sur laquelle cette famille d’experts et de collectionneurs depuis trois générations a construit sa puissance. Rien de suspect, lui a assuré son père, ils sont très fortunés, intelligents, ils veulent avoir la paix, c’est leur droit, non ? Son père connaît vaguement l’héritier, ce Thomas Wallenstein, et il lui a promis de lui téléphoner pour lui demander si par hasard il ne pourrait pas recevoir son « bon à rien de fils » — ça fait toujours plaisir.
Pénélope lui envoie un texto : « Dechaume raconte plein de trucs. Suis saine et suave » — avec ces « Smartphones » les mots d’esprit s’écrivent tout seuls. Puis elle a tapé un second message aussitôt après : « Il est allé à la cave me chercher du vin blanc. Trouve tout ce que tu peux sur Internet au sujet d’un crime rue de la Pépinière en 1908. »
Depuis des années qu’il est journaliste, Wandrille se dit qu’il est prêt à devenir écrivain. Il va s’y mettre, en essayant de faire abstraction de ce vacarme beethovénien qui l’exaspère de plus en plus. Il a acheté un cahier de moleskine grand format. Pas un roman, on en a trop fait, pas un livre d’histoire, on n’en peut plus : une pièce de théâtre.
Un petit acte en prose. La scène se passera sur une route, du côté de Cannes. Quand il en a dit l’argument à Pénélope, elle a trouvé ça formidable. Titre : Où allez-vous, Monaco ? La recette du succès au théâtre c’est de concentrer le budget : n’avoir que deux personnages, mais deux bons acteurs « bankables », qui vont tenir la pièce, un vague décor et une excellente attachée de presse. Les deux acteurs joueront l’un Napoléon, l’autre le prince de Monaco, impossible de faire mieux. Il lui faudrait Christian Clavier et Jean Rochefort. Il hésite à l’écrire en vers, comme une pièce d’Edmond Rostand, bien sûr ça sera un peu plus difficile. Mais rien n’est impossible à Wandrille : il est heureux. Pénélope et lui se marient.
« Quoi, c’est vous, Monaco, et dans quel équipage !
— Oui, je suis souverain et voyage sans pages… »
Il en est là. Il faudra deux costumes, mais faciles à trouver. Napoléon exilé à l’île d’Elbe vient de débarquer à Golfe-Juan : petit chapeau, redingote grise. Dans l’auberge qui l’accueille, lui et une poignée d’hommes, il reconnaît, caché dans son manteau de voyage et déguisé en bon bourgeois, un cavalier qui était officier dans sa garde personnelle aux Tuileries, l’année précédente, avant l’abdication et l’invasion de la France par les troupes alliées. Cet officier s’appelle Honoré Charles Anne Marie Maurice Grimaldi. Le roi Louis XVIII installé dans les salons pleins d’aigles et de N du palais des Tuileries vient de le replacer, lui aussi, sur son trône.
Il est désormais, aux yeux de tous, Honoré IV, prince de Monaco. Aux yeux de tous, c’est vite dit, car nul ne le sait : le roi Louis XVIII à peine restauré vient d’apprendre que Napoléon vole vers Paris, et sur le Rocher il n’est pas certain que les pêcheurs et les cabaretiers aient entendu dire que leur prince était en route pour retrouver ses terres. Napoléon, qui l’a reconnu en un éclair, l’interpelle, en prose ça pourrait donner ça :
« Où allez-vous, Monaco ?
— Je rentre chez moi, Sire.
— Moi aussi, aux Tuileries ! »
L’aigle qui allait se hisser de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame et le prince qui partait ceindre sa couronne se sont enfermés durant deux heures dans une auberge, et personne n’entendit la suite de leur conversation.
Reste donc à l’écrire, s’est dit Wandrille, tous les ingrédients du triomphe sont là… L’humanité du pouvoir, la folie des conquêtes, à Paris, Talleyrand — lointain prédécesseur de papa — et Fouché — l’inventeur des méthodes de maman —, ça touche Wandrille, ce premier voyageur au fait de tout arrivant de la capitale que Napoléon croise sur son chemin, et qui l’informe des potins, l’impératrice Marie-Louise qui ne répond plus au téléphone et tous les anachronismes monégasques qu’on pourra imaginer.
Ou alors, il hésite, autre pièce possible, il y aurait un autre dialogue de deux grands hommes à inventer. Mais on n’a aucun document historique. Le prince Albert I er, le grand navigateur, le pionnier de l’exploration des fonds marins, le modèle du capitaine Nemo, rencontrant par hasard Claude Monet en train de peindre dans les rochers devant Cap-Martin. Claude Monet ce serait Depardieu, le prince Albert I erce pourrait être… voyons…
La Lettre à Élise , ça suffit. Wandrille, qui n’arrive pas à se concentrer, se décide. Tant pis s’il vexe sa voisine, il envoie un texto : « Si tu ne passes pas tout de suite au second mouvement, je lance une machine à laver cycle long. »
Читать дальше