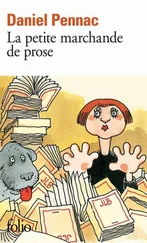71 ans, 8 mois, 5 jours
Jeudi 15 juin 1995
Pas de comique sans éducation.
72 ans, 2 mois, 2 jours
Mardi 12 décembre 1995
Certaines maladies, par la terreur qu’elles inspirent, ont la vertu de nous faire supporter toutes les autres. La propension à envisager le pire pour accepter le contingent est au menu de nombreuses conversations chez les gens de ma génération. Hier encore, à la table des Verne, s’agissant du diagnostic de T.S. : On craignait une maladie d’Alzheimer, par bonheur ce n’était qu’une dépression. Ouf ! L’honneur est sauf. T.S. n’en finira pas moins fada, mais il ne sera pas dit qu’Aloïs aura eu sa peau.
Je ricane intérieurement sans pour autant m’exclure du lot. Je préférerais mourir plutôt que de l’avouer mais la menace Alzheimer (et je songe bien sûr à Étienne dont l’état s’est encore dégradé) me terrorise tout autant que n’importe qui. Toutefois, cette peur a un mérite : elle me distrait de ce qui m’affecte pour de bon. Mon taux de sucre est préoccupant, ma créatinine hors de proportion, mes acouphènes brouillent de plus en plus les ondes, ma cataracte me fait un horizon flou, je me réveille chaque matin avec une douleur nouvelle ; bref, la vieillerie progresse sur tous les fronts mais je n’éprouve qu’une seule vraie peur : la peur d’Aloïs Alzheimer ! Au point que je m’impose quotidiennement des exercices de mémorisation que mon entourage prend pour un passe-temps d’érudit. Je peux réciter des pans entiers de mon cher Montaigne, du Quichotte , de mon vieux Pline ou de La Divine Comédie (en leur langue d’origine, s’il vous plaît !), mais s’il m’arrive d’oublier un rendez-vous, d’égarer mes clefs, de ne pas reconnaître Monsieur Machin, de buter sur tel prénom ou de lâcher le fil d’une conversation, le fantôme d’Aloïs se dresse aussitôt devant moi. J’ai beau me dire que ma mémoire a toujours été capricieuse, qu’enfant elle me trahissait déjà, que je suis comme ça et pas autrement, rien n’y fait. La conviction qu’Alzheimer m’a enfin rattrapé l’emporte sur tout raisonnement et je me vois à brève échéance au dernier degré de la maladie, contact perdu avec le monde et avec moi-même, chose vivante qui ne se souvient pas d’avoir vécu.
En attendant, on me réclame un poème au dessert, que je récite non sans me faire prier, comme il se doit. Ah ! Vous au moins, vous n’êtes pas guetté par la maladie d’Alzheimer !
72 ans, 7 mois, 28 jours
Vendredi 7 juin 1996
Frédéric, médecin, amant et professeur de Grégoire en médecine interne, se plaint de ne pouvoir dîner en ville sans être bombardé de questions relatives à la santé des convives. Pas une soirée où la moitié des invités ne quémandent diagnostics, thérapies, avis, recommandations pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Ça l’exaspère. Depuis que j’exerce, dit-il, et même depuis que je suis étudiant, personne ne m’a jamais demandé à quoi je m’intéresse dans la vie quand je ne joue pas au docteur ! À tel point que sortir lui fait horreur. N’étaient les désirs de Grégoire dans ce domaine, Frédéric resterait cloîtré chez lui parce que… (ici, sa main tranche au-dessus de sa tête), ras le bol ! Selon lui, la table chamanise le médecin. De voir le toubib bouffer et boire son coup comme tout un chacun, ça vous le rend fraternel, il devient le sorcier de la tribu hypocondre, le gourou de ces dames, ce docteur exceptionnel — et tellement humain ! — qu’on a rencontré chez les Untel, tu te souviens, chéri ? À l’hôpital, dit Frédéric, aux yeux des mêmes, je dis bien des mêmes , je suis d’abord un candidat mandarin soupçonné de creuser le déficit de la Sécu pour collectionner les Porsche. À table non, me voilà devenu l’incarnation d’une médecine humaine, respectable et compétente. Si vous êtes chirurgien et qu’on vous a rencontré chez des amis on vous suivra comme un toutou jusque sur la table d’opération et on recommandera chaleureusement votre bistouri à d’autres amis, car les médecins ont ceci de commun avec les confitures : ceux de la famille sont incomparables ! Quand je vois mes externes s’échiner aux urgences j’ai envie de leur crier : Fichez le camp, laissez tomber vos malades, allez dîner en ville, c’est là que se font les carrières, pas dans la salle de permanence !
Frédéric s’échauffe tout seul pendant une bonne partie du dîner, puis, se levant de table, malice et venin dans l’œil, il me demande : Et vous, ça va ? La santé, ça boume ? Profitez-en tant que je suis là !
72 ans, 7 mois, 30 jours
Dimanche 9 juin 1996
L’homosexualité de Grégoire. J’ai beau avoir l’esprit large («avoir l’esprit large », l’étroitesse de cette expression !), mon imagination demeure obtuse en matière d’homosexualité. Si mes principes l’admettent, mon corps ne peut absolument pas concevoir le désir du même ! Grégoire homosexuel, soit, c’est notre Grégoire, il fait bien ce qu’il veut, la question de ses préférences ne se pose pas, mais le corps de Grégoire se satisfaisant d’un corps d’homme, voilà ce que l’esprit de mon propre corps, si je puis dire, ne peut pas concevoir. Ce n’est pas la sodomie, non. Mona et moi ne l’avons pas boudée, nos feuilles de rose nous ravissaient, et quel joli garçon elle faisait alors ! Mais justement, elle n’était pas un garçon. Je songe, en m’endormant, à l’homosexualité de Grégoire… Ou plutôt je cesse d’y songer, l’énigme s’effiloche, devient la matière même du sommeil qui m’absorbe.
72 ans, 9 mois, 12 jours
Lundi 22 juillet 1996
Seul au jardin, je lève les yeux de ma lecture, distrait par le chant d’un oiseau que je regrette de ne pouvoir identifier. Ce constat vaut pour presque toutes les fleurs qui m’entourent et dont j’ignore le nom, pour quelques arbres aussi, pour la plupart des nuages et pour les éléments qui composent cette motte de terre que mes doigts émiettent. De tout cela, je ne peux rien nommer. Les travaux de ferme de mon adolescence ne m’ont presque rien appris sur la nature. Il est vrai qu’ils n’étaient destinés qu’à me muscler. Le peu que j’ai su, je l’ai oublié. Bref, me voilà civilisé au point de n’avoir aucune connaissance élémentaire ! L’oiseau qui m’a tiré de ma lecture chante dans le silence de cette ignorance. D’ailleurs, ce n’est pas tant son chant que j’écoute que le silence lui-même. Un silence absolu. Et tout à coup, cette question : Où est passé mon acouphène ? J’écoute plus attentivement. C’est bien ce qui me semblait : pas d’acouphène, juste l’oiseau. Je me bouche les oreilles pour écouter l’intérieur de mon crâne. Rien. L’acouphène a bel et bien disparu. Ma tête est vide, elle bourdonne un peu sous la pression de mes doigts, comme un tonneau contre lequel j’aurais collé l’oreille. Absolument vide, le tonneau. Vide de son, ce dont je me réjouis, et de toute connaissance élémentaire, ce qui me navre. Je reprends ma lecture savante pour me vider davantage.
72 ans, 9 mois, 13 jours
Mardi 23 juillet 1996
L’acouphène est revenu, bien sûr. Quand ? Je n’en sais rien. Cette nuit, il était là, tout sifflant dans mon insomnie. J’en suis presque rassuré. Ces petits maux, qui nous terrorisent tant à leur apparition, deviennent plus que des compagnons de route, ils nous deviennent. Naguère, c’était par eux que la vie de village vous désignait très naturellement : le goitreux, le bossu, le chauve, le bègue. Et dans les classes de mon enfance les élèves entre eux : le gros, le bigleux, le sourdingue, le boiteux… De ces tares, considérées comme de simples données, le Moyen Âge a fait des noms de famille. Les Courtecuisse, Legras, Petitpierre, Grosjean et autres Leborgne courent encore les rues de nos jours. Je me demande quel sobriquet m’aurait infligé cette rude sagesse médiévale. Lesiffleur ? Dusifflet ? Le père Dusifflet ? Va pour le père Dusifflet. Vous savez, celui qui a un sifflet dans la tête ! Accepte-toi pour ce que tu es, Dusifflet, et fais de ton nom une gloire.
Читать дальше