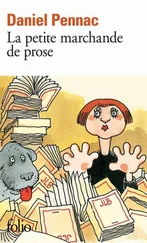68 ans, 3 mois, 26 jours
Mercredi 5 février 1992
Cheville douloureuse. Consultation d’un rhumatologue, qui me dirige vers une podologue, laquelle affirme, après avoir examiné mes pieds : Bien entendu, vous ne savez pas danser. Je confirme. Rien d’étonnant à cela, la plante de votre pied droit repose sur trois points seulement (qu’elle désigne) au lieu de reposer sur toute sa surface. Et voilà réduite à une banale cause mécanique une inaptitude à la danse que j’ai toujours attribuée à mon manque d’incarnation. Je m’entends expliquer à la podologue que pourtant, dans ma jeunesse, je faisais de la boxe, je jouais au tennis, et que j’excellais au ballon prisonnier ! Le ridicule de cette phrase fait en moi un tel tintamarre que je n’entends pas la réponse, probablement technique, de la podologue. Moi et mon ballon prisonnier ! (Ô Violaine !) Pourquoi diable — à soixante-huit ans ! — tenir encore à passer pour un as du ballon prisonnier —, jeu dont tout le monde a probablement oublié l’existence ? J’y réfléchis à tête reposée et je me revois, dans la cour de récréation, jouant à ce jeu si rapide, aux règles si brutales : esquiver, intercepter, ruser, tirer, rester seul sur le terrain, décimer néanmoins l’équipe adverse, subir le feu des deux côtés à la fois, tellement agile, tellement combatif, increvable, ah ! cette joie purement physique ! Cette exultation ! Chaque partie de ballon prisonnier m’était une nouvelle naissance. C’est cette naissance à moi-même que je célèbre quand je me vante d’avoir été un as du ballon prisonnier !
68 ans, 7 mois, 20 jours
Samedi 30 mai 1992
Surpris Grégoire en plein délit de masturbation, lui l’arme du crime à la main, moi la poignée de la porte. Horriblement gênés tous deux. Il n’y avait pas de quoi ; comme dit l’autre, tout désir que la main n’étreint pas n’est qu’un songe. Un pénible sentiment d’intrusion m’a tracassé toute la journée. Je suis resté coincé dans une tête de préadolescent, cet être informe qui s’extirpe de l’enfance en se tirant par la queue. Ce soir, j’ai mis le grenier sens dessus dessous jusqu’à retrouver le Jeu de l’oie du dépucelage qu’Étienne et moi avions créé au pensionnat. J’ai provoqué Grégoire en duel. Il m’a battu à plate couture. Comme il atteignait la case 12 ( En tombant par hasard sur votre linge sale, votre oncle Georges vous félicite : vous êtes devenu un homme ), il m’a gratifié d’un sourire largement reconnaissant. Je lui ai offert le jeu.
68 ans, 8 mois, 5 jours
Lundi 15 juin 1992
Promenade solitaire, hier, au Luxembourg. Une femme, jeune encore, crie joyeusement mon nom, demande des nouvelles de Mona, m’embrasse et passe son chemin. Qui était-ce ? Le soir, à la sortie du Vieux-Colombier, deux ou trois mots déterminants me manquent dans la joute critique qui nous oppose T.H. et moi. Cherchant la voiture dans le parking Saint-Sulpice, je me trompe d’étage, remonte, redescends, tourne en rond… Où ai-je donc la tête ? Je m’étonne de n’avoir pas écrit davantage sur ces oublis qui ont empoisonné ma vie. J’ai dû me dire qu’ils relevaient de la psychologie. Idiotie ! Le phénomène est tout ce qu’il y a de physique. C’est d’électricité qu’il s’agit ici, mauvais contacts dans les circuits mentaux. Quelques synapses qui ne font pas leur office de transmetteurs entre les neurones concernés. La route est coupée, le pont s’est effondré, il faut se taper un détour de vingt-cinq kilomètres pour retrouver le souvenir égaré. Si ce n’est pas physique , cela !
68 ans, 8 mois, 6 jours
Mardi 16 juin 1992
J’aurais dû tenir le journal de mes oublis.
68 ans, 10 mois, 1 jour
Mardi 11 août 1992
Fanny, qui vient d’avoir onze ans et qui a, plus que Marguerite, le sens de l’ennui, me demande si le temps passe pour moi aussi lentement que pour elle. Pour le moment, sept fois plus vite, lui dis-je, mais ça change tout le temps. Elle m’objecte que, « du point de vue de la pendule » ( sic ), c’est pourtant le même temps qui s’égrène pour elle et pour moi. C’est vrai, dis-je, mais ni toi ni moi ne sommes cette pendule, laquelle, à mon avis, n’a aucun point de vue sur quoi que ce soit. Et de lui faire un petit cours sur le temps subjectif où elle apprend que notre perception de la durée est rigoureusement fonction du temps qui s’est écoulé depuis notre naissance. Elle me demande alors si chaque minute passe pour moi huit fois plus vite que pour elle. (Aïe, ça se complique.) Non, dis-je, si je les passe chez le dentiste pendant que tu joues avec Marguerite, certaines minutes me paraîtront même beaucoup plus longues qu’à toi. Long silence. J’entends les rouages de sa petite tête chercher à concilier les notions de contingence et de totalité, et je constate qu’entre ses deux yeux le pli de la réflexion lui fait la même expression qu’à Lison au même âge. Finalement, elle me fait la proposition suivante : Regarder ensemble la grande aiguille de la pendule, « pour obliger le temps à passer à la même vitesse pour toi et pour moi ». Ce que nous faisons, en donnant à cette minute commune le silence et la solennité d’une commémoration. Et c’en est une, car cette conversation à voix basse me renvoie aux cours de « petite philosophie » que me chuchotait mon père, il y a soixante ans (autant dire hier), dans le tic-tac de cette même pendule. La minute écoulée, Fanny pose un baiser sur ma joue en concluant, avant de filer : Grand-père, j’aime quand je m’ennuie avec toi.
69 ans
Samedi 10 octobre 1992
Dîner en petit comité pour mon anniversaire. « Mon anniversaire » est une expression enfantine que nous traînons jusqu’à notre dernière bougie.
69 ans, 9 mois, 13 jours
Vendredi 23 juillet 1993
J’avais oublié que Montaigne n’avait pas de mémoire :
C’est un outil de merveilleux service que la mémoire… Elle me manque du tout. (…) Et quand j’ai un propos de conséquence à tenir, s’il est de longue haleine, je suis réduit à cette misérable nécessité d’apprendre par cœur mot à mot ce que j’ai à dire ; autrement je n’aurais ni façon ni assurance étant en crainte que ma mémoire vînt à me faire un mauvais tour. Mais ce moyen m’est non moins difficile. Pour apprendre trois vers il me faut trois heures. (…) Plus je m’en défie plus elle se trouble ; elle me sert mieux par rencontre, il faut que je la sollicite nonchalamment : car si je la presse, elle s’étonne ; et après qu’elle a commencé à chanceler, plus je la sonde plus elle s’empêtre et embarrasse ; elle me sert à son heure, non pas à la mienne… Si je m’enhardis, en parlant, à me détourner tant soit peu de mon fil, je ne faux jamais de le perdre. (…) Les gens qui me servent il faut que je les appelle par les noms de leurs charges ou de leur pays, car il m’est très malaisé de retenir des noms. (…) Et si je durais à vivre longtemps, je ne crois pas que je n’oubliasse mon nom propre. (…) Il m’est advenu plus d’une fois d’oublier le mot du guet que j’avais trois heures auparavant donné ou reçu d’un autre, et d’oublier où j’avais caché ma bourse. Je m’aide à perdre ce que je serre particulièrement. (…) Je feuillette les livres, je ne les étudie pas : ce qui m’en demeure c’est chose que je ne reconnais plus être d’autrui ; c’est cela seulement de quoi mon jugement a fait son profit, les discours et les imaginations de quoi il s’est imbu, l’auteur, le lieu, les mots et autres circonstances, je les oublie incontinent. Essais, livre II, chapitre 17
Читать дальше