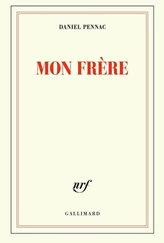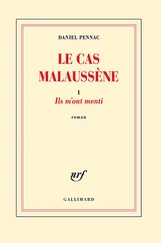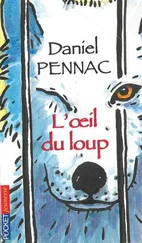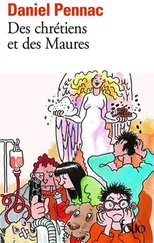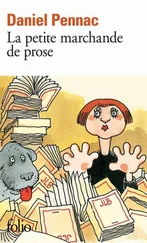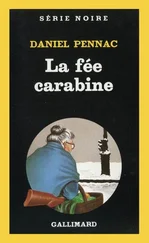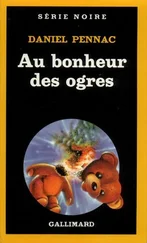Cité par le même (Térence, l’Eunuque ; I, 2, 25) :
Je suis plein de trous, je fuis de partout.
70 ans, 5 mois, 2 jours
Samedi 12 mars 1994
Hier chez A. et C., cette question de savoir si le cancer de W. ne serait pas d’origine psychosomatique. Approbation unanime. Oui, oui, bien sûr, il a mal supporté sa retraite, la maladie de sa femme, le divorce de sa fille, etc., tout le monde était d’accord jusqu’au moment où le jeune P., fils aîné de nos hôtes, a jeté un froid en concluant que « W. sera vachement rassuré d’apprendre qu’il meurt d’une maladie psychosomatique. C’est quand même moins dégueulasse qu’un cancer du côlon ! ». Sur quoi, le jeune P. fiche le camp en claquant la porte.
Je crois comprendre la rogne de ce garçon. Sans contester le fait que notre corps exprime à sa façon ce que nous n’arrivons pas à formuler — qu’un lumbago signifie que j’en ai plein le dos, que les coliques de Fanny disent sa terreur des mathématiques —, je vois bien ce que le tout-psychosomatique peut avoir d’agaçant pour la génération du jeune P. Il stigmatise la même pudibonderie qui me révoltait à son âge. Dans ma jeunesse, le corps n’existait tout simplement pas comme sujet de conversation ; il n’était pas admis à table. Aujourd’hui on l’y tolère, à condition qu’il ne parle que de son âme ! En filigrane du tout-psychosomatique flotte cette vieille lune : les maux du corps comme expression des tares du caractère. La vésicule foireuse du colérique, les coronaires explosives de l’intempérant, l’Alzheimer inévitable du misanthrope… Non seulement malades, mais coupables de l’être ! De quoi meurs-tu, bonhomme ? Du mal que tu t’es fait, de tes petits arrangements avec le néfaste, des bénéfices momentanés que tu as tirés de pratiques malsaines, de ton caractère, en somme, si peu tenu, si peu respectueux de toi-même ! C’est ton surmoi qui te tue. (Rien de neuf, en somme, depuis que la petite vérole donnait à lire l’âme de la Merteuil sur son visage ravagé.) Tu meurs, coupable d’avoir pollué la planète, mangé n’importe quoi, subi l’époque sans la changer, fermé les yeux sur la question de la santé universelle au point de négliger ta propre santé ! Tout ce système que ta paresse a mollement couvert s’est acharné sur ton corps innocent, et le tue.
Car si le tout-psychosomatique désigne le coupable, c’est pour mieux célébrer l’innocent. Notre corps est innocent, messieurs et mesdames, notre corps est l’innocence même, voilà ce que clame le tout-psychosomatique ! Si seulement nous étions gentils, si nous nous conduisions bien , si nous menions une vie saine dans un environnement maîtrisé ce n’est pas notre âme seule, c’est notre corps lui-même qui accéderait à l’immortalité !
Longue diatribe que je débite dans la voiture sur le chemin du retour avec la fougue de ma jeunesse retrouvée.
Peut-être, conclut Mona, mais ne pas négliger le fait que le jeune P. ne rate pas une occasion de faire passer ses parents pour des cons.
70 ans, 5 mois, 3 jours
Dimanche 13 mars 1994
Mesdames et messieurs, nous mourons parce que nous avons un corps, et c’est chaque fois l’extinction d’une culture.
70 ans, 8 mois, 5 jours
Mercredi 15 juin 1994
Nous nous connaissons, me dit le vieux professeur de philosophie de Grégoire lors de la réunion de parents où je suis allé glaner la couronne de louanges qu’on tresse à mon petit-fils. Vraiment ? Oui, je vous ai torturé dans votre jeunesse, explique-t-il avec un sourire amical. Et je le reconnais : c’est le neveu du docteur Bêk ! Celui dont l’énorme main, il y a quarante ans, étouffait mes hurlements quand l’oncle arrachait mon polype. Depuis le début de l’année Grégoire ne tarit pas d’éloges sur ce professeur de philosophie « absolument génial ! ». Le fait que ce soit un colosse sénégalais n’entre pas dans les éléments de sa description, détail sans signification philosophique. Monsieur F. tapote l’aile de son nez : On endort, aujourd’hui, pour ce genre d’opération, mais elles sont toujours aussi inefficaces. Votre petit-fils aussi parle un peu du nez, ce qui ne l’empêche pas d’être un excellent philosophe.
71 ans, 5 mois, 22 jours
Samedi 1 eravril 1995
Retour de l’hôpital où nous sommes allés voir Sylvie, Grégoire et moi. Elle nous reconnaît, mais sans accommoder , semble-t-il. « Grégoire », dit-elle doucement, et cela manque de réalité. C’est son fils, elle le sait, c’est le prénom de son fils, elle s’en souvient, il y a de la tendresse dans sa voix, mais l’image et le prénom ne l’atteignent pas, ne se superposent pas. Comme si elle voyait flou, commente Grégoire, qui ajoute : D’ailleurs elle-même est floue, on dirait qu’elle marche juste à côté de son corps, tu ne trouves pas, grand-père ? Au début de la maladie de Sylvie, quand il m’en donnait des nouvelles, Grégoire disait déjà : Maman n’est pas tout à fait « nette », ou alors, ça va aujourd’hui, maman est « nette ». Je le vois esquisser un sourire quand, nous accueillant dans son bureau, le docteur W. annonce que nous allons « faire le point ».
71 ans, 5 mois, 25 jours
Mardi 4 avril 1995
En pensant à Sylvie, cette nuit (elle devrait sortir dans un mois), me revient ce mot, « désaxé », que maman utilisait pour se plaindre de moi. Le mot produisait une impression de vertige et de flou. Au fond, ce journal aura été un perpétuel exercice d’accommodation. Échapper au flou, maintenir le corps et l’esprit dans le même axe… J’ai passé ma vie à « faire le point ».
71 ans, 8 mois, 4 jours
Mercredi 14 juin 1995
Intrusion massive du corps commun dans l’autobus 91, à la station des Gobelins. Quand j’y monte, gare Montparnasse, le bus est vide. Je profite de cette solitude inespérée pour m’abîmer dans une lecture que perturbent à peine les passagers qui, de station en station, s’asseyent autour de moi. À Vavin, toutes les places assises sont occupées. Aux Gobelins, le couloir est bondé. Je le constate avec l’innocent égoïsme de celui qui, ayant trouvé un siège, jouit d’autant mieux de sa lecture. Un jeune homme, assis en face de moi, est lui aussi plongé dans un livre. Étudiant, sans doute. Il lit Mars de Fritz Zorn. Debout dans le couloir, à côté de l’étudiant, une femme forte, la soixantaine essoufflée, un cabas bourré de légumes à la main, respire bruyamment. L’étudiant lève les yeux, croise mon regard, voit la dame et, spontanément, se lève pour lui céder sa place. Asseyez-vous, madame. Il y a quelque chose de germanique dans la politesse du jeune homme. Droit, grand, la nuque raide, le sourire discret, un garçon distingué. La dame ne bouge pas. Il me semble même qu’elle fusille l’étudiant du regard. Désignant le siège de la main, le jeune homme insiste. Je vous en prie, madame. La dame cède, de mauvais gré me semble-t-il. En tout cas sans remercier. Elle s’introduit devant le siège vacant, toujours soufflant, mais ne s’assied pas. Elle se tient face à moi, son cabas à la main, mais reste debout devant le siège vide. Le jeune homme casse sa nuque pour insister encore. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Ici, la dame prend la parole. Pas tout de suite, dit-elle d’une voix claironnante, j’aime pas quand c’est trop chaud ! Le jeune homme rougit violemment. La phrase est à ce point stupéfiante qu’elle m’empêche de replonger dans ma lecture. Un bref regard latéral me donne à voir la réaction des autres passagers. On étouffe un petit rire, on fixe ses pieds, on regarde ostensiblement dehors, bref on est gêné. C’est alors que la dame se penche vers moi, et qu’elle me dit, son visage à quelques centimètres du mien, comme si nous étions de vieilles connaissances : J’attends que ça refroidisse ! Du coup, c’est moi qu’on regarde. On attend ma réaction. L’idée me vient alors qu’à cette seconde précise nous ne formons tous qu’un seul corps dans l’autobus 91. Le même corps éduqué . Un corps unique dont les fesses ne supportent pas la chaleur des sièges couvés par d’autres fesses, mais qui préférerait se jeter sous les roues de l’autobus plutôt que de l’avouer publiquement.
Читать дальше