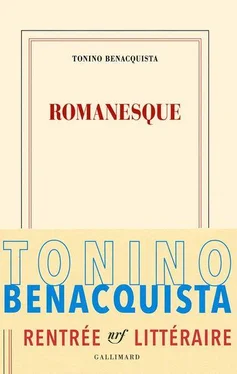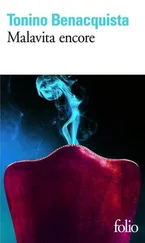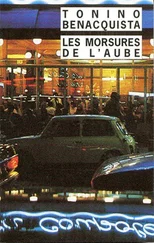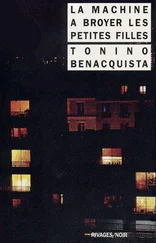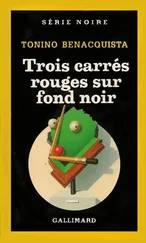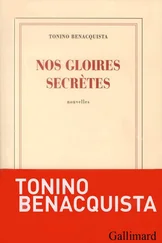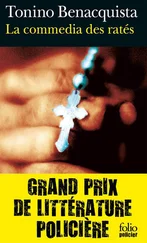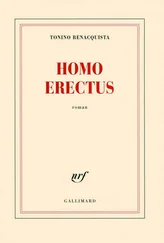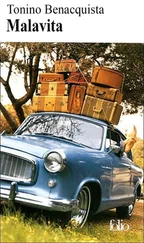Rassuré sur ce point, il ne peut résister à la tentation de consulter les #runninglovers tombés dans la nuit. Il y trouve pêle-mêle des messages d’encouragement qui témoignent de la cote de popularité des amants en cavale, et d’autres plus cyniques où l’on calcule leurs chances, très réduites, de s’en tirer. Il repère le tweet d’un étudiant en lettres classiques qui réagit à l’incident du Chicago Theatre, ayant consacré sa thèse de doctorat aux Mariés malgré eux . Elle est consultable sur le site de l’Université de Durham : Le repentir de Charles Knight. Essai de génétique théâtrale . C’est l’occasion pour le doctorant de donner à lire son travail hors des sphères universitaires. Et pour Mr Green de retrouver une vieille connaissance.
Dès son introduction, le jeune chercheur avoue s’être lancé dans une enquête passionnante mais sans réelle résolution. Seuls les rares spécialistes de l’œuvre de Charles Knight savent qu’il existe une version antérieure de la pièce, créée un an avant celle que l’on joue désormais. Si les événements décrits varient peu d’une version à l’autre, le style, la matière, la profondeur, les psychologies et les enchaînements en sont métamorphosés. À partir d’un matériau brut, d’inspiration bouffonne, Charles Knight avait poli un petit joyau de comédie dramatique, si bien qu’avec le temps cette seconde version des Mariés malgré eux était devenue un cas d’école emblématique du droit, de la nécessité, et du devoir de repentir d’un auteur sur son œuvre.
Que s’était-il passé dans la vie de Charles Knight pour qu’il décide de transfigurer sa pièce ? L’étudiant émet l’hypothèse, selon lui la plus probable, de la rencontre amoureuse, assez puissante pour bouleverser ses certitudes, le débarrasser des stéréotypes et raviver son inspiration. Embrasé par la passion il avait enfin su la décrire ! L’amour lui avait donné un talent que la rupture lui avait par la suite repris, car plus jamais il ne retrouverait une telle fougue et une telle inventivité dans son écriture.
Hélas, après avoir passé au crible la correspondance de l’auteur, examiné les registres de sa pension, recoupé toutes les publications sur la vie littéraire de l’époque, feuilleté les carnets mondains des gazettes, lu les Mémoires du directeur du Pearl Theatre, le malheureux chercheur ne parvient pas à démontrer la thèse du coup de foudre et se limite à une étude comparée des deux versions sans expliquer de façon formelle ce revirement.
Mr Green imagine l’agacement de l’étudiant après des années de dévouement à Charles Knight, qui trois cents ans après sa mort savait encore exercer son seul vrai talent, celui d’exaspérer. Ô ingratitude de l’auteur envers ses exégètes futurs ! Rien, pas une seule piste, pas la moindre note en coin de manuscrit, pas le plus petit billet. Le dramaturge n’avait pas eu la décence de présenter sa muse à quiconque, privant ainsi des générations de spectateurs d’un éclairage capital, et un vaillant doctorant d’une découverte majeure qui aurait permis à son Essai de génétique théâtrale de dépasser le simple objet d’étude. Il aurait alors entrepris une œuvre d’une autre envergure, rien de moins qu’un essai sur la pâmoison littéraire.
Un comble en effet pour qui avait connu en personne Charles Knight, drapé dans sa posture d’écrivain, ému par ses propres vers, riant à ses propres répliques ! Lui qui extériorisait tout, ses agacements comme ses exaltations, avait su taire l’existence de son coauteur dans le seul but de se réserver l’absolue paternité de l’œuvre.
Mr Green se souvient de leurs prises de bec sur certains passages, notamment celui où les médecins s’efforcent de voir les jeunes mariés comme de grands malades — l’un d’eux avait proposé pour de bon de les dépecer et, si à l’époque on avait utilisé des écorchés en cours d’anatomie, les amants auraient sans doute fini sur une petite potence au fond d’une classe. Knight avait refusé d’y croire et plus encore de s’en servir à des fins de comédie. Mais le Français reconnaît aujourd’hui que l’irascible auteur avait souvent eu raison de lui tenir tête, la preuve en était cette représentation au Chicago Theatre qui continuait à faire parler d’elle.
Ah, si Charles Knight avait été présent, comme à l’époque où il se cachait dans les coulisses les soirs de générale ! Lui qui redoutait la pingrerie du directeur du Pearl, lui qui avait été joué dans des basses-cours par des troupes calamiteuses, n’en aurait pas cru ses yeux devant tous ces figurants en redingotes, ces baladins, ces mandolines et ces pipeaux, ces notables cousus d’or, ce chapelet de prélats, cette horde de gueux. Ce soir-là, il aurait assisté à un triomphe qui valait cent rappels. Ce soir-là, il avait offert à chaque spectateur une heure d’héroïsme.
À la demande des voyageurs, le chauffeur du car se gare sur une aire de stationnement. Mr Green referme son ordinateur, tout surpris par ce regain de nostalgie à l’évocation de l’ombrageux Charles Knight. Le vaillant étudiant de Durham ne saura jamais que la clé du mystère de son repentir réside non dans la rencontre amoureuse mais, au contraire, dans une détestation partagée, si féconde au final.
Mr Green sort faire quelques pas au bord du lac Champlain dont il ne peut distinguer les contours de par son immensité. Un faux air d’océan que vient accentuer le passage d’une goélette toutes voiles gonflées.
*
Au lieu de l’apaiser, la proximité du lac inquiète le petit Nathan, qui a horreur du vide. Pour le tirer de son mutisme, sa mère lui demande de décrire sa chambre à Mrs Green. Là où d’autres gosses commenceraient par le papier-peint ou les jouets, il se lance dans une lente énumération du contenu de chaque tiroir de chaque meuble, mur après mur. Sa maniaquerie le rassure et le met en joie. Mrs Green s’intéresse, pose des questions, mais son attention décroche quand Nathan l’invite à le suivre dans le débarras, dont les rayonnages sont nombreux et chargés de boîtes de couleurs différentes selon l’usage. À la dérobée elle garde un œil sur son écran où vient de s’afficher un nouveau #runninglovers .
Dans un site de libre parole, de débats d’idées et de polémiques, un philosophe de quatre-vingt-six ans, qui se déclare volontiers misanthrope et s’autoproclame dernier anarchiste en vie , reconnaît que l’affaire des Français hors-la-loi a gaiement réveillé son sens de la révolte. La traque de ces deux-là importe peu, moins encore son issue, seul compte le symbole dont ils sont les involontaires porteurs. Car cet homme et cette femme activement recherchés ont échappé à toute classification administrative ; jamais on ne les a nommés, baptisés, déclarés, répertoriés, affiliés, recensés, incorporés, mobilisés, assujettis, convoqués, réquisitionnés, ou encartés. Dès lors, le terme de marginaux paraît bien faible pour qui se contente de les définir ainsi.
Tout individu ayant rêvé d’être un homme de nulle part découvre ici un précédent. S’il a perdu le sens de l’utopie, s’il se sait condamné à cette civilisation qui ne fera plus machine arrière, s’il se désole du désarroi général sans rien pouvoir y changer, il lui arrive parfois de s’imaginer faire bande à part et renier tout projet collectif.
N’obéir à aucun code. Être invisible. Ne prétendre à rien. N’avoir aucun compte à rendre. Nier le sens commun. Prouver en disparaissant que rien de ce que propose l’évolution n’a d’intérêt. Échapper à l’universel. Déclarer en le fuyant que ce modèle mis au point par des centaines de générations d’hommes de bonne volonté est un monstrueux ratage. Refuser de contribuer à ce gâchis. Remettre en cause tout message de partage et d’avenir. Se proclamer orphelin de la grande famille humaine. Décréter vaine toute loi et s’interdire d’en inventer de nouvelles. Mépriser le sens commun. Et dire à ceux qui s’avisent de gouverner tout ce beau monde que tout ce beau monde ne les croit plus.
Читать дальше