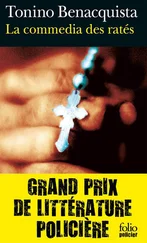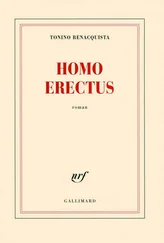TONINO BENACQUISTA
ROMANESQUE
À la mémoire d’Elena et de Iolanda
Jadis ces amants-là, après une nuit vagabonde, jetaient un dernier regard sur le monde encore assoupi, comme s’ils en avaient la charge. La nature leur semblait en ordre. La faune se sentait chez elle. Le jour pouvait se lever.
Aujourd’hui ils guettent la tombée de la nuit à travers les rideaux et s’inquiètent des bruits alentour. Ils se fichent bien de l’état du monde et de son devenir, seul le leur les préoccupe.
Ils quittent alors le lit pour oser quelques pas sur la coursive du motel. L’un s’installe sous le porche, l’autre près du distributeur de glaçons, car côte à côte ils prendraient un trop grand risque. En alternance ils se hasardent en ville — Bakersfield, Californie — pour y acheter de quoi se nourrir. Ils en reviennent épuisés à force d’étudier chaque regard croisé de peur d’être reconnus. La nuit venue, ils résistent à l’envie de se glisser dans la piscine enfin désertée. Quand l’un dort, l’autre surveille les informations sur les chaînes de télévision. Hier, au journal de 6 heures, le propriétaire du restaurant français « Monsieur Pierre » les a décrits comme des employés modèles, peu liants mais incapables de violence.
Aujourd’hui, pas de témoins, pas de photos anthropométriques fournies par les services français, pas de compte rendu sur les avancées de l’enquête. Il serait vain de s’en réjouir ; si l’actualité se lasse vite, la loi et ses serviteurs ne lâcheront jamais, ils sont puissants, opiniâtres, prêts à déployer un dispositif d’envergure. Comment espérer leur échapper à bord d’une épave qui bientôt va reprendre la route, mais pas celle prévue.
Leur seule destination désormais est une maison vert émeraude au toit rouge, sur une rive du Saint-Laurent, au Québec, à ce point de l’estuaire où l’été passent les baleines. S’ils parviennent à l’atteindre, alors ils retrouveront les gestes primitifs, se réchauffer à même le feu, puiser l’eau. Une fois pris dans les glaces, ils hiberneront comme deux ours lovés l’un contre l’autre en attendant le printemps et ses impatiences.
*
Ils traversent des plaines de sable blanc, empruntent les corridors de palmiers et les boulevards électriques de Las Vegas, franchissent des massifs ocre, longent les palaces écaillés et les dédales métalliques de Denver. À Chicago, leur Ford Capri, qui a besoin de repos et d’eau, les lâche sur une voie express qui borde le lac Michigan. Ils la poussent jusqu’aux abords d’un parc.
Installés sur un banc, ils consultent les réseaux sociaux au cas où il serait question d’eux. Ils maudissent cette époque et sa belle technologie. À l’approche d’un promeneur ils cessent de parler français. À tour de rôle ils s’assoupissent, gagnés par le silence du lac. Lui se demande quel est ce drôle d’oiseau qui vient de se poser sur un rocher, comme issu d’une macreuse et d’un grèbe cornu. Elle repère des baies de sureau, sorties hors saison, et se retient d’en cueillir quelques-unes. Quand soudain l’un d’eux aperçoit au loin une gigantesque affiche de théâtre suspendue très en hauteur sur le toit d’une tour. On donne ce soir en ville un classique anglais, Les mariés malgré eux , qui termine ici sa tournée triomphale. En photo, les deux comédiens principaux vêtus dans des costumes d’époque : des époux en guenilles.
Les fuyards parviennent à se convaincre de ne pas céder à la tentation. Après un sans-faute depuis la Californie, ce serait une folie. Pour l’instant ils ont une longueur d’avance, ils sont invisibles. À ce rythme, dans moins de quinze heures ils seront au Canada. Pas question de commettre un faux pas si près du but.
Au guichet du Chicago Theatre on affiche complet, rien à l’orchestre, rien au balcon, ne reste qu’une loge d’avant-scène, parmi les plus chères, des places de notables. Ils comptent leurs derniers sous. Vraiment pas raisonnable. Mais à quel pouvoir la raison saurait-elle prétendre devant cette affiche : l’étreinte d’un vilain et d’une manante, si mal attifés, si faibles, si rayonnants.
Après tout, la ligne de frontière ne bougera pas d’ici leur passage, la neige ne fondra plus avant le printemps, les baleines patienteront jusqu’à leur arrivée avant de glisser sur le Saint-Laurent. Leur disparition peut attendre encore deux heures.
*
Dans le programme, une présentation sommaire de la pièce de Charles Knight, créée à Londres en 1721. Elle emprunte à une légende inspirée de faits réels : Au Moyen Âge, en France, deux gueux pris de passion, incapables de se soumettre aux lois de la communauté, tiennent tête aux sages, aux prêtres, au roi lui-même. Sont-ils voués à l’Enfer ou bien au Paradis ?
La scène, toute de lumière blanche, et le public dans la pénombre. Le réel vacille lentement vers un autre temps, celui du conte, où tout peut advenir, où tout est accepté, même l’extravagant, surtout l’extravagant, on y vient pour ça, le réel attend dehors, tapi, interdit d’entrée, les spectateurs en sont hors d’atteinte. Nous sommes dix siècles en arrière, dans une forêt. Une femme apparaît, un corsage, une longue jupe, des sandales, une coiffe, un panier, elle cueille des baies, savoure la caresse du soleil. Arrive un homme en tunique et gilet lacé, pantalon brun, hauts-de-chausses, il relève un collet, un lièvre pend à sa ceinture. Dans un instant ils vont poser les yeux l’un sur l’autre.
Dans leur loge à l’aplomb de la scène, les deux Français goûtent à cette imminence, prient pour qu’elle dure. Pour un peu ils mettraient en garde les deux innocents sur scène : Vous allez embraser la Terre et le Ciel ! Mais à quoi bon, les châtiments et les damnations ne leur feront jamais regretter cet instant-là. Une fois l’inévitable accompli, au mieux pourrait-on leur crier, comme aucun esprit éclairé à l’époque ne l’avait fait : Fuyez ensemble mais fuyez sur-le-champ, n’espérez rien de la civilisation, courez mais courez vite, ou elle vous rattrapera où que vous soyez .
Les comédiens jouent l’insouciance, prêts à la joute galante. Mais dans les faits réels , les manants dont il est question ici avaient froid et peur. Leurs vêtements partaient en lambeaux et, ce matin-là, une lumière sale d’arrière-saison annonçait le pire des hivers.
Régnait alors sur leur pays un homme en souffrance.
Louis le Vertueux était rongé par un mal dont personne ne connaissait le nom mais que tous redoutaient, aussi disait-on le mal, puis l’on se signait. Car la mort avait déjà pris ses quartiers dans le corps du malheureux, un corps ayant perdu son droit divin, redevenu humain, tout de chair fétide, de nerfs vrillés, que ne parvenaient à réchauffer ni les fourrures précieuses ni même d’autres corps blottis contre le sien. Les médecins, impuissants, craignaient pour leur propre vie au chevet de ce roi que la douleur avait rendu cruel. Chaque matin ils vérifiaient que son urine était jaune et non rouge, son sang rouge et non brun, puis ils se risquaient à un diagnostic si obscur que le mal lui-même semblait accommodant. À mots couverts ils désignaient les hommes d’Église prompts à évoquer les miracles des Saintes Écritures pour justifier leur sublime ministère, mais qui devant un roi mourant s’en remettaient au Très-Haut. Sa raison déclinant, le Vertueux devint le Fou, car la démence devenait la seule issue terrestre à sa terrible angoisse. Il lui arrivait de punir tout homme valide osant se présenter à lui, ou d’offrir à un rustre un quartier de noblesse contre sa bonne santé. Il refusait de concevoir comment ses ministres, une fois débarrassés de leur devoir de compassion, s’en retournaient souper en famille puis trouvaient le sommeil. Comment le peuple vaquait à son ouvrage au lieu de remplir les églises pour prier au rétablissement de son souverain. Comment son impatient dauphin se hasardait déjà à essayer trône et couronne. Les bien-portants étaient-ils donc des monstres ? Fallait-il qu’un roi agonise pour qu’un million de ses sujets se parent de l’indifférence des rois ?
Читать дальше