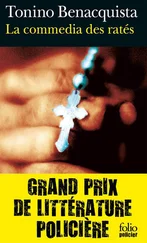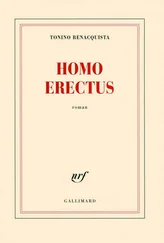L’intuition de la Séditieuse au sujet du Persécuté avait été la bonne : le pire voisin de chambrée hier encore, obsédé par les complots ourdis contre lui, avait acquis le don d’anticiper les mauvaises rencontres. Il décidait de l’itinéraire comme si la topographie des lieux n’avait pour lui aucun secret, sa nature soupçonneuse lui tenant lieu de boussole car, à force de déjouer les obstacles, même imaginaires, il ne pouvait plus en surgir. L’anxiété d’un seul rassurait les quatre autres comme une veilleuse dans la nuit.
L’ Affabulatrice avait un tout autre talent, fort précieux à l’approche d’une auberge ou d’un relais de poste. Quand il leur fallait rafraîchir l’attelage ou se procurer une miche de pain, on se tournait vers elle pour donner à leur équipage une indiscutable légitimité. Elle choisissait ses impostures en fonction des us et coutumes des régions traversées, et le discours qui s’ensuivait, riche de détails et de circonstances, était impossible à mettre en doute. Leur voiture devenait alors celle d’un consul en mission, d’un bey en villégiature ou d’un prince en exil. Avant d’en descendre, elle distribuait les rôles, ici un fondé de pouvoir chargé d’annoncer une guerre, ici un ambassadeur venu signer un traité de paix, ici un émissaire préparant l’arrivée de l’empereur de Chine. Et le malheureux tenancier mis en confiance, honoré de recevoir chez lui la raison d’État ou l’Histoire en marche, sortait ses meilleures victuailles, ses chevaux les plus vigoureux. Avant l’aube ses éminents visiteurs avaient quitté les lieux comme les voleurs qu’ils étaient, prêts à chevaucher tout le jour et à gruger d’autres naïfs.
Leur destination finale avait été choisie par l’ Imposteur . Issu d’une riche et puissante famille d’Italie, il leur avait promis à Florence un havre de réconfort qui leur ferait vite oublier leur audacieux périple. Du reste, quand l’ Affabulatrice lui faisait jouer le rôle d’un duc entouré de sa suite, il s’en acquittait avec un parfait naturel, et pour cause : c’en était un.
Le pavillon des agités de l’hôpital de Svilensk ne comptait plus les monarques, les généraux, les nababs, tout-puissants et richissimes, échoués là fort injustement selon leurs propres dires. Pour un seul d’entre eux, c’était la pure vérité. Sa famille avait donné jadis divers gouverneurs et quelques papes, avait régné sur tout le nord de l’Italie et formé sa propre armée, invincible deux siècles durant. Aujourd’hui, elle s’était éloignée des intrigues du pouvoir pour se consacrer aux arts, et réservait une partie de son incommensurable fortune au mécénat, un moyen bien plus sûr de marquer l’Histoire de son sceau.
La Séditieuse y trouvait son compte ; certes le passage par Florence occasionnait un détour, mais quitter l’équipée en cours de route aurait été un mauvais calcul. Se retrouver seule, vivre d’expédients, affronter chaque jour de nouveaux dangers, en avait-elle encore la force ? L’ Imposteur avait promis, une fois de retour dans sa seigneurie, de remercier ses complices pour leur fidélité, car les cinq évadés étaient désormais liés par une confiance comme seuls en connaissent les soldats au feu. À peine aurait-il revêtu son costume de duc que des courtisans viendraient lui proposer leur belle amitié, mais plus jamais il ne retrouverait la loyauté d’une poignée de fous en révolte. Aussi la Séditieuse accepta sa proposition de lui fournir un carrosse avec escorte afin de rentrer chez elle. En plus de la sécurité, du confort, de la célérité, elle vit dans cette opportunité une manière de revanche ; même si ses voisins d’alors, et les fils de leurs fils étaient morts depuis longtemps, elle s’offrirait un retour triomphant sur le lieu même de son bannissement.
*
Si les actes I et II de la nouvelle version des Mariés malgré eux leur avaient permis d’affiner leur collaboration en écriture, l’acte III les opposa de façon radicale. Charles Knight voyait dans ce passage chez le roi de France l’occasion de se confronter à une figure imposée de l’art dramatique où l’homme de peu affronte l’autorité absolue, représentée par un dieu, un monarque, un tyran. Comment résister à la tentation de tourner en dérision les maîtres, convaincus de leur omnipotence ? N’était-ce pas le rôle même de la fable que de subvertir les lois morales qui asservissaient les peuples, de bousculer les hiérarchies, d’inverser la logique des faibles et des forts ? Comment ne pas draper ce roi dans les oripeaux de la suffisance, tremper dans le fiel ses répliques infatuées ? Ce à quoi son contradicteur répondait : Non, monsieur l’auteur ! Devant le roi, les amants perdent toute morgue mais gagnent en compassion, personne ne rit devant un homme à l’agonie, même le bouffon, qui a soudain honte de sa bonne mine et de ses formes replètes . Au lieu de verser dans la satire attendue et d’acheter à bon compte la connivence du public, la vraie difficulté consistait à montrer que devant la mort le roi se révélait humain, tragiquement, prosaïquement, viscéralement humain. Knight rétorquait : comment éprouver une once de pitié pour celui qui vous condamne au gibet ? Un paradoxe que même les vers les plus subtils, les diatribes les mieux tournées ne sauraient faire admettre au spectateur.
Ce paradoxe en cachait un autre, bien plus intéressant selon le Français, car les amants maudits, condamnés eux aussi à une mort imminente, n’éprouvaient rien, ni terreur ni colère, sinon l’angoisse de se voir séparés, et c’était ce sentiment-là que le dramaturge devait traduire à tout prix, au lieu de se contenter d’une charge cynique contre le pouvoir. Charles Knight revoyait alors sa copie, parfois la nuit durant, pendant que son inspirateur s’endormait dans un fauteuil, épuisé par trop de joutes rhétoriques.
À son réveil il parcourait des volées de notes à l’encre encore fraîche et découvrait de nouvelles scènes, dont l’une rendait à Louis le Vertueux un peu de dignité, refusant qu’on répande la nouvelle de son mal afin d’épargner le peuple : I would they knew nought of my true affliction. Odd’s life ! The frailty of a king must be secret . Mais dès la scène suivante, en proie à des injonctions contradictoires, le roi perdait toute grandeur et sommait le peuple de verser plus de larmes que l’océan ne saurait en contenir.
Quand il cédait sur un point, le Français tenait ferme sur d’autres au nom de la vérité, qui selon lui donnait à l’œuvre toute sa légitimité. Le plus souvent Charles Knight s’en inspirait, exalté au point de craindre que sa main ne fût pas assez rapide pour saisir au vol tant de fulgurance ; mais parfois il renvoyait au visage de son coauteur son vécu et son ressenti , dont nul n’avait cure, car cette prétendue vérité allait provoquer ennui et indifférence si on ne la soumettait pas aux lois de la narration comme à la subtile alchimie des mots. De surcroît il fallait tenir compte du besoin d’anticiper de tout spectateur, qui lui aussi avait son propre vécu , son propre ressenti et, afin de le surprendre autant que l’émouvoir, tous les artifices du style étaient requis.
Et les empoignades reprenaient entre le garant du réel et le représentant de la forme, sans qu’aucun reconnaisse que l’essence même de l’œuvre et son juste équilibre se situaient à l’exact confluent de leurs deux convictions.
Pour parachever l’ouvrage, ils travaillaient sans discontinuer, car d’ici peu Lewis Knight rentrerait de mission. Le temps pour sa compagnie de lui affréter un nouveau navire, et il repartirait pour l’Orient. En général il revenait de ses voyages avec de quoi gâter son entourage ; à sa femme il offrait une pierre précieuse ; à ses enfants, un chat persan ou une perruche ; à ses amis des épices et de l’encens ; et à son frère Charles, auteur talentueux mais peu inspiré, il rapportait, quand l’occasion lui était donnée, une légende des contrées exotiques qui lui fournirait matière à quelque intrigue. Cette fois, pour agréer son écrivain de frère et lui permettre d’honorer un pacte, il prendrait à son bord un passager inattendu, en quête d’un trésor lointain.
Читать дальше