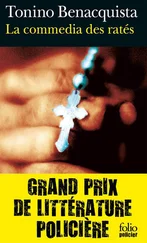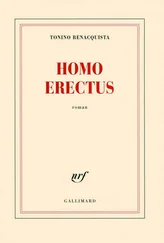Le praticien ignorait que chacun des aliénés avait su écouter l’histoire de la Française comme lui-même n’en avait pas été capable. Tous s’y étaient reconnus, qui à un détail, qui à une anecdote, tous avaient souffert du rejet de leurs voisins, tous avaient été déclarés dangereux pour les bonnes mœurs, tous avaient vu des médecins leur ausculter le crâne, tous avaient été bannis.
Retenant mal leur griserie, les insurgés se faufilèrent entre les bâtisses et se regroupèrent devant la grille principale. Les insomniaques du pavillon des pestiférés s’affichèrent à leurs fenêtres, sidérés de voir des frères pensionnaires s’aventurer hors les murs. S’engagea un émouvant dialogue où les uns, agrippés à leurs barreaux, suppliaient les autres de se rendre, et les autres invitaient les uns à les suivre dans un même élan libérateur. En se prétendant à l’abri, les malades passaient pour fous aux yeux des fous. En se disant pressés de déguerpir, les fous passaient pour des fous aux yeux des malades.
Alertés par les cris, les soldats du pavillon des réformés débarquèrent comme en mission de reconnaissance. Rétifs à toute idée d’insurrection, ils se demandaient quel camp rallier, celui des fous épris de liberté ou celui des malades accrochés à leur dernier refuge. Ils tentèrent de calmer tant de confusion mais leurs atermoiements ne firent que l’augmenter. Confrontée à de vrais militaires, la belle ordonnance des fous vola en éclats, et bientôt, aux portes de l’hôpital de Svilensk, on sombra dans un chaos où se mêlaient angoisse et espoir, couardise et bravoure, insoumission et autorité.
Abandonnant toute idée de solidarité, la Séditieuse cessa de s’inquiéter du sort de chacun pour se préoccuper du sien — à l’inverse des autres, elle avait un point à rallier et une longue route à parcourir. Soudain la glaneuse en elle réapparut, redonnant à la cueillette son véritable sens : le geste de choisir. Dans cette débâcle elle allait devoir s’entourer, parmi tous ces esprits égarés, de compagnons de voyage.
En premier elle se tourna vers l’ Imposteur qui proposa de se rabattre vers l’écurie, par-delà le bâtiment des soldats, où se trouvaient un fiacre d’hiver et quatre chevaux — de quoi s’envoler dans la steppe. Puis elle entraîna avec eux le Persécuté , le Versatile et l’ Affabulatrice dont les tocades pouvaient s’avérer précieuses en cours de route. L’ Imposteur prit les rênes, fouetta les bêtes, s’engagea à vive allure sur un chemin pavé menant à la grille enfin ouverte, où l’ensemble des agitateurs et des soldats avaient disparu.
La Séditieuse en tira une conclusion optimiste : à n’en pas douter, chacun avait agi selon sa propre conviction. Celui qui ressentait l’impérieux besoin de liberté en avait trouvé le chemin. Celui qui exigeait qu’on le laissât en paix avait regagné son lit. Et l’indécis, qui attendait un ordre assez autoritaire pour lui obéir, avait enfin entendu celui de son seul désir.
Elle ne garderait que ce souvenir-là de son bataillon de fous épris de révolution.
Le fiacre bifurqua vers la pleine nature dans le jour naissant. L’ Affabulatrice , accoudée à la fenêtre, goûtant l’air frais, ne trouva rien à ajouter, pas même un mensonge. Le Persécuté , pour la première fois depuis longtemps, ne vit dans cette soudaine compagnie que des alliés. Le Versatile semblait avoir laissé son versant obscur dans le pavillon des aliénés, et, du moins pour l’instant, seul rayonnait son versant solaire. Une route dégagée s’ouvrait devant eux. L’hôpital de Svilensk fut oublié à peine eut-il disparu du paysage.
*
À en juger par les applaudissements, Le bandit amoureux s’annonçait comme le succès de la saison. Charles Knight, qui rentrait calmement vers sa pension, s’en trouvait très agacé. Reconnaître le talent d’un confrère, nécessairement un concurrent, remettait en question le sien. C’était à lui, Charles Knight, de rappeler au public de Londres qu’il était le plus exigeant du monde. À lui de faire oublier ce vaudeville aux mœurs compassées, aux vers ennuyeux, aux rebondissements attendus. À lui d’imposer ses nobles intrigues et son verbe délicat. À lui de repousser les limites de la dramaturgie, de décrire des sentiments inconnus, de susciter des émotions nouvelles. À lui de s’inspirer du monde pour qu’un jour le monde s’inspire de son œuvre.
Hélas, il était loin du compte. Cette année-là les muses l’avaient toutes délaissé pour en visiter d’autres, et le feu que sa plume avait connu s’était éteint. Aux bravos avaient succédé de sourds quolibets dans le hall des théâtres : Knight, à sec ? Dans le regard du directeur du Pearl, il avait lu une perverse aménité : Mon ami, je vous garde une place pour septembre, dites-moi de quelle année . Jusqu’à sa logeuse, rosse et inculte, qui s’étonnait de ne plus trouver son nom dans le Daily Post , craignant ainsi pour ses prochains termes. Qui saura décrire l’odieuse solitude de l’auteur dramatique sinon l’auteur lui-même, se disait-il en traversant le quartier de Mayfair à l’heure où les tavernes se débarrassaient des derniers soiffards. Il ne se doutait pas que les affres de la création n’étaient rien en comparaison de la calamité qui l’attendait tapie dans la pénombre d’un coin de rue.
Un homme surgi avec la vivacité d’un tire-laine agrippa Knight par les revers et le fit rouler à terre en lui ordonnant de se taire au risque de sa vie.
Cet homme-là avait jadis été un être paisible, incapable de violence. S’il avait préféré le braconnage à la chasse, c’était pour laisser le sort décider de la mort de ses proies, et non son geste meurtrier.
Pourtant cet homme-là était prêt à casser la tête de Charles Knight si celui-ci persistait à ne pas révéler d’où il tenait l’argument de sa pièce.
L’auteur, effrayé par une brutalité bien plus prosaïque que celle dont il accablait ses personnages, crut avoir affaire à un détrousseur comme Londres en regorgeait. Sa peur vira à l’épouvante quand il reconnut le forcené du Pearl : deux shillings ne suffiraient pas à s’en débarrasser.
Il admit avoir fait passer Les mariés malgré eux pour une œuvre de pure fiction, une élégie inspirée de ses réflexions sur les destins contrariés. En fait, il s’était contenté de mettre en scène l’étonnant récit rapporté par son propre frère, Lewis Knight, employé à la Compagnie Britannique des Indes Orientales, au retour d’une de ses missions.
À l’occasion d’une halte en Chine, au comptoir de Guangzhou, pour y charger un plein navire de thé, son frère avait séjourné chez le récoltant, qui détenait à lui seul un territoire grand comme l’Angleterre, uniquement consacré à la culture de l’or vert. À la façon d’un Cicéron du bout du monde, le marchand conviait ses clients à la visite de ses terres afin de contribuer à sa réputation à travers les continents. Lewis Knight avait accepté, et à des fins toutes personnelles ; dépêché par son administration, il avait pour objectif de réunir toutes les informations nécessaires à la culture du thé afin d’en faire pousser sur le sol anglais car toutes les tentatives depuis plus de vingt ans avaient échoué. Dès lors, il avait posé mille questions à son hôte pour qu’il livre ses secrets de fabrication, il s’était renseigné sur les variétés capables de subsister en Europe, il avait assisté aux cueillettes, y prenant part lui-même, à la grande surprise des paysans, flattés qu’on reconnaisse leur savoir-faire. Il avait partagé le riz des saisonniers tout en écoutant les histoires qu’ils échangeaient lors des veillées, dont celle d’une femme, française, échouée là on ne sait comment, dotée d’une force de conviction irrésistible, qui avait dévoilé les épisodes intimes de son existence, sa rencontre avec l’homme le plus aimable de la Création, leurs innombrables bonheurs, leurs déboires constants.
Читать дальше