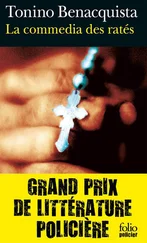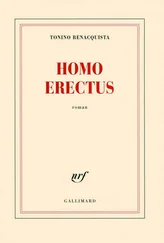Le feulement des chiens évoquait celui des fauves à l’approche de la viande et du sang ; les Cosaques retardèrent le moment de poser le pied à terre. L’un d’eux porta la main à son sabre, un autre donna un ordre, sans doute trop tard. Les chiens avaient planté leurs crocs dans la panse des chevaux qui hennirent de terreur et se cabrèrent à en faire chuter les cavaliers. Encore hébétés par la violence de l’attaque, ils agitèrent leur sabre sans savoir où frapper et affrontèrent à leur tour la rage des chiens. Leur maîtresse courait dans la rocaille, poursuivie par le chef hurlant des menaces de mort, laissant ses soldats se charger des deux pires adversaires croisés depuis longtemps. Un des hommes lâcha son sabre pour un poignard, mais il eut beau taillader les flancs d’un molosse, il eut la gorge arrachée, et il titubait maintenant, les mains sur le cou, tentant de contenir le sang qui giclait par gerbes. L’autre, la main broyée par la mâchoire du chow-chow, avait ramassé une pierre et la fracassait sur son crâne pour le faire lâcher prise ; il y parvint enfin mais fut mordu au bas-ventre et poussa un cri de supplicié. Au loin, la femme courait toujours, vite rattrapée par le soudard, qui la frappa au visage et la maintint prostrée dans la plus vulnérable des postures tout en défaisant la boucle de son ceinturon. Surgit alors une créature moribonde, le poil ruisselant de sang, lardée de coups de couteau, cherchant à délivrer sa maîtresse. À l’agonie lui-même, le chien trouva la force de mordre le monstre au visage, lui arracha une tempe, puis retourna vers la dépouille de son frère pour mourir à ses côtés.
Dans la steppe, cinq corps gisaient à terre. Deux d’entre eux avaient été des âmes nobles, capables de loyauté, poussés par une force qui les dépassait. Les trois autres étaient de simples animaux morts.
La femme tenta de panser ses plaies sans en avoir la force et erra dans la nature où déjà tombait la nuit. Elle redouta que son bras ne se fût fracturé dans la lutte. Toutes les peurs à la fois l’habitaient, celle de mourir de ses blessures, celle de ne pas finir le voyage, celle de ne pas retrouver le seul être qui eût valu la peine d’endurer tous ces tourments. À l’aube elle vit se découper les contours d’une bourgade, sans même savoir le nom du pays dont elle dépendait. Dans toutes les langues qu’elle connaissait, elle s’enquit d’un hôpital, un asile ou même un mouroir. Une villageoise, saisie par la vision de cette femme épuisée et blessée, sa tunique déchirée pour en faire des bandages, l’abandonna au pied d’une austère bâtisse sans attendre qu’une porte s’ouvre.
*
Un matin, l’éternel horizon de sable se teinta de bleu turquoise. Le vent brûlant céda à une brise du large, fraîche et iodée, qui ravivait le corps du voyageur mais aussi son esprit engourdi par une gangue de chaleur.
Une fois rendu dans la ville de Tanger, d’où l’on devinait au loin les contours de l’Espagne, il revendit sa monture pour se payer un passage jusqu’au rocher de Gibraltar, administré par les Britanniques.
Là, il retrouva des langues familières, des uniformes, des commerces et des usages oubliés durant les longs mois de son expédition saharienne. En s’approchant de la capitainerie des navires au long cours, il lia connaissance avec une poignée de gentilshommes officiant pour le compte de la Compagnie Française de Commerce et d’Échange. Ils s’étonnèrent qu’un Bédouin parle leur langue, mais ils s’étonnèrent plus encore quand celui-ci se déclara rescapé du Sainte-Grâce , parti des Amériques et dérouté par la tempête.
Le Sainte-Grâce ? Disparu corps et biens depuis presque un an ? Certains prétendaient qu’il avait sombré en mer, d’autres soutenaient la thèse de la mutinerie, d’autres encore affirmaient que le capitaine et son équipage, unis dans la malversation, avaient changé de cap vers les mers du Sud afin d’y revendre la cargaison et le navire lui-même. L’homme du désert raconta ce qu’il était advenu de l’embarcation, soumise au déchaînement de l’océan, échouée à quelques milles de Saint-Louis, jusqu’à cet épisode peu glorieux où officiers, passagers et matelots s’étaient livrés une lutte indigne. Si aberrant que parût son récit, il n’en était pas moins authentique à en juger par les multiples détails fournis, noms des officiers et nature de la cargaison. On pouvait remettre en question la santé mentale d’un individu capable de braver les jungles et traverser les déserts, mais il était à l’évidence le seul témoin de la destinée du Sainte-Grâce .
L’un des gentilshommes lui proposa d’embarquer avec lui sur le Marie-Mère , en partance pour Saint-Malo dès le lendemain matin, afin d’y retrouver l’armateur du Sainte-Grâce et de l’instruire sur son bateau perdu. Ainsi, nul besoin de jouer les marins de fortune, il lui suffirait de prendre place dans une cabine et de s’y reposer après son étonnante traversée.
Plein de gratitude il serra la main de ses bienfaiteurs qui l’invitèrent à fêter leur accord dans une taverne anglaise, où l’on trouvait une bière d’excellente facture et une clientèle de bonne compagnie. Une heure plus tard, la chope à la main, ils trinquaient à ciel ouvert sur une grande place où des saltimbanques avaient garé leur roulotte et dressé une scène pour y jouer une pièce qu’on annonçait plaisante et gracieuse. Pris d’une légère ivresse, l’homme du désert, redevenu lui-même, remercia ses nouveaux amis avec une touchante sincérité mais s’interrompit au roulement de tambour qui ouvrait le spectacle. La troupe étant anglaise, il craignait de ne rien comprendre à l’intrigue de la pièce. Il sut d’emblée qu’il se trompait en voyant apparaître une comédienne habillée en paysanne, les bras chargés de fleurs.
Sa démarche chaloupée amuse les spectateurs. Un lièvre mort à la main, arrive un pauvre braconnier. Il prend des poses fatiguées mais se sent tout revigoré en apercevant la demoiselle qui attend qu’on la remarque. Leurs regards se croisent, ils se tournent autour, leur gestuelle affectée annonce le badinage. L’homme pose un genou à terre, tourne un compliment aux accents de roucoulade, et la femme, pâmée, répond à tant d’amabilité en incitant son admirateur à plus de fougue. Les embrassades ne tardent pas, et avec elles les hourras de la foule. Le couple laisse libre cours à ses emportements mais il est rappelé à l’ordre par divers importuns, joués par un même acteur qui se change à la va-vite hors de scène. Tour à tour un gendarme, un seigneur, un médecin, un prêtre, un sorcier ou un collecteur d’impôts se proposent de calmer leur ardeur mais en vain, à la grande joie du public. Un nouveau roulement de tambour annonce un rebondissement : les deux tourtereaux se retrouvent devant un roi sur son trône. La poudre blanche appliquée sur ses joues fait ressortir des cernes verts. À ses gestes las et ses halètements, on le sait souffreteux et de méchante humeur. Il bondit hors de son trône pour soudain s’effondrer d’apoplexie, provoquant l’hilarité générale. L’acteur réapparaît coiffé d’une capuche de bourreau, la hache à la main. À la liesse se mêle le frisson des exécutions capitales. Les époux agenouillés implorent la grâce des spectateurs. Certains accordent le pardon, d’autres réclament la mort. Par un saisissant effet de trucage comme en usent les magiciens, deux têtes tombent sur la scène, provoquant l’effroi. Au son d’une harpe surgi des coulisses, on déroule une fresque de nuages en guise de décor. Les amants, leur tête à nouveau sur les épaules, s’interrogent sur les mystères du lieu. Sur le trône du roi malade siège maintenant un personnage drapé dans une toge, doté d’une longue barbe blanche, applaudi par un public toujours friand d’allégories. Clément, Dieu les renvoie sur Terre en promettant que plus rien dorénavant ne les séparera.
Читать дальше