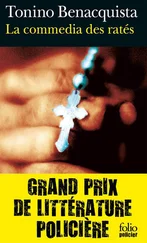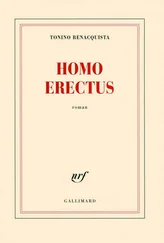Il l’invite à chercher elle-même sur l’étagère où sont alignés une dizaine de pots en terre un thé qui selon elle serait plus typique. Amusée par le test, elle fait crisser les feuilles sous ses doigts et les sent : l’une d’elles s’impose. Le vieil homme qui pensait que la vie ne lui réservait plus aucune part d’étrangeté ressent comme une inquiétude. Désigné comme le vénérable par toute sa communauté, il ne se sent porteur d’aucune sagesse face à cette femme qui lui inspire un respect de l’ordre de la foi.
Le mari réapparaît, rafraîchi, d’excellente humeur, et cède la place à son épouse. Sous l’eau chaude, elle pleurerait presque de soulagement. En rejoignant le salon elle s’attarde devant les rayonnages d’une bibliothèque, rien que des livres en chinois. L’un d’eux, dont la tranche tombe en lambeaux, attire son regard : Légendes d’un buveur de thé . Dans la table des matières elle s’arrête sur un titre : 被砍头的女人. Elle traduit pour son mari : La femme à la tête coupée .
Leur hôte précise : C’était une Française, comme vous ! Il ne peut s’empêcher de raconter l’histoire de la sainte protectrice des récoltes, aussi célèbre pour un petit Chinois qu’un conte de Perrault ou de Grimm pour un Occidental. En l’écoutant résumée en quelques phrases, l’étrangère comprend que son histoire a enfin trouvé sa forme définitive, patiemment tissée par le peuple lui-même, capable d’atteindre le bon équilibre entre le vraisemblable et l’extravagant, de gommer les aspérités et de créer les bons enchaînements. Elle écoute son hôte sans l’interrompre, sinon à la toute fin où elle s’exclame : 非常糟, 糕他把我们的头给砍了.
Très mal, il nous a coupé la tête !
En volant sa réplique au vieillard, elle se la réapproprie, trois cents ans plus tard.
Les fuyards ne cherchent pas à en savoir plus sur les affaires du vieil homme, ils veulent juste son aide. Et lui ne les laissera pas repartir dans le même état misérable qu’à leur arrivée. Ces deux-là ont encore une longue route à parcourir.
De tous les animaux croisés dans la jungle et la savane, le plus curieux d’entre tous était celui qu’il chevauchait maintenant, doté d’une bosse qui sans doute expliquait son exceptionnelle tempérance, d’un long cou en S, de jambes étiques mais rapides, d’une bouche adaptée au mors comme celle du cheval. De surcroît il semblait connaître la route — un petit miracle au milieu d’une immensité de sable sans le moindre relief —, du moins ne ralentissait-il jamais sur le coup d’une hésitation. Son cavalier se laissait ainsi porter, entièrement couvert d’une robe de couleur claire et d’une sorte de turban de coton roulé de façon savante. Il avait appris que sa survie dans ce territoire aride dépendait à la fois de son costume et de sa monture. Les deux lui avaient été offerts par cette tribu qui avait soigné sa fièvre, dont les chants et les danses vibraient encore dans sa mémoire.
Au fil des semaines il devenait comme un citoyen du désert, conscient de son infinité, respectueux de sa suprématie, gagné par une lancinante philosophie. Au lieu de combattre les continuels dangers de la nature, il apprenait à ne plus lutter contre les éléments mais à leur obéir pour s’en faire des alliés. Protégé de la morsure du soleil sous sa robe, des rafales de vent sous son masque, il eût paru aux yeux d’un natif de son pays comme un fantôme drapé dans son suaire, lévitant sur ce territoire d’un ocre à perte de vue. Sans doute n’était-il plus vraiment un être matériel mais un esprit en marche, progressant vers un zénith. Parfois il redevenait humain quand il saluait une caravane de passage, ou quand le dieu du désert plaçait sur sa route une oasis, où il séjournait trois nuits, le temps de se gorger d’eau et d’ombre. Avant de reprendre la route il remerciait ce dieu-là comme le plus grand de tous, le priant de lui refaire bien vite le même cadeau.
Un mois entier passa sans que le paysage varie d’une seule touche. Il en oublia qui de sa monture ou de sa propre main maintenait le cap mais, contre toute attente, jamais il n’en douta.
*
Ainsi pensait-elle avoir connu le froid ? Jeune fille, elle s’était imaginé que personne au monde n’avait souffert comme elle de ce vent glacé au sortir de sa couche. Qui aurait cru qu’un jour elle se souviendrait avec nostalgie des hivers de son enfance, si cléments, si nuancés.
Elle traversa des pays entiers sans pouvoir les différencier du fait de leur nature étale, une steppe longue de six mois, tantôt verte et grasse, tantôt brune et pelée. Précédée de ses chiens, un œil sur sa boussole, elle connut des climats tempérés dont le jour et la nuit semblaient d’une égale tiédeur. Mais plus elle frayait en direction du nord-ouest, plus elle adaptait sa cadence, sa tenue et son régime à des températures de plus en plus sévères. Aux nombreux peuples croisés en chemin, habitués aux nomades et coutumiers du troc, elle emprunta les techniques de survie, elle s’inspira de leur cuisine. Un jour elle demanda à une poignée d’indigènes de lui confectionner une tunique en fourrure et une toque avec la peau d’un yak sauvage chassé par ses chiens, en échange de sa chair. Aux premières neiges, elle se fabriqua un traîneau comme il en passait parfois, et s’étonna de voir comment ses chiens s’adaptaient naturellement à l’attelage. Elle se remémora les avertissements du notable de Shingsao qui les lui avait confiés : Considérez-les comme des partenaires, misez sur la confiance, et ils sauront vous ramener à bon port. Toutes vertus qui vous semblent bien abstraites aujourd’hui, vous découvrirez leur bénéfice en cours de route . Et de fait elle en bénéficiait chaque jour, et plus encore dans les contrées de haute neige et de glace. À voir sa silhouette de fourrure noire glisser sur cette étendue blanche, il était impossible de dire s’il s’agissait d’un homme, d’une femme ou d’un jeune ours. La plupart du temps elle dormait blottie entre ses deux chiens, bercée par leurs ronronnements. Parfois dans le décor surgissait une cahute qui brillait au loin comme un petit châtelet aux reflets d’argent, une sorte de cadeau dont on ne connaissait pas le donateur mais que les voyageurs remerciaient de tout cœur. Elle s’y installait avec ses chiens, tout étonnés de passer une porte, de dormir sous un toit. Elle les traitait alors comme des invités et retrouvait des gestes anciens ; c’était à elle de s’occuper d’eux, de les choyer, de les remercier de leur dévouement et leur courage.
En longeant les massifs du Caucase par le sud, décrits comme infranchissables, elle se perdit de longues semaines à la recherche de la mer Noire, sa carte ne correspondant plus en rien aux territoires qu’elle traversait. Sans le savoir elle remonta trop haut, là où sévissaient des mercenaires réunis en bandes si vastes qu’elles constituaient des communautés entières. Aucun voyageur égaré sur leur territoire n’aurait pu prétendre leur échapper, et moins encore une femme seule avec deux chiens pour uniques alliés.
Les Cosaques, naguère protecteurs et guides des marchands et des caravanes, préféraient désormais les piller. Leur réputation attirait à eux les aventuriers, fugitifs et parias, formant ainsi de véritables clans régis par leurs propres lois. Pour son grand malheur, la voyageuse et ses chiens croisèrent trois de ces cavaliers maudits, les sacoches pleines de leur dernier forfait, déjà prêts à en commettre un nouveau. Ils firent demi-tour en apercevant cette silhouette noire lancée sur son attelage, tentant d’éviter les failles du terrain. Elle fut vite encerclée par les hommes, dont l’œil s’alluma soudain en découvrant une femme cachée sous cette fourrure. Faute d’un butin substantiel, ils allaient se payer de leur traque en violentant la belle imprudente. Pour la terroriser, ils éclatèrent d’un même rire qui se perdit dans un écho. Ils perçurent en retour un grondement diffus qui leur ôta tout sens du sarcasme.
Читать дальше