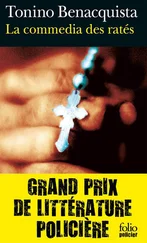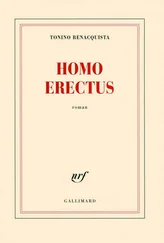Dans une hutte de paille, deux hommes se tenaient debout, penchés sur un malade tremblant de fièvre. Régulièrement, l’un d’eux remplissait d’eau une écuelle en terre cuite pour le faire boire de force — à voir la quantité de sueur qui ruisselait sur tout son corps, une jarre entière par jour n’y suffisait pas.
Le sorcier, à qui sa tribu prêtait des pouvoirs de guérisseur mais aussi de spirite, était sollicité pour soigner un mal de poitrine, pour lire un oracle ou communiquer avec un esprit, car son vrai talent consistait à rendre l’au-delà familier, rassurant, porteur de messages bienveillants. À ses côtés le griot était chargé de transmettre la tradition orale aux générations à venir. Philosophe et poète, il s’exprimait par des paraboles souvent plus édifiantes que les prophéties du sorcier.
Le chef du village les avait invités à associer leurs savoirs afin de percer le mystère de ce voyageur découvert inanimé au pied d’un arbre, trois gourdes vides à son flanc. En général les hommes blancs, heureusement fort rares, s’annonçaient à coups de fusil pour créer la terreur, qu’ils fussent marchands d’esclaves, missionnaires ou explorateurs. Cette fois l’un d’eux s’était apparemment mis en tête de traverser seul une contrée où les chasseurs se déplaçaient avec une ancestrale prudence. Sommés de le guérir afin qu’il déguerpisse au plus vite, le sorcier et le griot, assez instruits pour identifier les fièvres passagères ou mortelles, se trouvaient bien en peine de statuer sur celle-là. D’autant que les tremblements du malade s’apparentaient à un état étonnamment lascif, et que ses gémissements sonnaient comme des soupirs.
Il se blottissait contre le sein de la belle, consolé d’en avoir été tant privé. Il l’avait déshabillée, couchée sur le sol, retournée en tous sens pour admirer la moindre parcelle de sa peau, il avait besoin de la sentir, de la respirer de la tête aux pieds. Pendant leurs ébats, les murs d’une maison, toute semblable à leur premier foyer, s’étaient dressés autour d’eux et leur lit d’antan les enserrait maintenant, sa vieille courtepointe brodée les enrobait entièrement, là était le centre de leur monde à eux, trop de fâcheux les en avaient éloignés depuis trop longtemps. Ils se firent la promesse de rattraper dans ce lit les siècles perdus et, si une éternité n’y suffisait pas, ils la prolongeraient d’une autre.
Le griot fit remarquer au sorcier cet indéchiffrable sourire sur les lèvres du malheureux, signe d’une fin proche, quand on s’apprête à rejoindre le territoire des ombres, réconcilié après une vie de souffrance. Le sorcier pointa les curieuses reptations de son ventre et les interpréta comme une sorte de danse du départ pour le grand voyage, lente, cadencée, qui semblait procurer un apaisement radieux. Bientôt on entendit sous la hutte les soupirs de plus en plus haletants de l’agonisant, des râles sans douleur, ou bien de ces douleurs dont on ne souffre jamais assez. Le griot et le sorcier se trouvaient devant un cas unique : si toutes les fièvres brûlaient les corps de l’intérieur, qui n’aimerait pas brûler de celle-ci ?
Déchaînés, furieux, les deux amants cherchaient l’obscénité dans chaque geste, se vautraient dans les postures les plus triviales, et chacun d’eux atteignait ce point d’osmose où les parties du corps de l’autre semblent être les siennes, obéissant aux mêmes palpitations et procurant les mêmes plaisirs.
Comment désigner cette fièvre-là ? s’interrogeaient le sorcier et le griot. Comment l’expertiser afin, non pas de l’éradiquer, mais de la répandre ?
Il l’avait retrouvée, elle était bien là, rayonnante, ardente, incandescente, plus présente que jamais, et cette fièvre qui les consumait ne pouvait connaître qu’une seule issue, celle où les deux corps fusionneraient dans un même feu, prêt à tout embraser autour d’eux.
À son réveil, il était seul dans une étrange hutte.
Il toucha son front qui lui parut frais, aperçut au sol une jarre d’eau, en but de longues rasades puis s’humecta les joues et le cou. Il s’aventura au-dehors, guidé par une mélodie délicate et lancinante.
Dans le village s’accomplissait un rite tribal où hommes et femmes chantaient et dansaient autour d’un cercle formé par les enfants et les anciens. Il se laissa envoûter par le chœur aux accents languides de cette parade amoureuse. Le griot se pencha à son oreille pour lui décrire le sens de ce chant et de cette danse, et le visiteur, incapable de comprendre un traître mot, se contentait d’acquiescer, un sourire aux lèvres, afin de ne pas fâcher ses hôtes. En substance on lui expliquait qu’il avait été l’inspirateur de ce rite, qui désormais portait un nom : la fièvre joyeuse de l’homme blanc.
Deux riz nature et deux bols de bouillon, 3.75 $, au Café Li, dans l’Asiatown de Cleveland. C’est elle qui a eu l’heureuse idée de faire halte dans le quartier chinois, à peine arrivés en ville. Le seul possible vu l’heure tardive et avec le peu qu’ils ont en poche. Un grand écran diffuse, sans le son, une émission de variétés d’une chaîne de Hong Kong. Dans un coin, cinq jeunes gens jouent aux cartes. Les Français, épuisés après avoir parcouru à pied trente miles dans une banlieue industrielle, n’auraient qu’à poser la joue sur la nappe pour sombrer jusqu’au matin. Sans argent, sans voiture, ce n’est qu’une question d’heures avant qu’on ne les coince.
Soudain elle dresse l’oreille quand un des joueurs de poker laisse éclater son euphorie en ramassant le tapis. À son mari elle suggère l’idée que l’un de ces cinq-là connaît forcément quelqu’un qui pratique dans le coin le prêt usuraire. Malgré la fatigue il laisse échapper un rire, objectant qu’il s’agit là d’une très mauvaise idée. D’une part parce qu’il serait bien maladroit pour des Occidentaux, a fortiori non américains, d’insinuer à des homeboys que leur communauté s’est bâtie sur ce genre de spéculations. D’autre part, à supposer qu’on leur présente la bonne personne, celle-ci leur demandera des garanties qu’ils seront incapables de fournir. Sa femme décide de leur poser directement la question, mais dans une langue qu’on parlait dans le sud-ouest de la Chine il y a près de trois cents ans.
Les jeunes gens en oublient soudain quintes et brelans.
*
Le vieil homme habite dans l’Old Chinatown, le quartier chinois historique de Cleveland, déserté depuis la fondation d’un Asiatown en périphérie. En 1920 cet appartement avait été acheté par son père, figure historique du quartier, qui avait aidé à s’établir sur le sol américain quantité de cousins et amis de cousins. Le vieil homme est curieux de cette « long-nez » qui parle la langue de ses ancêtres, la vraie, pas celle qu’on enseigne dans les écoles modernes, mais celle de la province du Yunnan où aujourd’hui encore on récolte le thé noir — thé qu’il prépare maintenant, introuvable dans le commerce, directement envoyé par sa famille restée là-bas.
Le mari, qui ne comprend pas un mot de leur conversation, demande s’il est possible de prendre une douche. Son hôte lui indique le chemin de la salle de bains. Il aime l’idée de rester un moment en tête à tête avec l’étrangère.
Quand il veut savoir pourquoi elle parle le chinois du Yunnan, elle répond qu’elle y a récolté le thé, il y a longtemps : 很久以前, 我曾在那里采茶. Elle respire le fumet de la coupelle brûlante puis la porte à ses lèvres. Et affirme au risque de froisser son hôte que ce thé ne vient pas du Yunnan : 此茶并非来自云南.
Читать дальше